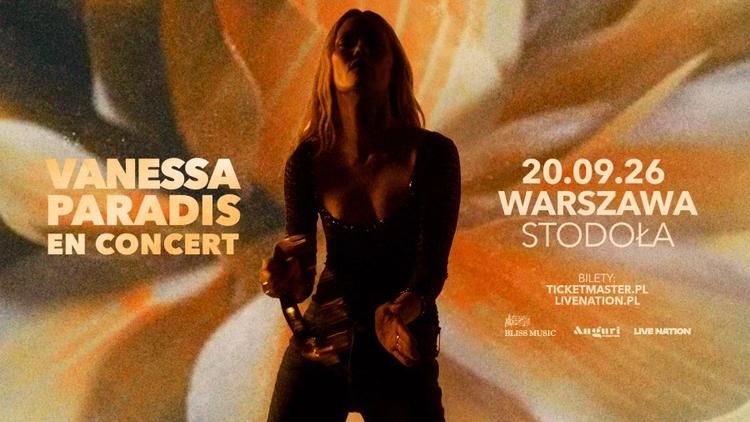Rencontre avec Adrian Jagodzinski, Directeur général de Caudalie Poland, qui est l’ingrédient stimulant et fortifiant de la marque française de cosmétiques éthiques en Pologne depuis 2021. Caudalie puise ses formules pointues et propres au cœur des ceps de vigne, produisant du resvératrol, un actif breveté naturel, aux propriétés raffermissantes et anti-âge. C’est en 2019 que le franco-Polonais, diplômé de l’EDC Paris Business School rejoint les rangs de la marque, après de nombreuses expériences dans le domaine de la beauté, notamment en Europe centrale. Dans cet entretien, il se livre avec justesse, sur son enfance française, sa double culture, l’apprentissage des réalités du monde de l’entreprise dès l’adolescence, aux côtés de son père, son expatriation en Pologne, ainsi que ses choix audacieux parfois même à contre-courant… Sa signature !


Lepetitjournal.com Bénédicte Mezeix-Rytwiński : Nous allons remonter le temps, comment s’est déroulée votre enfance en France, dans la double culture franco-polonaise ?
Adrian Jagodzinski : Très vite, dès la maternelle, j’ai été dans le milieu scolaire français, je précise que mes parents sont tous les deux polonais, mais ils se sont rencontrés en France. Parlant déjà français à l’époque, ils ont considéré que j’apprendrai beaucoup mieux le français par moi-même dans le cadre de l’école publique.
À quel moment se créaient les « bulles polonaises » ?
On parlait polonais à la maison, surtout avec mon père ; avec ma mère, c’était un mélange de français et de polonais, ce qui était assez drôle (rires), car je parlais polonais avec des mots français. Je n’avais absolument pas conscience de ces deux cultures distinctes : je ne me rendais pas compte, à ce moment-là, qu’il y avait une culture polonaise et une culture française.
C’est en grandissant - j’étais presque adolescent, que j’ai commencé à me rendre compte qu’il y avait ces deux éléments qui se juxtaposaient.
Du coup, pendant longtemps j’ai eu des incompréhensions avec des comportements culturels que je rencontrais en France, mais qui n’étaient pas forcément les mêmes que ceux que j’avais à la maison…
Lesquels par exemple ? Avez-vous des souvenirs de choc où vous vous êtes senti un peu décalé, avec des prises de conscience comme « Ah tient, chez les autres, ce n’est pas comme ça… » ?
Exactement ! (Rires) Déjà, le rapport à la mère est, je pense, différent. Quand je comparais avec mes amis français, je trouvais qu’il y avait plus de tendresse chez nous, à la maison, que chez eux. C’est quelque chose que j’observais, mais je n’arrivais pas à comprendre pourquoi. C’est peut-être pour cette raison que j’ai développé une certaine empathie et un caractère plus émotionnel.
Cela change le rapport à la famille ?
Oui, même les relations familiales, d’une manière générale. Le côté français de ma personnalité était embêté par les rendez-vous familiaux : aller voir mes grands-parents, passer du temps en famille, c’était ennuyeux, pas « cool ». Je réagissais en écho avec ce que les jeunes de mon âge renvoyaient.
C’est lorsque j’ai voyagé en Pologne que j’ai découvert la force des liens familiaux, tout en ayant toujours cette dissonance : en France, les réunions de famille m’ennuyaient, mais en Pologne ce n’était plus du tout le cas.
Vous voulez dire qu’en Pologne on s’inscrit plus dans une lignée, une histoire, alors qu’en France, nous serions comme des pièces de puzzle éparpillés ?
Pour synthétiser un petit peu tout cela, je dirais qu’il y a un côté un peu communautaire polonais, on reste entre-soi, on cultive les relations, par rapport à l’esprit français plus indépendant.
La richesse des doubles cultures, c’est de comprendre qu’il n’y a pas un pan qui est mieux que l’autre, c’est juste différent.
Vous devez beaucoup à votre père dans votre parcours professionnel, il vous a formé, lui aussi, à sa façon ?
Mon père est quelqu’un de très débrouillard, de très ambitieux. Aujourd’hui, il est à la retraite. Ce qui est triste, c’est que je découvre sa vie seulement aujourd’hui, car il a toujours été très mystérieux et il gardait ses problèmes pour lui, il ne les a jamais apportés à la maison, qui était notre espace privilégié. Mes parents faisaient attention à ce que les aléas de la vie, comme les bonnes choses, n’influent pas sur la vie de famille.
Mon père était imprimeur de métier, mais le milieu est entré en crise, alors il s’est adapté et a ouvert son entreprise de rénovation : il a commencé avec un pot de peinture et comme il était très relationnel, il a tout de suite trouvé un créneau, et pendant plus d'une vingtaine d’années, il a eu de nombreux clients.
Comme j’étais plus à l’aise en français que lui et qu’en plus il investissait dans notre éducation, il m'a délégué la rédaction de ses devis et factures.
Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vous occuper de son administration ?
Et bien, cela a commencé dès mes 14 ans. Inutile de vous dire que je n’étais pas toujours très heureux : avec mes copains, on jouait aux jeux vidéo, sauf que moi, avant ou après, il fallait que je fasse ses devis, ses factures. Heureusement, c’était rémunéré (rires).
Je l’ai fait jusqu’à ce que je quitte le cocon familial, à mes 23 ans.
Mais, au final, c’était très bien, car comme j’ai un cursus économique et que j’ai fait une école de commerce, j’aidais déjà à la gestion de sa petite entreprise. Je voyais à quel point c’était compliqué de gérer une entreprise, mais cela m’a donné une ouverture et une lecture du monde.
Quand vous étudiez à l’École des créateurs et dirigeants d’entreprise (EDC) - ancienne école des cadres, alors que vous aviez déjà un pied dans le monde de l’entreprise, n’y avait-il pas des moments où vous vous sentiez un peu en décalage par rapport à vos camarades de promotion ?
Oui, en fait, toute ma vie, je me suis senti en décalage. C’est intéressant et c’est vrai. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, mes parents ont acheté un appartement à Créteil et tout d’abord, je me suis retrouvé à l’école publique. Mes parents m’ont très vite inscrit à l’école privée, car ils avaient peur que je subisse de mauvaises influences. Je vivais dans un quartier qui était, on va dire, un quartier populaire. Sauf que mes parents, ma famille ne venaient pas du tout de ce milieu.
Il y avait donc déjà un premier décalage entre la maison et le quartier : comme le rapport aux ambitions, aux attentes que l’on a de la vie. C’est pour cela que mes parents m’ont inscrit dans une école privée, où je côtoyais des gens d’un environnement un peu plus élitiste, que celui que je connaissais…
Je faisais le grand écart entre le lycée Saint-Michel de Picpus à Paris et les trajets en RER pour revenir dans le Val-de-Marne, où j’habitais.
Et aujourd’hui, par rapport à ce décalage, j’imagine que vous avez trouvé le moyen de faire fonctionner, cohabiter tous ces aspects de votre personnalité ?
Je devais tout le temps m’adapter, virevolter, ajuster mon comportement. Au départ, c'était assez compliqué pour moi, mais je pense que mon empathie m’a permis de réussir, me donnant un sceptre social et sociologique assez large, très large même, et j’ai commencé à m’amuser avec ça d’ailleurs… Je me dessinais un peu une carte dans ma tête et je parlais l’argot, le verlan à l’époque dans certaines conditions et je m’amusais à parler un français châtié dans d’autres…
C’est devenu votre force aujourd’hui ?
Oui, cela m’a donné une vraie force, me permettant de bien lire les intentions des gens, je lis, comprends très ce qu’ils attendent, ce qu’ils pensent. Cela enrichit mon empathie encore plus. Ce qui est une bonne chose, je trouve : j’ai pu développer des facultés de communication qui me sont très utiles en tant que manageur.
Savoir comment aborder les gens, ne pas les mettre mal à l’aise et leur permettre de ne pas perdre la face est très important dans les relations interculturelles.

D’ailleurs, je le ressens de la part de mes équipes, car souvent, j’ai un très bon feed-back de la part de mes collaborateurs qui me disent : « Où que tu ailles, on te suivra ». Donc ça, c’est touchant, cela fait plaisir à entendre.
De toute façon, la vie comme le travail, sont basés sur les rapports humains. Je pense que le plus important, le plus passionnant dans le business, c’est ça finalement, les rapports humains.
À quel moment, le monde de la beauté est-il arrivé dans votre vie ? Avez-vous choisi cette voie ou est-ce elle qui s’est imposée à vous ?
C’est plutôt un concours de circonstances. En fait, j’ai débuté chez Yves Saint Laurent Beauté, car ils avaient un poste vacant en Europe centrale à l’export et finalement au lieu d’embaucher, ils offraient un stage.
C’était donc une vraie mission, chez Yves Saint Laurent Beauté ?
Quand je suis arrivé en stage, cela faisait 6 mois qu’il n’y avait plus personne sur le poste. Mon passage dans l’entreprise devait durer un mois, par un concours de circonstances - le contrat avec le distributeur en Pologne et en Tchéquie arrivait à échéance, j’ai dû remettre un petit peu d’ordre dans les papiers et, en même temps, réaliser un mémorandum, une recommandation sur le choix du distributeur, ce qui a été passionnant. Le fait que je parle polonais a vraiment été un plus.
C’est ainsi que mon expérience dans le luxe a débuté ; j’ai noué une relation avec le directeur export qui m’a dit « si tu as un autre stage, appelle-moi ».
Vous alliez retourner à Paris, après ce stage ?
Pour moi, Paris c’était devenu trop petit, j’en avais fait le tour, et j’avais envie de faire autre chose, de découvrir le monde ; j’ai donc aussi fait un stage à New York, dans la gastronomie en tant que serveur, car les États-Unis, au niveau des visas de travail, c’est un peu compliqué…
C’était une superbe expérience. Pendant trois mois, j’ai vécu à New York, ce qui m’a permis de réaliser que l’Europe avait de vrais avantages (rires).
Comme il était nécessaire d’effectuer un stage chaque année pour valider les crédits ECTS, je me rappelle que j’avais l’année suivante la possibilité d’aller à Londres pour me former au trading à la Société Générale. D’ailleurs, c’est drôle, c’était à l’époque de l’affaire Jérôme Kerviel, que j’aurais probablement côtoyé si j’avais accepté ce stage…
Et c’est donc à la place de Londres que vous avez choisi Moscou ?
Oui, le directeur export chez Yves Saint Laurent avait accepté une nouvelle mission de monter la filiale russe de la marque, je l’ai appelé.
Il m’a dit : « Écoute, moi, je viens de la finance, mais le plus passionnant, c’est vraiment d’être auprès du produit et de la production. La finance, c’est de l’argent, c’est facile, mais c’est vide ». Et j’ai eu cette réflexion et je me suis dit : « C’est vrai, il a raison ! ». Puis, il a ajouté : « Écoute Adrian, c’est toi qui décides, mais si tu veux, tu peux toujours venir à Moscou et moi de toute façon, j’ai besoin de mains, d’yeux et d'oreilles, car là, je suis tout seul avec un distributeur russe qu’on est en train de racheter pour créer une filiale donc, si tu veux, viens deux ou trois mois et tu vas m’aider ! »
Aider à la création d’une filiale de distribution, c’est une expérience que l’on n’a pas forcément en stage tous les jours. Finalement, j’ai décidé d’aller dans le wild wild east russe (rires). Ça, c’était un tournant de ma vie, en 2007-2008.
C’était un choix audacieux !
Oui, là, c’était un vrai choix, car la plupart de mes collègues d’études auraient sauté sur l’option Londres, à la Société Générale… Le trading, forcément ça fait rêver, mais finalement, j’ai décidé d’aller à contre-courant !
Vous en avez pris beaucoup des décisions comme celles-ci, à contre-courant dans votre vie professionnelle ?
Oui, j’en ai pris beaucoup ! Le déménagement à Varsovie en 2009, c’était aussi à contre-courant, car même dans la communauté polonaise, personne n’a compris : « Comment ça se fait que tu quittes Paris pour partir en Pologne, c’est n’importe quoi ? ». Je parle de Polonais qui ont tout donné pour quitter la Pologne au moment du rideau de fer, dans des conditions parfois dignes de films… Pour eux, ce retour était inconcevable.
En fait, après Moscou, je suis revenu à Paris. J’ai soutenu mon mémoire de master, mais il fallait que je fasse encore un stage de 6 mois pour valider complètement mes crédits ECTS. Je l’ai donc fait à Varsovie chez l’Oréal Polska.
À ce moment-là, qu’est-ce qui vous fait choisir la Pologne ?
Moi, ce qui m’a mis la puce à l’oreille sur la Pologne, c’est le fait qu’il y a eu une première crise financière mondiale au 2e semestre de 2006, avec le krach des prêts immobiliers hypothécaires…
Avant la première crise des subprimes, qui a débuté en juillet 2007, le PIB de la Pologne était, de mémoire, aux alentours de 8 %, mais on disait que c'était grâce aux IDE (investissements directs à l’étranger). Or, pendant la crise, les IDE se sont arrêtés et chaque investisseur étranger a récupéré ses fonds.
Et moi, je constate que la croissance se maintient à 4 % en Pologne, bien que tout le monde ait retiré ses investissements. Je me dis : « Tiens, ce n’est pas que des IDE, il y a quelque chose, en interne, qui se passe ». Donc ce dynamisme de la Pologne m’avait déjà mis la puce à l’oreille.
Ensuite, pendant mes études, justement en voyageant un petit peu à Moscou et à New York, je me suis rendu compte qu’on allait vers un nivellement du monde : les pays riches étaient très moroses – en France, à l’époque, il y avait une stagnation voire, je ne dirais pas qu’on était en décroissance, mais cela se ressentait, alors que des pays comme la Chine, étaient en train d’exploser.
J’ai réalisé que l’Europe, qui était l’une des zones les plus riches, allait forcément stagner, par rapport à la Chine notamment ou aux pays des BRICS [NDLR : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud]... C’est d’actualité en ce moment justement !
Mais au sein de l’Europe, il y avait encore des différences, comme la Pologne, par exemple, qui avait été « mise au frigo » pendant le communisme et qui sortait enfin de ce frigo, avec un gros retard à rattraper. Vous rajoutez à cela l’ « aspect socio-culturel » : les Polonais avaient « envie », ils avaient l’ambition, la motivation de rattraper l’Ouest, car ils considéraient qu’ils avaient aussi le droit au développement. Et bien, c’est cet appel d’air qui se produisait là-bas, qui, malgré le nivellement mondial, m’a poussé à aller voir.
Qu’a-t-elle à offrir, cette Pologne, en plus d’être la terre de vos ancêtres ?
Ce qui est intéressant, pour moi, c’est que la Pologne est entre la Russie et la France, qui, rappelons-le, a le système social le plus développé au monde et en Russie, il faut être « fort » pour se maintenir « hors de l’eau ».
J’avais un problème avec les deux, car je n’aime pas les extrêmes. Le juste-milieu me convient et c’est ce que j’ai trouvé en Pologne, où on promeut plutôt bien le travail au mérite, dans le respect des valeurs humaines, à la française.

Retournons en 2009, c’est là que vous avez débuté chez l’Oréal Polska ?
Oui, en fait, quand je suis arrivé en janvier 2009, naturellement, on m’a proposé de m’occuper d’Yves Saint Laurent. Le contrat de distribution avec le distributeur polonais, arrivait à échéance en juin 2009. Donc, ma mission, au début, était de préparer à la reprise. C’était une mission assez singulière, encore une fois, j’étais vraiment un électron libre et je ne rentrais pas dans les cases de l’Oréal…
C’était une mission atypique, mais très intéressante en termes de marketing : construire l’offre et le positionnement prix, gérer la reprise des inventaires du distributeur, qui n’était pas volontaire pour collaborer…
Ensuite, après la prolongation de mon stage, je suis devenu « marketing stagiaire manageur ». Arrivé à la fin de cette période, l’Oréal Polska m’a proposé de rentrer dans leur programme de développement, et ils m’ont envoyé sur le terrain pendant sept mois.
Tous ces voyages pour l’Oréal Polska, c’était un excellent moyen de découvrir tous les visages de la Pologne ?
Oui, je me suis retrouvé en Silésie, à Katowice – ville où je n’avais jamais mis les pieds avant, en hiver, en 2010. C’était encore un véritable hiver à l’époque : il y avait des températures allant jusqu’à -30 degrés. Ils m’ont fourni une voiture et je me rendais chez les clients. C’était assez drôle parfois, car ils étaient surpris de me voir, d’autres me réservaient un accueil un peu spécial…
Mais c’était génial, car j’ai découvert la Pologne « profonde », en dehors de Varsovie. En plus, cela m’a rendu autonome dans le pays et de plus, j’ai obtenu de super résultats.
Donc après, lorsque je suis retourné au bureau, l'Oréal Polska m’a proposé de passer aux produits grand public : l’Oréal Paris, Maybelline New York et Garnier. C’était un sacré challenge, car ces produits représentaient près de la moitié du business à l’époque, de l’Oréal en Pologne.
C’est ainsi que j’ai commencé ma carrière de commercial grands-comptes. Cela m’a mis sur les rails. J’ai été témoin du développement des parapharmacies et drugstore en Pologne avec l’apparition des nouvelles chaînes comme SuperPharm, Rossmann, Hebe, ainsi que de la chute de Marionnaud…
Cette connaissance du marché m’a donné les bases pour intégrer l’entreprise Caudalie.
De la beauté, vous êtes passé au sport, vous aimez vous mettre au défi ?
Oui, chez l’Oréal Polska, j’avais un peu tout fait et j’ai commencé à me rendre compte qu’en montant les échelons, le résultat était moins concret. Je suis un homme de terrain et je préfère parler résultat que politique interne, donc, j’ai cherché autre chose, mais je me suis dit : « Quitte à quitter le numéro un de la beauté en Pologne, qui est l’Oréal, ce n’est pas pour aller chez le numéro deux ». Je me suis posé la question de : « Qu’est-ce que j’aime faire dans la vie ? ». Et bien, le sport, c’est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie, donc, quand Nike est venu me chercher, c’était évident, j’ai accepté.
Pour moi, c’était aussi un moyen de sortir de ma zone de confort et de m’évaluer, car cela faisait 7 ou 8 ans que j’étais dans la beauté et passer dans le monde du sport et de l'habillement, c’était vraiment un grand écart. Donc, encore une fois, je me suis testé. J’ai adoré cette expérience, j’y suis resté 4 ans.
Ensuite, le téléphone a sonné et c’est là que j’ai entendu parler d’un poste au sein de l’entreprise Caudalie.
D’ailleurs, comment se porte le marché des cosmétiques en Pologne ?
Je peux dire qu’effectivement la Pologne est un marché très concurrentiel, notamment en termes d’offres produits et en termes de distribution, incluant une offre beauté très large, beaucoup plus large, je trouve, qu’en France.
Déjà, les Polonaises raffolent des salons de beauté, des cliniques, c’est quelque chose qui est très en vogue… Elles prennent soin d'elles, effectivement. Puis, la Pologne est un pays, il faut le rappeler, qui a un passé historique avec l’industrie chimique. Du temps de l’URSS, c’était le pays communiste (PRL) qui avait le parc industriel chimique le plus développé. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de marques polonaises qui font de très bons produits, avec de très bonnes formules et qui ne sont pas chères.
Esthétiquement, c’est moins bien… Les packagings ne sont pas aussi esthétiques, aussi fins et précis que les produits made in France.
Mais c’est vrai que le made in France, c’est quand même un gage de qualité très fort dans le monde et en Pologne.
Parlons-en du made in France : pouvez-vous nous présenter Caudalie, cette entreprise française de cosmétiques qui s’est fait un nom parmi les grands, depuis 1995 ?
C’est une société indépendante qui fait vraiment son chemin, hors des sentiers battus, imposant sa propre philosophie depuis presque 20 ans.
Caudalie, c’est la marque qui se veut la plus performante des marques « clean » et sensorielles. Nous apportons un très grand soin à nos formulations afin qu’elles soient efficaces – nous avons de nombreux brevets, tout en restant « clean », propre.
Nous arrivons à cette prouesse grâce à des ingrédients qui ne vont pas nuire à la santé - la nôtre, comme celle de la nature. Nos formulations sont sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans ingrédients animal (hors miel et cires d’abeille), sans phtalates, sans huiles minérales, sans PEG. Nous excluons tous les conservateurs qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens ainsi que les agents irritants et polluants, pour ne citer qu’eux.
De la French Touch à la French Riviera : la magie de Saint-Tropez ravit les Polonais
Vous qui avez soutenu l’entreprise de votre père, vous êtes donc totalement en phase avec la marque Caudalie, qui colle avec vos valeurs personnelles et de leader ?
Caudalie, c’est vraiment une marque familiale : tout est parti du château Smith Haut Lafitte à Bordeaux, en 1995. Ce sens de la famille, les racines, les origines, ce sont des valeurs qui me parlent totalement…
C’est une marque de la vigne qui utilise les bienfaits anti-oxydants du pépin de raisins et des ceps de vigne. Savez-vous qu’un cep de vigne est une plante qui vit plus de 100 ans, très souvent dans des conditions extrêmes et qui a donc des propriétés anti-oxydantes très fortes ? Il y a beaucoup de choses à en tirer et à inclure dans les produits cosmétiques, comme les polyphénols. C’est grâce à nos recherches et à ce regard pionnier que la marque Caudalie a été la première à breveter l’actif resvératrol, un puissant actif naturel aux propriétés raffermissantes et anti-âge.
Il y a aussi une dimension psychologique, dans les soins de beauté : ils renforcent la confiance en soi, nous rendent plus sûrs de nous, nous permettent juste de nous sentir mieux, et surtout bien…
Moi qui viens du monde de la « corpo », de grands groupes – l’Oréal et Nike, j’avais en fait l'objectif avant 40 ans de sortir un peu de ce monde et de rejoindre justement une entreprise familiale qui a des valeurs profondes, qui est enracinée. Dans le monde où nous vivons, dans un environnement business qui est très volatile, je trouve ça vraiment bien et rassurant qu’il y ait encore des sociétés enracinées.
📲💻 Pour rester informés du lundi au dimanche, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite !
💡 Soutenez votre édition | lepetitjournal.com Varsovie
↪ Lepetitjournal.com est un média quotidien, 100% en ligne, que nous avons choisi de rendre accessible à tous, gratuitement. Mais l’indépendance, la rigueur et l’originalité ont un coût.
↪ Chaque édition locale Lepetitjournal.com est indépendamment financée par des annonceurs, sans jamais céder sur son autonomie : la rédaction reste souveraine dans ses choix éditoriaux.
↪ Grâce à votre fidélité, Lepetitjournal.com Varsovie est dans le top 15 des éditions les plus lues en termes d'audience sur les plus de 70, présentes à travers le monde.
↪ En nous soutenant, même modestement - à partir de 5 €, vous nous aidez dans nos missions quotidiennes, contribuez à nous développer et garantissez la pérennité du média.
🎯 Lepetitjournal.com Varsovie fêtera en 2026, 20 ans de rayonnement en Pologne ainsi qu'à l'international : un cap symbolique que nous franchirons, ensemble !
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, LinkedIn