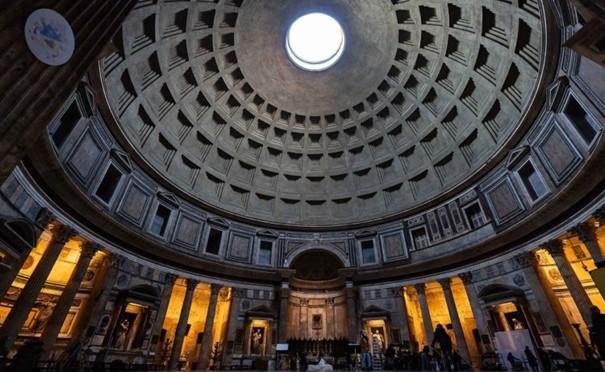La "granita", c’est ce curieux sorbet grenu – sans être un "sorbetto", attention ! - au drôle de nom qui soulage de tous les soleils et siroccos du Sud. Et qui change de genre dès qu’elle arrive en France. Cette institution sicilienne dissimule une surprenante histoire.


Rouge ou verte ou blanche ou jaune ou bleue, de toutes les couleurs qu’on puisse imaginer, la granita tourne toute la journée dans de grandes cuves transparentes, souvent deux, trois mises côte à côte en hauteur. L’idée de fête et de folie douce de ces aquariums bizarroïdes sans personne dedans est immédiate. D’ailleurs, Granita avec un grand G (une grande marque de machines à granités française) lui a offert le meilleur des slogans, la proclamant net et fort « la plus givrée des boissons ». Quelle trouvaille ! Hé oui, par essence et par étymologie, la granita contient de minuscules grani, grains, en givre. Hé non, la créature n’est pas sérieuse. Il lui arrive de changer de genre dès qu’elle arrive en France et devenir ça et là « un granité ». Ou de franchir nos frontières telle quelle, sans que cela ne s’explique ni par la région ni par l’époque ni par rien. Sans compter une délicate complication : la granita joue de confusion sur son propre territoire jusqu’à se faire passer de temps en temps pour d’autres petites bontés glacées.

Une histoire multiculturelle
Les Siciliens vont l’ânonner jusqu’à la fin des jours : la granita n’est pas un sorbetto. Ou alors, comme on disait autrefois, la granita est un sorbetto granito, un sorbet granuleux. Donc : pas un sorbetto. Cela se remarque à l’œil et à la papille. Dans le sorbetto, d’une matière essentiellement plus onctueuse, de l’eau, des fruits et du sucre bien amalgamés, pas de cristaux glacés. Les parfums : citron, mandarine, pêche etc… Bien avant, il y eut les inouïes fleurs d’anis et de cannelle de Francesco Procopio dei Coltelli, fondateur sicilien du Procope (1686), le plus ancien café de Paris, et roi des sorbets. Plus loin et au début de tout, la subtile et féerique eau de rose originelle. Car ce sont les Arabes qui introduisirent en Sicile le sarab (du turc sherbeth) voulant dire « boisson » ou « potion ». Et hop ! Nous apprenons du même coup et par un bel effet de hasard que sciroppo, sirop, est aussi sorti de ce sarab-là, les bons sirops, menthe, fraise etc., à « siroter » (sorbire en italien) tranquillou dans son coin et les mauvais contre la toux, amers ou trop pâteux, servis dans une cuillère à soupe trop pleine. Tiens, mais revoici notre « sorbet » de derrière ces sorbire (siroter) et sorbettare (transformer en sorbet) passés l’un et l’autre dans le langage familier pour dire « se coltiner », « se farcir » ; sorbirsi, sorbettarsi par exemple un touriste têtu qui persiste à confondre encore et toujours granita et sorbetto.
Grattachecca ou granita ?
Qu’on s’abstienne aussi de répéter aux Romains que la grattacheccca et la granita sont la même chose. La grattachecca leur appartient par tradition, et par son mot curieux issu de grattare, gratter, et de checca, un nom du dialecte romain voulant dire « bloc de glace ». Rien à voir, soyons net, soyons-le vite, avec le checca diminutif de Francesca, que d’aucuns dégainent pour railler un homme à la prestance très efféminée, une grande folle, comme on dit en français. Bon. Voilà donc le grattacheccaro romain (le mot est rare mais tellement à dormir debout qu’on le prend ici pour le plaisir !), seul maestro de la grattachecca. Il râpe son bloc de glace dans son chiosco, sa buvette, dépose les copeaux glacés dans un verre, ajoute du sirop ou du jus de fruit, puis des morceaux de vrais fruits par-dessus. Une préparation ancestrale dressée sur le moment et savourée dans la rue qui fait spectacle. Sans compter que les amateurs de grattachecca ne passent pas inaperçus avec leurs cric et crac et crunch accélérés - c’est si froid sous la dent qu’on croque à toute vitesse - bref, avec ces inimitables bruits de petit rongeur qu’ils font tous en mangeant !
A l’origine, la neige de l’Etna
La granita au contraire est muette et la déguster se fait dans une sourdine et une lenteur comme marcher dans la neige. D’ailleurs, tout commence par la neige de l’Etna qu’on recueillait l’hiver pour l’entreposer au fond de vastes glacières aménagées dans la montagne. Aux grandes chaleurs d’été, on récoltait la glace qu’elle était devenue. On la pilait. On la disposait dans un verre. On y versait un sirop aux parfums des arbres et arbustes de l’île, citron, amande, mûre, figue de Barbarie, pistache. Puis le café et tous les arômes du monde. Aujourd’hui la granita est une institution et elle a ses usages. La grande dame est habituellement présentée dans un verre ou une coupelle transparents, pour faire envie à qui la voit dans son insolite consistance et ses couleurs. La granita, c’est une fête depuis l’enfance. Les Siciliens grandissent avec elle au petit-déjeuner, après l’école ou à la plage, au goûter ou durant la passeggiata du soir, tout parés comme il faut avec une petite cuillère pour leur glace tout le temps qu’elle scintille et crisse tout bas, et une paille pour quand elle fond. Ça reste quand même plus étonnant que lécher bêtement et frénétiquement un cornet à une ou deux boules.
La brioscia col tuppo, une expression française
Et, surtout, le rituel de la granita sicilienne ne s’accomplit jamais sans la très populaire brioscia col tuppo. Une forme ronde un peu aplatie surmontée d’une deuxième moins grosse, cousine de notre « brioche parisienne » ou « brioche à tête ». Surprise : la brioscia col tuppo, spécialité d’une île se trouvant à plus de deux mille kilomètres de Paris, est une expression deux fois française. D’abord, brioscia, cela s’entend, est l’adaptation italienne du mot « brioche ». Le tuppo ou tuppu ou tuppè, en sicilien le « chignon », cite celui que les femmes de l’île avaient l’habitude de se nouer sur la nuque. Tuppè, donc, cela s’entend encore, est la version sicilienne du « toupet » français. Encore plus fort : « brioche » et « toupet » sont deux emprunts des Italiens au français, ils sont présents dans leur dictionnaire et leur langue de tous les jours au même titre que leurs mots à eux.
Revenons à nos dégustations. Tout amateur de bonnes choses a ses manies et cruautés cachées ; le vrai Sicilien, dit-on, arrache le tuppo de sa brioscia en forme de petite bonne femme pour le manger avant le reste, c’est meilleur, comme certains de chez nous grignotent les quatre oreilles et les quarante-huit orteils ou dents des petits-beurre en premier. De furtives et bien enfouies velléités ogresques ? L’idée de fête et folie douce de la granita ne dort jamais… on vous avait prévenus.
Sur le même sujet