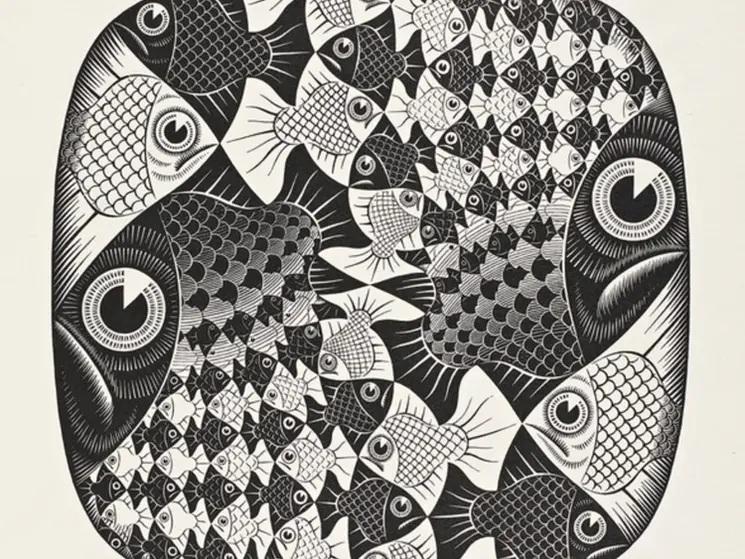En matière de maladie cœliaque, l’Italie fait figure d’exemple en Europe : dépistage précoce, aides financières... La France, elle, semble à la traîne. Enquête sur un écart qui interroge.


Pâtes fraîches, focaccia moelleuse, pizza cuite au feu de bois : la gastronomie italienne est indissociable du gluten, cette protéine contenue dans des céréales comme le blé, le seigle ou encore l’orge. Tout laisse donc à penser que la péninsule serait hostile aux intolérants au gluten. Pourtant, l’Italie est aujourd’hui l’un des pays les mieux adaptés au quotidien des personnes atteintes de maladie cœliaque, une pathologie auto-immune déclenchée par l’ingestion de gluten. Cette maladie est à distinguer de deux autres troubles souvent confondus : l’allergie au blé, qui déclenche une réaction immunitaire immédiate potentiellement grave, et la sensibilité non-cœliaque au gluten, qui provoque notamment des symptômes digestifs sans lésion intestinale. En revanche, dans le cas de la maladie cœliaque, le gluten provoque une réponse auto-immune qui abîme la paroi de l’intestin et empêche le corps d’absorber correctement les nutriments. En 2023, l’Associazione Italiana Celiaca (AIC) dénombrait 265.000 personnes diagnostiquées de la maladie cœliaque en Italie, contre environ 150.000 en France selon son homologue français, l’Association Française des Intolérants au Gluten (AFDIAG). Un écart d’autant plus frappant que la population française est plus nombreuse. Pourquoi une telle différence ?
Le dépistage, clé de voûte du modèle italien
Le facteur principal : la démarche proactive de dépistage déployée en Italie. En effet, en septembre 2023, le Parlement italien a approuvé une campagne de tests massive chez les jeunes âgés de 1 à 17 ans. Cette décision fait suite aux travaux de Carlo Catassi, professeur de pédiatrie à l’Université polytechnique des Marches à Ancône. Menés dans six villes italiennes, ils avaient révélé qu’un enfant sur six pourrait être concerné. Alors que la maladie est difficile à diagnostiquer sans test, la stratégie de dépistage actuellement en place en France est ciblée : les tests ne sont pas systématiques, et ils ne sont effectués que sur des patients qui présentent déjà d’importants symptômes. Au-delà des cas qui ont pu être détectés par ces tests, cette importante campagne a également eu pour conséquence de sensibiliser massivement la population à cette maladie qui touche trois fois plus les femmes. Une connaissance plus fine de la maladie pousse naturellement davantage de personnes à se faire tester, gonflant les chiffres, sans forcément signifier une prévalence plus élevée. De même, les professionnels de santé sont plus à même de penser à ce genre de diagnostic lorsqu’ils sont confrontés aux symptômes liés à la maladie.
Une culture médicale et associative ancrée
Cette meilleure connaissance s’explique également par l’engagement continu de l’AIC, particulièrement actif dans le pays. L’association appose son label « sans gluten » sur les produits, et certifie les établissements adaptés aux patients cœliaques, qu’elle répertorie sur une application gratuite. En France, cette certification des restaurants n’est pas automatique. Si l’AFDIAG existe bien, son influence à la fois sur la société et sur le plan institutionnel est beaucoup plus limitée. Ses actions se limitent principalement à des rôles d’information du public, de soutien de la recherche médicale, mais aussi de défense des intérêts des personnes intolérantes auprès des instances politiques. Ainsi, l’AFDIAG a notamment contribué à la mise en place du remboursement partiel des aliments sans gluten par l’Assurance Maladie, ou encore à un étiquetage strict de ces produits.
La maladie cœliaque combine une prédisposition génétique, qui concernerait 30 % de la population selon la presse spécialisée, ainsi qu’un facteur environnemental déclencheur, lié à l’ingestion de gluten. Pour qu’elle se développe, il faut donc à la fois une base génétique favorable et un élément extérieur pour activer le processus auto-immun. Il est important de noter que la plupart des personnes porteuses de ce gène peuvent manger du gluten sans jamais développer la maladie cœliaque : si les deux conditions sont obligatoires au déclenchement de la maladie, leur combinaison chez un patient ne signifie pas automatiquement que celui-ci sera intolérant. En Italie, la proportion de cas diagnostiqués est plus élevée que dans la plupart des pays voisins. Pourtant, à ce jour, aucune étude scientifique ne met en avant l’existence de facteurs environnementaux extérieurs spécifiques à l’Italie qui expliqueraient ce fort taux : ni pollution, ni mode d’exposition alimentaire particulier, ni qualité du blé qui diffèrerait du reste du monde ne sont pour l’heure mis en cause. Les experts s’accordent à dire que le dépistage précoce et fréquent reste la principale raison à ce taux plus élevé que chez la plupart de ses voisins. Autre piste avancée : une dégradation de la qualité du blé bel et bien constatée, pouvant conduire à l’augmentation du nombre de patients cœliaques à l’échelle globale. Le recours à des procédés de transformation du blé, le rendant plus riche en gluten et moins digeste, concerne de nombreux pays industrialisés et n’est pas spécifique à l’Italie.
Santé publique : une stratégie gagnante ?
Une question subsiste : faut-il suivre l’exemple italien ? C’est un débat qui dure depuis des décennies dans la communauté scientifique. Pour les détracteurs du dépistage à grande échelle, le principal argument réside dans la fiabilité des tests. Des tests pourraient être faussement positifs, et ainsi soumettre des patients à un régime sans gluten strict, sans que cela améliore sa santé. Néanmoins, ces cas restent extrêmement rares, et restent vérifiables. La gastroscopie, qui permet une biopsie de la paroi intestinale, comporte un taux de certitude proche de 100%. Il s’agit de la méthode de test de référence chez les adultes. Chez les enfants, un dépistage par une série de prises de sang est souvent privilégié, afin de leur éviter un examen trop invasif. Le caractère répétitif de ces prélèvements sanguins rend ainsi extrêmement minoritaire l’existence de faux positifs : les bénéfices potentiels d’un diagnostic précoce semblent alors l’emporter sur les risques de surdiagnostic. En outre, le Professeur Catassi alerte de son côté sur le fait que les personnes malades non diagnostiquées pourraient souffrir de conséquences à long terme pour leur santé. Cela n’est pas anodin : on estime qu’environ 1 % de la population mondiale est touchée par la maladie cœliaque, souvent sans le savoir. Or, si des formes plus asymptomatiques existent, les symptômes de la maladie cœliaque sont nombreux : troubles gastro-intestinaux, douleurs abdominales, fatigue, carences, retard de croissance chez les enfants…
À plus long terme, la maladie peut également être à l’origine d’ostéoporose précoce, de troubles neurologiques, de problèmes d’infertilité, ou même dans de rares cas, de certains cancers du système digestif. Si aucun traitement médicamenteux n’existe, un régime strictement sans gluten permet de supprimer ces symptômes, mais il ne peut être suivi que sur avis médical. Il semble donc que ce genre de campagne permette d’améliorer la santé publique. Ainsi, l’Italie fait partie des pays les mieux adaptés à la maladie cœliaque en Europe. Selon une étude menée en 2024 par plusieurs chercheurs des universités de Brasilia, du Nouveau-Mexique ou de Paris Cité notamment, c’est même le pays qui assure la meilleure qualité de vie pour les intolérants. En effet, parmi un panel de douze pays dans le monde, l’Italie a obtenu le score le plus haut, devançant ainsi le Royaume-Uni puis l’Allemagne. La France, de son côté, est 4e.
L’adaptation du marché alimentaire
Parallèlement, les rayons sans gluten s’élargissent dans les supermarchés, et des enseignes spécialisées se développent. C’est notamment le cas de Celiachia Milano, une épicerie 100% sans gluten conventionnée avec la région Lombardie, située au cœur du quartier Nolo, fondée par un couple franco-italien il y a plus de 15 ans. « On a vu une évolution énorme dans la demande, et surtout un vaste choix de produits alors qu’avant il y en avait très peu, dont un panel particulier de références italiennes », constate Soso, la gérante de Celiachia Milano, originaire de Savoie. La spécialisation de l'enseigne dans le sans gluten permet une offre bien plus vaste et diversifiée que dans les supermarchés classiques. Les clients se succèdent, qu’ils soient intolérants ou non. « Pour les cœliaques, c’est facile, ils paient directement avec la tessera sanitaria [carte d’assurance maladie italienne] », explique Nicolas, propriétaire.
Une prise en charge facilitée
Car c’est là un autre aspect majeur qui distingue l’Italie et la France dans la gestion de la maladie cœliaque : la prise en charge des produits sans gluten. Ce contraste s’observe à plusieurs niveaux. D’abord, en termes de volume de prise en charge, l’Italie est bien mieux lottie. En effet, à travers tout le pays, une allocation mensuelle est allouée aux personnes cœliaques. Son montant varie en fonction de l’âge et du sexe du patient. Ainsi, en Lombardie, les enfants de 6 à 9 ans bénéficient de 70 euros par mois. Pour les filles de 10 à 13 ans, sont octroyés 90 euros mensuels, contre 100 euros pour les garçons du même âge. Ce montant augmente respectivement à 99 et 124 euros lorsqu’ils atteignent l’âge de 14 ans. Quant aux adultes de 18 à 59 ans, les femmes bénéficient de 90 euros mensuels, contre 110 euros pour les hommes. En France, en revanche, le remboursement des produits sans gluten est partiel et plafonné : il s’élève à 60 % dans la limite de 45,73 euros par mois pour les adultes, et 33,54 euros pour les enfants. On constate ainsi qu’au-delà du montant alloué, le système de prise en charge constitue une grande différence entre les deux pays. Si l’on peut directement payer avec la tessera sanitaria, équivalent de la carte vitale, en Italie, la France privilégie un système de remboursement. Les patients doivent donc scanner les produits achetés sur l’application Ameli, pour en demander le remboursement. C’est une démarche qui semble moins évidente, et qui semble ainsi compliquer le processus de prise en charge des aliments sans gluten.