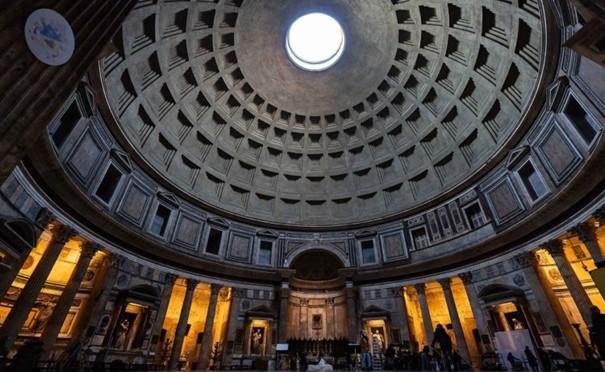Face au harcèlement sexuel, l’entreprise est tenue d’intervenir avec cohérence et diligence, en mettant en place des mesures efficaces de prévention, de sanction et d’accompagnement.


Le droit du travail ne se limite pas à réguler la relation d’emploi: il constitue aussi un instrument de protection de la personne, notamment face aux atteintes à sa dignité. Parmi celles-ci, le harcèlement sexuel occupe une place particulière. Il peut relever de la faute individuelle, mais il constitue, dans certaines conditions, une forme de discrimination fondée sur le sexe, avec des implications structurelles pour l’organisation du travail.
Cette assimilation repose sur l’idée que la répétition de comportements à connotation sexuelle, non désirés et liés au sexe de la personne visée, crée un environnement hostile, porte atteinte à l’égalité de traitement et exclut, même symboliquement, la victime d’un espace de travail sain.
Face à cette réalité, l’entreprise est tenue d’intervenir avec cohérence et diligence, en mettant en place des mesures efficaces de prévention, de sanction et d’accompagnement.
Ce devoir d’action proactive est au cœur de la responsabilité sociale et juridique des employeurs.
L’ordonnance n° 13748/2025 de la Cour de cassation italienne illustre parfaitement ce principe.
Elle constitue non seulement un exemple d’application symétrique du principe d’égalité (dans cette affaire, l’auteur des faits était une femme et la personne visée un homme), mais elle rappelle également que l’entreprise a l’obligation impérative d’intervenir rapidement et efficacement, non seulement pour sanctionner les faits, mais surtout pour prévenir leur survenue et protéger la dignité des salariées.
En l’occurrence, une salariée avait - à plusieurs reprises et en public - tenu à l’encontre d’un collègue masculin des propos à forte connotation sexuelle, provoquant un malaise manifeste qui a conduit ce dernier à éviter tout contact. La Cour a clairement qualifié ces faits de discrimination fondée sur le sexe, engageant ainsi la responsabilité de l’employeur.
La responsabilité de l’employeur dans la prévention du harcèlement sexuel en droit italien
L’ordonnance n° 13748/2025 de la Cour de cassation rappelle que tout comportement intrusif dans la sphère intime d’un salarié, notamment lorsqu’il est répété, non sollicité et exercé en présence de tiers, doit être apprécié à la lumière des droits inviolables consacrés par la Constitution italienne, notamment les articles 2 (droits inviolables de la personne), 3 (égalité sans distinction de sexe), 4 (travail comme expression de la personnalité humaine) et 35 (protection du travail sous toutes ses formes). Ce socle constitutionnel s’incarne dans les normes anti-discriminatoires destinées à prévenir et réprimer les comportements à caractère sexuel. Ainsi, l’article 26 du décret législatif n° 198/2006 qualifie de discriminatoires les actes indésirables liés au sexe, qui ont pour but ou effet d’atteindre la dignité du travailleur, en instaurant un climat intimidant, humiliant ou offensant. Dans sa décision, la Cour de cassation précise que « les employeurs sont tenus, conformément à l’article 2087 du Code civil italien, d’assurer des conditions de travail garantissant l’intégrité physique et morale ainsi que la dignité des travailleurs, notamment en concertation avec les organisations syndicales des travailleurs, en menant des actions d’information et de formation appropriées afin de prévenir le phénomène du harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Les entreprises, les syndicats, les employeurs ainsi que les salariés s’engagent à maintenir un environnement professionnel respectant la dignité de chacun et favorisant des relations interpersonnelles basées sur les principes d’égalité et de loyauté mutuelle. »
Cette formulation, souligne le devoir partagé et concret des acteurs du monde du travail dans la prévention du harcèlement. L’article 2087 du Code civil, donc, complète ce cadre en exigeant que les employeurs mettent en œuvre des conditions de travail protégeant l’intégrité physique et morale, ainsi que la dignité des salariés.
Cette obligation doit être menée en collaboration avec les organisations syndicales, notamment par des actions d’information et de formation adaptées à la prévention des violences sexuelles en milieu professionnel.
Enfin, la Cour de cassation souligne aussi l’importance des documents internes adoptés par l’entreprise, tels que les codes de conduite, qui ne sont pas de simples déclarations symboliques. Elle constate que dans l’affaire examinée, le comportement de la salariée violait manifestement le code de conduite de l’entreprise. Ce dernier engage concrètement l’employeur, qui doit assurer la cohérence entre les principes proclamés et la réaction effective face aux comportements contraires.
Et en France
Le droit français aussi adopte une posture rigoureuse en matière de prévention du harcèlement sexuel en entreprise, considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe, indépendamment du genre de l’auteur ou de la victime.
L’article L. 1153-1 du Code du travail interdit tout propos ou comportement à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’article L. 1132-1 qualifie expressément le harcèlement sexuel de discrimination, en conformité avec la directive 2006/54/CE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
L’obligation pour l’employeur de prévenir ces situations découle également des articles L. 1153-5 et L. 4121-1, qui imposent la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées, dans le cadre plus large de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés. Cette exigence s’est traduite en jurisprudence par une responsabilité de l’employeur indépendante de toute faute (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702). Dans cette optique, les entreprises doivent mettre en place une politique active, comprenant notamment l’adoption d’un code de conduite, des procédures internes de signalement, ainsi que des actions de formation et de sensibilisation. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 impose en outre la désignation d’un référent harcèlement sexuel dans les entreprises d’au moins 250 salariés (article L. 1153-5-1).
Ces obligations s’inscrivent dans une logique plus large de responsabilité sociale des entreprises, encadrée notamment par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, qui impose aux grandes entreprises un reporting extra-financier incluant les mesures prises pour prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales. Enfin, les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces dispositifs. Par la négociation collective, des accords d’entreprise ou de branche peuvent venir compléter les obligations légales en matière de prévention du harcèlement sexuel, en adaptant les mesures aux réalités spécifiques du secteur ou de l’organisation. Ce dialogue social constitue un levier fondamental pour ancrer durablement la prévention dans la culture de l’entreprise.
Conclusion
La responsabilité de l’entreprise dans la lutte contre le harcèlement sexuel dépasse la simple gestion des incidents après leur survenue. Elle implique une action préventive active et continue, fondée sur une compréhension claire que la prévention est un pilier essentiel du respect des droits fondamentaux au travail.
Attendre que des faits se produisent pour agir revient à négliger le rôle crucial que joue l’organisation du travail dans la création d’un environnement sain. Ainsi, les entreprises doivent intégrer la prévention au cœur de leur gouvernance, en développant des politiques claires, des formations adaptées et des dispositifs accessibles de signalement, garantissant la sécurité et la dignité de toutes et tous. Cette démarche proactive n’est pas seulement une obligation juridique, mais un levier stratégique pour préserver la cohésion interne, la motivation des salariés et la performance globale. En somme, la véritable responsabilité de l’entreprise réside dans sa capacité à anticiper, prévenir et traiter le harcèlement avant qu’il ne nuise à l’individu et au collectif, démontrant ainsi un engagement réel envers l’égalité et la dignité au travail.

Sur le même sujet