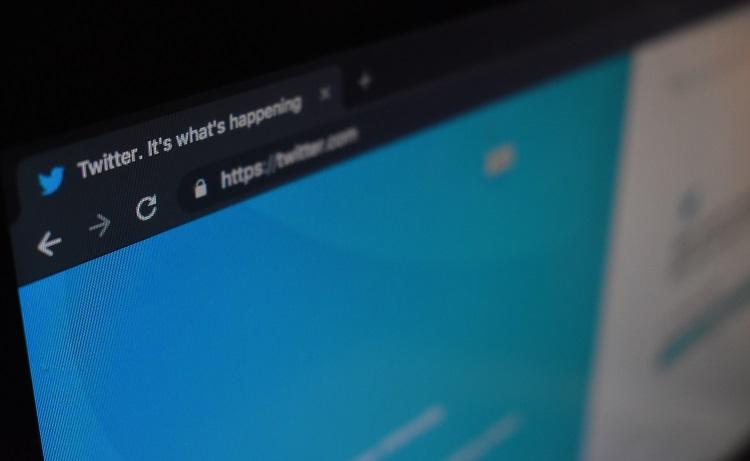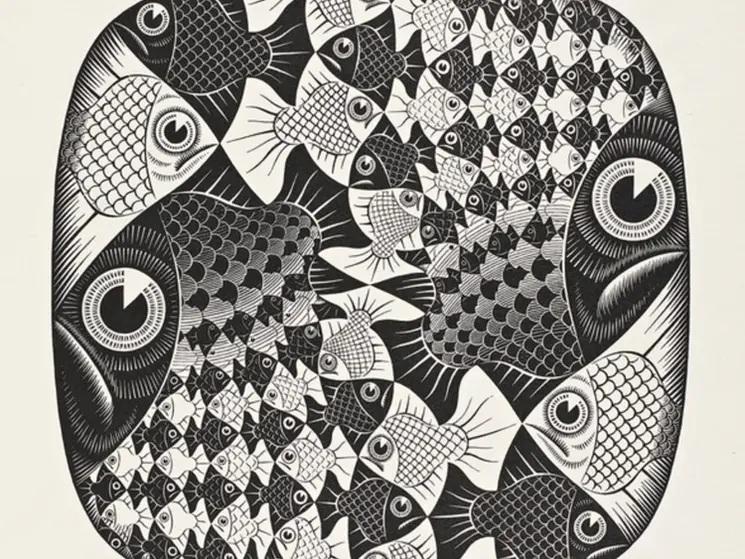L’utilisation des réseaux sociaux par les employés (Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp...), de plus en plus intensive, n’est pas dénuée de conséquences quant à leur relation de travail. Et l’utilisation d’un emoji peut parfois se révéler décisive.
Et le débat continue à évoluer avec une récente jurisprudence qui vient analyser l’utilisation d’émoticônes – ces images qui représentent l’expression d’émotions dans les discussions en ligne – afin de déterminer la validité d’un licenciement.
Aussi, le Tribunal de Parme a jugé le 7 janvier dernier (arrêt n°237) l’illégitimité d’un licenciement enjoint à une employée qui avait exprimé au cours de conversations avec des collègues, sur WhatsApp, des commentaires très négatifs à l’égard de son employeur. La chat était alors réservée aux collègues et donc dédié à l’échange d’informations relatives au travail. Après avoir appris ce qui s'était passé, l'entreprise avait jugé les infractions commises par la salariée, suffisamment graves pour justifier le licenciement pour un motif valable.
Selon le juge, si les commentaires étaient plutôt de mauvais goût, ils étaient espacés de plusieurs émoji et autres plaisanteries humoristiques, conférant à la conversation un ton plus informel, ce qui atténuait la portée offensive des messages. Le Tribunal a ainsi accepté la demande de la salariée qui revendiquait l'illégitimité du licenciement et a condamné l'entreprise au paiement d’une indemnité de six mois de salaire (le maximum prévu en l’espèce), ainsi qu’au remboursement des frais de justice.
Une jurisprudence amenée à s'adapter
Pour ce faire, le Tribunal a rappelé que les discussions en ligne, même si vulgaires et excessives, ne peuvent pas dans ce cas définir un comportement diffamatoire, compte tenu du fait qu’elles étaient intervenues dans le cadre d'une conversation privée, réservé à un petit groupe de personnes.
Par ailleurs, l’utilisation d’émoji a rendu le ton « plus taquin qu’offensif », selon le juge. L'usage fréquent d’émoticônes ou d’emoji dans le cadre de telles conversations ne permet pas de comprendre aisément « si certaines phrases étaient dites sérieusement ou exagérées, précisément en raison du contexte informel et amical de la conversation ».
En fin de compte, le juge a conclu que les commentaires de la salariée constituaient « une réaction subjective à des conditions de travail qui, à tort ou à raison, ne sont pas jugées satisfaisantes par la travailleuse et que le langage par lequel ils sont exprimés est celui désinvolte et vulgaire, caractéristique de la communication sur les réseaux sociaux ». Des propos qui ne peuvent donc être considérés comme diffamatoire mais qui relève plutôt de l’exercice légitime du droit de critique du travailleur.
Ce n'est pas le premier arrêt à prendre en compte les émoji. Une précédente décision du Tribunal de Rome (arrêt du 12 mars 2018, n. 1859), se référant au cas d'une employée qui se plaignait d'avoir subi des comportements vexatoires de la part de l'employeur, avait déjà souligné que l'utilisation des images affectueuses de la part de ce dernier traduisait « une relation de familiarité et de courtoisie » entre eux et certainement pas une condition de crainte et de malaise psychologique de la salariée.
La même employée avait ensuite envoyé un émoji à l’employeur avec le symbole d’un bisou, ce qui, selon le Tribunal montrait bien qu’il existait sur le lieu de travail « un climat de sérénité et de collaboration », excluant ainsi l’existence des comportements vexatoires dénoncés par la plaignante.
Au fur et à mesure, la jurisprudence est amenée à s’adapter à l'évolution des coutumes et des méthodes d'interaction établies à travers les réseaux sociaux. L'utilisation d'émoticônes ou emoji dans une conversation en ligne est considérée comme preuve ou élément utile pour les juges, amenés à évaluer le ton de la conversation. Un émoticône peut donc être décisif pour déterminer l’issue d’un procès.
Sur le même sujet