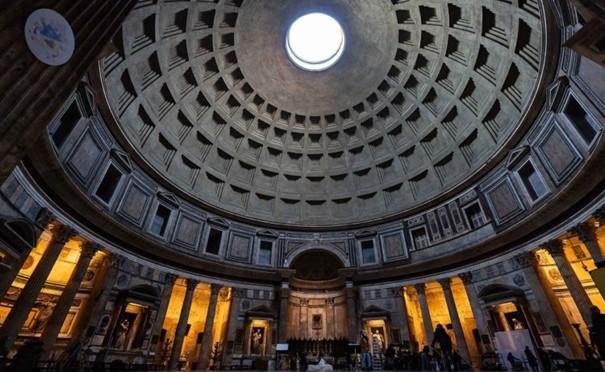Le 14 mai 2025, l’Italie a franchi une étape historique avec l’adoption définitive du projet de loi n°1407, qui introduit un cadre complet pour la participation des travailleurs à la vie des entreprises. Ce texte donne enfin application à l’article 46 de la Constitution italienne, resté en attente pendant près de 80 ans.


Le 14 mai 2025, l’Italie a franchi une étape historique avec l’adoption définitive du projet de loi n°1407, qui introduit un cadre complet pour la participation des travailleurs à la vie des entreprises. Ce texte donne enfin application à l’article 46 de la Constitution italienne, resté en attente pendant près de 80 ans. Cet article dispose que:
« Aux fins de l’élévation économique et sociale du travail, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, dans les formes et dans les limites fixées par la loi, à la gestion des entreprises. »
Cette disposition, inscrite dans la partie des principes fondamentaux de la Constitution, affirme une vision démocratique du travail, dans laquelle les salariés ne sont pas de simples exécutants, mais des acteurs des choix économiques et organisationnels et donc le DDL 1407 transforme cette préconisation constitutionnelle en instruments concrets.
Une participation pensée comme un système vivant
Ce qui fait la force et l’originalité de la loi italienne réside dans son approche systémique de la participation. Loin de se limiter à un seul aspect, elle tisse une trame cohérente entre différents niveaux d’implication des travailleurs dans la vie de l’entreprise: la gouvernance, les résultats, l’organisation du travail et les processus décisionnels. Chacune de ces dimensions, bien que distincte, renforce les autres, dessinant un modèle d’entreprise plus inclusif, plus équilibré et plus durable.
Au sommet de cette architecture, la participation à la gestion permet aux salariés de prendre part aux choix stratégiques. En fonction de la structure de l’entreprise (dualiste, traditionnelle ou moniste) les statuts peuvent intégrer, à travers la négociation collective, la présence de représentants des travailleurs dans les conseils de surveillance ou d’administration. Ces représentants, soumis à des critères stricts d’indépendance et de compétence, ne sont pas des observateurs mais des acteurs à part entière de la gouvernance, capables de porter la voix du travail au cœur des décisions.
Création de commissions paritaires internes
Mais cette implication dans la direction ne prend tout son sens que si elle est accompagnée d’une reconnaissance du rôle productif et économique des salariés. C’est là qu’intervient la participation financière, qui repose sur un principe simple: ceux qui contribuent à la création de richesse doivent pouvoir en partager les fruits. Par la distribution d’une part des bénéfices ou par l’accès à des formes d’actionnariat salarié, la loi entend encourager une nouvelle alliance entre performance et cohésion sociale, où l’implication ne se mesure plus seulement en productivité, mais aussi en responsabilité partagée. Cette logique de co-construction s’étend à l’organisation même du travail. En prévoyant la création de commissions paritaires internes, composées à égalité de représentants des employeurs et des travailleurs, la loi met en place un espace permanent de dialogue et de proposition. Ces commissions peuvent intervenir sur des sujets très concrets - amélioration des processus, bien-être au travail, égalité, inclusion, parentalité - et contribuent à ancrer la participation dans le quotidien de l’entreprise.
Enfin, pour que cette dynamique participative ne soit pas cantonnée à l’initiative des directions ou à la bonne volonté des partenaires sociaux, la loi instaure un droit formel à la consultation. Lorsqu’une décision importante est envisagée, les représentants des salariés doivent être saisis en amont, dans un cadre précis et avec des délais stricts. L’employeur est tenu de répondre, de motiver ses choix et, le cas échéant, d’expliquer pourquoi il n’a pas suivi les recommandations. Ce droit à la consultation renforce la transparence, prévient les conflits et installe une culture du débat structuré.
Toute cette architecture repose sur un principe fondamental : la participation ne doit pas être imposée, mais construite. C’est pourquoi la loi mise résolument sur la négociation collective comme moteur principal. Les accords, qu’ils soient d’entreprise, territoriaux ou sectoriels, sont appelés à adapter les outils participatifs à la réalité du terrain. Pour garantir leur efficacité, une formation annuelle des représentants est prévue, financée par les dispositifs existants, afin de renforcer les compétences nécessaires à l’exercice de ces nouvelles responsabilités.
Pour assurer le suivi, la transparence et l’évolution continue du dispositif, la loi crée enfin une Commission nationale permanente auprès du CNEL, le Conseil national de l’économie et du travail. Cette instance, pluraliste et paritaire, est chargée d’évaluer l’application de la loi, de produire des recommandations, de publier des rapports réguliers et de servir de référence en cas de litige.
Le modèle français
En France, le principe de participation des travailleurs repose sur un ensemble de dispositifs différenciés. On y distingue classiquement trois formes de participation : à la gouvernance, aux résultats de l’entreprise, et à la vie sociale et organisationnelle du travail.
La participation à la gouvernance a connu un tournant avec la loi PACTE de 2019, qui impose aux grandes entreprises la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance. Cette obligation, qui concerne les entreprises de plus de 1000 salariés en France ou de plus de 5000 au niveau mondial, vise à assurer une meilleure prise en compte des enjeux humains dans la stratégie d’entreprise, sans pour autant remettre en cause le pouvoir décisionnel des actionnaires.
La participation économique, quant à elle, est encadrée par le Code du travail, qui distingue deux instruments majeurs : la participation aux résultats (obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés) et l’intéressement (facultatif, mais largement encouragé). Ces dispositifs, bien que souvent perçus comme des outils de motivation ou de fidélisation, traduisent une volonté de reconnaître la contribution directe des travailleurs à la performance économique. Ils s’accompagnent de régimes fiscaux avantageux et peuvent être articulés avec l’actionnariat salarié, également très développé dans certaines entreprises françaises.
Enfin, la participation organisationnelle et consultative repose sur l’existence du Comité Social et Économique (CSE), instauré par l’ordonnance de 1386 du 2017, qui fusionne les anciennes instances représentatives du personnel. Le CSE est obligatoire à partir de 11 salariés et voit ses compétences s’élargir considérablement dès 50 salariés. Il joue un rôle central dans le dialogue social, en étant consulté sur toutes les décisions importantes liées à la santé, à la sécurité, à la formation, au temps de travail ou aux restructurations. Il dispose aussi de moyens propres - budget de fonctionnement, droit d’alerte, possibilité de recourir à des experts - qui en font un véritable organe d’équilibre au sein de l’entreprise.
Vers une gouvernance plus équitable à l’ère de l’IA
Les mécanismes mis en place en Italie comme en France s’inscrivent dans une époque de grands bouleversements technologiques, sociaux et environnementaux. La généralisation de l’intelligence artificielle dans les entreprises transforme le travail, mais aussi les relations de pouvoir et d’information. Face à l’asymétrie croissante des savoirs, il devient crucial d’associer les travailleurs à la conception et à l’évaluation des outils qui redessinent leur quotidien. De même, la participation est un outil central pour gérer les transitions environnementales de manière proactive : elle permet d’intégrer les enjeux de santé, d’inclusion, de longévité professionnelle dans les stratégies de durabilité. Des dispositifs comme les référents sociaux prévus par la loi italienne ou les comités sociaux et économiques en France semblent incarner cette volonté de lier transition écologique et justice sociale, en ancrant le changement dans la réalité humaine du travail.

Sur le même sujet