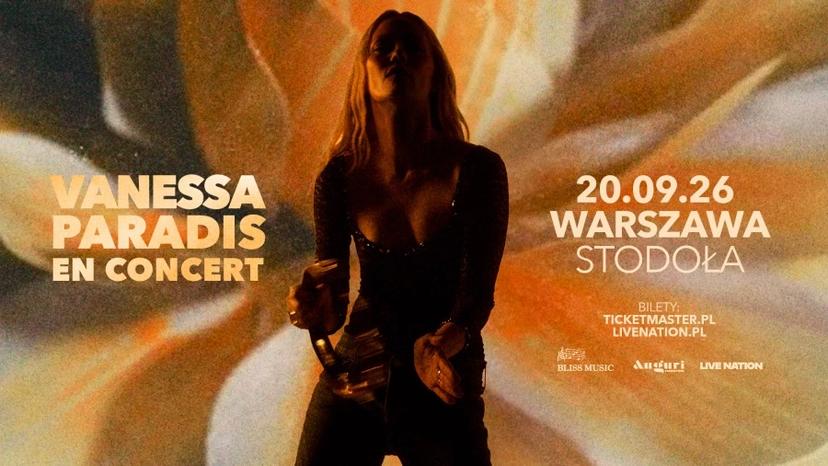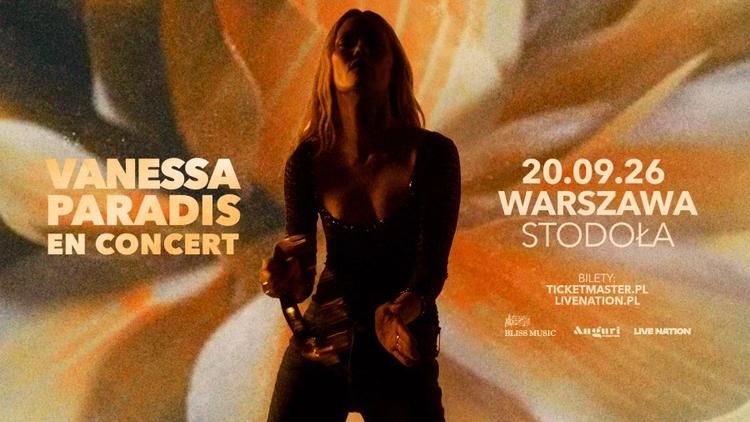La question palestinienne est plus que jamais au cœur de l’actualité depuis les événements qui ont suivi le 7 octobre 2023. En France, cette question cristallise tensions identitaires, mémoire coloniale et fractures politiques, où chaque déclaration est sujette à polémique et à des attaques politiques. Du côté de la Pologne - qui a reconnu l’État palestinien en 1988, c’est une autre Histoire, sans passé colonial, mais avec un génocide, perpétré sur ses terres occupées, massacrant 4 millions de personnes, dont une grande majorité de Juifs. La Pologne se distingue aujourd’hui par l’équilibre, entre soutien historique à la solution à deux États et engagements internationaux, tout en naviguant dans des relations diplomatiques complexes avec Israël ainsi qu’en répondant aux préoccupations de sa société civile. Retour sur ce parcours, depuis 1947, quand l'URSS soutient le plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU.


La Pologne, une reconnaissance, dès le début, de l'État palestinien
L’État de Palestine n’est reconnu que par 12 des 27 États membres de l’Union européenne, la Pologne en faisant partie, voici l’histoire des relations polono-palestiniennes, mais, pour bien en comprendre les rouages, partons tout d’abord en URSS.
En 1947, au début de la Guerre froide, l'URSS soutient le plan de partage de la région de Palestine proposé par l'ONU, espérant affaiblir ainsi l'influence britannique au Moyen-Orient. L’URSS a été l'une des premières puissances à reconnaître l'État d'Israël et à lui fournir des armes via l’un des pays satellites du bloc soviétique, la Tchécoslovaquie. Cependant, les relations se sont rapidement détériorées en raison de l'orientation pro-occidentale d'Israël et de la répression des mouvements communistes en son sein.
💡 1948 : déclaration d'indépendance de l’État d’Israël
- Le 14 mai 1948, à 14 heures, heure locale (Tel-Aviv), c’est David Ben Gourion, président du Conseil national juif et futur Premier ministre du pays, qui prononce la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël au musée de Tel-Aviv, quelques heures avant l’expiration du mandat britannique sur la région de la Palestine.
- Cette déclaration fait suite au plan de partage voté par l’ONU le 29 novembre 1947, qui prévoyait la création de deux États, l’un juif et l’autre arabe, avec un statut international pour la ville de Jérusalem.
- Israël est reconnu de facto par les États-Unis quelques minutes après sa proclamation, puis par l’URSS le 17 mai 1948.
- Le 11 mai 1949, l’État hébreu est admis comme membre à part entière des Nations unies.
Dès les années 1950, changement de cap, l'URSS réoriente sa politique en soutenant les pays arabes, dont l'Égypte de Nasser, pour contrer l'influence occidentale et promouvoir ses intérêts stratégiques dans la région. Ce soutien s'est intensifié après la guerre des Six Jours en 1967, avec une assistance militaire et économique accrue aux nations arabes.
Conformément à la politique soviétique de l'époque, la Pologne a reconnu Israël le 19 mai 1948 et a établi des relations diplomatiques officielles avec le nouvel État. En septembre 1948, Israël a ouvert une mission diplomatique à Varsovie, marquant ainsi le début des relations diplomatiques entre les deux pays.
Cependant, ces relations ont été interrompues en juin 1967, lorsque la République populaire de Pologne - Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL de 1952 à 1989), alors État satellite de l’Union soviétique, et suivant la position de celle-ci, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël à la suite de la guerre des Six Jours.
Les contacts officiels de la Pologne avec la Palestine remontent au milieu des années 1970, lorsque le bureau de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été établi à Varsovie.
De plus, le bloc de l’Est soutenait une paix durable au Moyen-Orient par la réalisation des aspirations nationales de la Palestine. L’autodétermination du peuple palestinien semblait une étape obligatoire pour une stabilité continue dans cette zone géographique. Cette position s’inscrivait également dans une stratégie allant à l’encontre d’Israël, considéré comme allié des États-Unis et de l’Occident.
- 1982 marque le début des relations diplomatiques entre la région de la Palestine et la Pologne. Pour comprendre la reconnaissance concrète de l’État palestinien, il faut se re plonger en juillet 1982. Ce mois a marqué le début des relations diplomatiques entre la PRL et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).
- En 1988, l’OLP devient l’État de Palestine par « l’Acte de proclamation de l’État palestinien », reconnu par la République populaire de Pologne.
- Puis, en 1989, l’Ambassade de l’État palestinien a été créée à Varsovie.
- En janvier 2005, le Bureau du Représentant de la République de Pologne auprès de l’Autorité nationale palestinienne a été ouvert à Ramallah.
- En janvier 2012, le consulat honoraire de la République de Pologne a été établi à Bethléem.
Sur le site du gouvernement polonais, on peut lire actuellement que « La Pologne soutient le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et ses aspirations à un État indépendant en tant que résultat final du processus de paix au Moyen-Orient ».
💡 Du 14 mai 1948 au 7 octobre 2023, retour sur 75 ans de conflits
- 14 mai 1948 : L'État d’Israël est proclamé, après que l’ONU ait procédé au partage de la région de la Palestine entre un État juif et un État arabe.
- Le 15 mai 1948, les armées de cinq États arabes — l’Égypte, la Transjordanie (aujourd’hui Jordanie), la Syrie, le Liban et l’Irak — interviennent militairement en Palestine, déclenchant ainsi la première guerre israélo-arabe.
- À l’issue du premier conflit israélo-arabe de 1948, les forces armées israéliennes consolident leur emprise sur près de 78 % du territoire de la Palestine sous mandat britannique, bien au-delà des frontières prévues par le plan de partage de l’ONU. Cette avancée militaire, ponctuée de combats, d’exodes forcés et d’opérations de nettoyage des zones conquises, provoque le déracinement de milliers de Palestiniens.
- Cet épisode fondateur, désigné sous le terme de Nakba, « catastrophe » en arabe, marque le début d’un exil prolongé, au cœur du conflit israélo-palestinien.
- Selon les rapports de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine), entre 800.000 et 900.000 réfugiés sont enregistrés.
- 1967 : Israël remporte la guerre des Six Jours, conquérant des territoires comme Jérusalem-Est, la Bande de Gaza ou la Cisjordanie.
- 1987 : Éclatement de l’Intifada, mouvement de révolte à Gaza et en Cisjordanie pour tenter d’arrêter l’occupation d’Israël et créer un État palestinien libre et indépendant. Intifada est un mot arabe qui signifie « soulèvement » .
- 1993 : Les accords d’Oslo sont une lueur d’espoir, de paix, mais seront rapidement rejetés par les deux entités.
- 1995 : Les efforts de paix sont définitivement mis à mal lorsqu’un étudiant juif religieux d'extrême droite assassine Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien.
- 2006 : Le Hamas remporte les élections législatives.
- 2009 : Arrivée au pouvoir de la coalition de droite israélienne conduite par Benyamin Netanyahou.
- Attaques du 7 octobre 2023 : Assaut massif lancé par le Hamas, depuis Gaza, contre Israël.
Les accords de paix entre Israël et la Palestine, les accords d’Oslo, un espoir de courte durée
Signés en 1993, les accords d’Oslo actent une reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP, en parallèle de la mise en place de négociations bilatérales.
Sous l'égide étasunienne de Bill Clinton, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat échangent une poignée de main historique.
💡 Les principaux points des Accords d'Oslo
- Reconnaissance mutuelle des deux États
- Création d'une Autorité palestinienne intérimaire
- Retrait israélien progressif des territoires occupés
- Division des territoires en zones : A,B,C
- Négociations sur le statut final : les deux États s’engagent à entamer des négociations sur des questions clés, telles que Jérusalem, les réfugiés, les colonies, la sécurité et les frontières, dans un délai de cinq ans
- L'accord Gaza-Jéricho (1994)
- Signature d'un accord détaillant l'autonomie palestinienne dans la bande de Gaza et la région de Jéricho.
- En 1995 est acté un découpage des territoires palestiniens en trois zones A,B,C où les contrôles sont répartis entre autorités palestiniennes et israéliennes.
Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin prend part à un rassemblement pour la paix où il prononce un discours en faveur des accords d'Oslo et du processus de paix israélo-palestinien. À la fin de son intervention, il est assassiné par un étudiant israélien d'extrême droite, qui purge une peine de prison à perpétuité.
Les accords d’Oslo sont définitivement compromis.

Une reconnaissance en 1988 par la Pologne mais une coopération entravée avec l'État palestinien
Suite à la reconnaissance de l’État palestinien en 1988 par la République populaire de Pologne, de nombreuses formes de coopérations ont vu le jour :
La coopération politique fut l’une des premières à émerger. Les relations bilatérales ont été amicales, avec de nombreuses visites présidentielles à Bethléem comme à Varsovie.
Un dialogue politique avec des ouvertures diplomatiques est né, sur le développement du tourisme, entre autres. Les Polonais sont parmi les nationalités qui visitent le plus le territoire palestinien.
La coopération économique est néanmoins compliquée, par le statut du territoire palestinien, territoire occupé.
Quant à la coopération politique, elle se retrouve notamment dans les relations culturelles : la République de Pologne soutient l’Académie de musique de Bethléem ainsi que la Société Chopin palestinienne.
Ces relations ont changé après les attaques du 7 octobre 2023 : la zone, cible d’attaques incessantes, est aujourd’hui au cœur des préoccupations des ONG, qui alertent sur les conditions de survie des Palestiniens.
Mort d’un volontaire polonais causée par un tir de roquette israélienne dans la bande de Gaza en 2024
Les relations diplomatiques polono-palestiniennes et polono-israéliennes ont fait face à de nombreux obstacles. La mort en avril 2024 d’un volontaire polonais, Damian Soból, tué par un tir de roquette israélienne dans la bande de Gaza alors qu’il acheminait de la nourriture pour l’organisation humanitaire “World Central Kitchen”, « La Cuisine Mondiale Centrale ».
La Pologne est sous le choc face aux mots brutaux de Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien très contesté pour ses prises de position radicales, déclarant que « cela arrive en temps de guerre ». Un vrai coup de froid diplomatique !
Une roquette israélienne tue 7 humanitaires à Gaza, dont un Polonais : témoignage
💡 Quelles ONG polonaises sont actives en Palestine ?
- Polska Akcja Humanitaria (PAH) - Action Humanitaire Polonaise
PAH intervient dans les territoires palestiniens, fournissant de la nourriture, de l’eau ainsi que des soins médicaux.
Site internet
- Polish Center for International Aid (PCPM) - Centre Polonais d’Aide Internationale
Cette organisation a fourni une aide d’urgence à Gaza, notamment avec des kits de premiers secours et du lait en poudre.
Site internet
- Polska Misja Medyczna (PMM) – Mission Médicale Polonaise
« Nous apportons une aide médicale et humanitaire aux civils. À ce jour, nous avons fourni du matériel médical, des vêtements et du lait maternisé. Nous collaborons avec des organisations locales, et les médecins jordaniens que nous finançons sont de garde dans un hôpital de Deir al-Balah. »
Site internet
Commémoration des 80 ans de la découverte d’Auschwitz-Birkenau et possible venue de Benyamin Netanyahou : enjeux de mémoire contre mandat d’arrêt international
Ce mois de janvier 2025, alors que l’État polonais préparait la commémoration du 80e anniversaire de la découverte par les soldats soviétiques de la soixantième armée, des camps d’extermination allemands d’Auschwitz-Birkenau, une polémique a grondé lorsque le gouvernement polonais, par le biais d'une résolution, a assuré « un accès libre et sûr » aux responsables israéliens.
Cette résolution a été adoptée après l’émission des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, par la Cour pénale internationale. Le Premier ministre est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
De son côté, le Premier ministre polonais Donald Tusk avait déclaré : « D’un côté, on a le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, et, de l’autre, il est évident, pour moi, depuis le début, que le Premier ministre israélien, ou n’importe quel autre représentant d’Israël, a le droit de visiter le camp de concentration d’Auschwitz en toute sécurité, surtout lors des commémorations ».
C'est finalement Yoav KischI, ministre de l'Éducation qui a représenté l’État d’Israël, le 27 janvier 2025 à Auschwitz-Birkenau.
Néanmoins, cette décision du gouvernement polonais, entre devoir de mémoire et actualité, prise avant que l’on sache si Benyamin Netanyahou ferait le déplacement en Pologne ou pas, a non seulement fragilisé la relation polono-palestinienne, mais a placé la Pologne dans une situation délicate au sein de l’Union européenne, cette « porte ouverte » au dirigeant israélien ressemblant à un pied de nez au Statut de Rome.
Il y a 80 ans, découverte des camps d’extermination allemands d’Auschwitz -Birkenau
Comment la Pologne arrive-t-elle à maintenir des relations diplomatiques avec Israël et la Palestine, même si c’est très compliqué ?
Aujourd’hui plus que jamais, le conflit israélo-palestinien se place au centre des préoccupations internationales. La Pologne réaffirme son soutien à la solution à deux États, mais seule elle ne pourra faire toute la différence.
Deux états, c’est la solution que proposait en mai 2024, Radosław Sikorski (Plateforme civique - PO), eurodéputé polonais, à l’époque ministre des Affaires étrangères. Un compromis qui s’aligne sur l’ensemble des axes diplomatiques pris depuis l’éclatement de ce conflit. Radosław Sikorski a également réaffirmé la reconnaissance du statut de l’État palestinien, en rappelant le vote de la Pologne en faveur de l’adhésion de l'État de Palestine à l’ONU. Il précise cependant que ce n’était un vote contre personne.
Dans un contexte tendu et souvent hystérisé autour du conflit israélo-palestinien, la Pologne tire son épingle du jeu, en maintenant des relations à peu près stables avec Israël au nom du passé, et avec l’État palestinien au nom du droit international, mais jusqu’à quand : l’élection du nationaliste Karol Nawrocki, accusé également de révisionnisme pourrait rebattre les cartes.
Un article de Camille Poletto-Weber, avec Bénédicte Mezeix-Rytwiński et Annwenn Levêque initialement publié le 15/06/2025
📲💻 Pour rester informés du lundi au dimanche, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite !
💡 Soutenez votre édition | lepetitjournal.com Varsovie
↪ Lepetitjournal.com est un média quotidien, 100% en ligne, que nous avons choisi de rendre accessible à tous, gratuitement. Mais l’indépendance, la rigueur et l’originalité ont un coût.
↪ Chaque édition locale Lepetitjournal.com est indépendamment financée par des annonceurs, sans jamais céder sur son autonomie : la rédaction reste souveraine dans ses choix éditoriaux.
↪ Grâce à votre fidélité, Lepetitjournal.com Varsovie est dans le top 15 des éditions les plus lues en termes d'audience sur les plus de 70, présentes à travers le monde.
↪ En nous soutenant, même modestement - à partir de 5 €, vous nous aidez dans nos missions quotidiennes, contribuez à nous développer et garantissez la pérennité du média.
🎯 Lepetitjournal.com Varsovie fêtera en 2026, 20 ans de rayonnement en Pologne ainsi qu'à l'international : un cap symbolique que nous franchirons, ensemble !
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, LinkedIn
Sur le même sujet