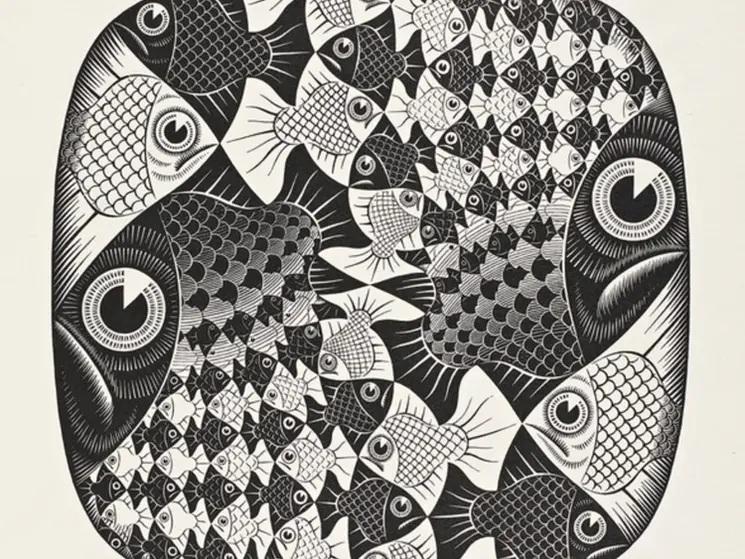Les chiffres du rapport annuel de l’ISPRA confirment la tendance à la baisse de la pollution en Italie, notamment concernant la présence de particules fines dans l’air. La situation reste malgré tout loin des objectifs à atteindre à l’horizon 2030.


Dans son rapport annuel sur la qualité de l’air en Italie pour l’année 2024, publié le 11 mars dernier, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) note une amélioration significative concernant l’ensemble du pays. L’étude, basée sur des relevés quotidiens effectués dans 343 stations d’observation réparties dans l’ensemble de la botte, se concentre sur la présence de quatre polluants dans l’air : les particules fines PM2.5 et PM10 — correspondant respectivement à des particules de 2.5 et 10 micromètres de diamètre — le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3). L’amélioration de la qualité de l’air concerne en particulier les PM2.5, PM10 et l’azote dont les concentrations moyennes annuelles respectent majoritairement les seuils fixés, en revanche la concentration en ozone reste très irrégulière, dépassant dans une large mesure les limites nationales.
Des résultats majoritairement positifs
La plus grande victoire concerne la présence de PM2.5 dans l’air qui, pour la première fois, respecte la limite moyenne annuelle (25 μg/m3) dans tous les centres d’observations, bien que certaines régions demeurent particulièrement proches du seuil, en particulier la plaine du Pô. Ces résultats constituent une grande avancée par rapport aux quatre années précédentes où les chiffres étaient restés entre 3 et 4 points au-dessus des seuils prescrits. Sur le plus long terme, le rapport évoque une baisse tendancielle de la présence de particules fines dans l’air. Cette tendance s’étend aux particules PM10 qui respectent les seuils moyens annuels (40 μg/m3), confirmant les résultats déjà observés les cinq années précédentes. Une unique exception est observée pour la ville de Palerme, mais cela s’explique par l’arrivée de sables désertiques. Autre amélioration tendancielle : le rapport relève des taux annuels moyens de dioxyde d’azote décroissant par rapport aux dix dernières années et en deçà des seuils limites prescrits dans toutes les zones observées, pour atteindre une baisse annuelle moyenne significative s’élevant à 3.5%.
Des points qui demeurent critiques
Malgré ces résultats très positifs, certains polluants persistent bien au-delà des normes nationales. C’est le cas de l’ozone, qui n’a respecté les seuils que dans 16 % des cas observés, soit 55 stations sur les 343 au total. Nocive pour les humains, les animaux et les plantes, une trop forte concentration de l’air en ozone peut être à l’origine de problèmes pulmonaires et respiratoires. Sur les dix dernières années, aucune tendance claire ne se dessine, le rapport évoque des “fluctuations saisonnières” des niveaux d’ozone observés. Autre bémol, pour beaucoup de polluants, si les seuils nationaux annuels sont respectés, les seuils journaliers ou par région, ne le sont pas systématiquement. C’est notamment le cas pour les particules fines PM10 et l’ozone estival qui dépasse fréquemment les limites journalières. Notons également que, malgré une baisse tendancielle par rapport aux années 2010 des taux de PM10 dans l’air, une stagnation semble s’installer sur les cinq dernières années. Concernant le dioxyde d’azote, si les moyennes nationales sont encourageantes, les taux sont dépassés dans plusieurs régions, notamment aux abords des grandes villes et axes routiers : dans l’agglomération de Milan et aux abords de Turin, Gênes, Rome, Naples, Catane et Palerme.
Des efforts à maintenir
Le rapport précise que le caractère majoritairement positif des résultats s’explique corrélativement aux seuils nationaux fixés. Or, il est important de remarquer que les chiffres observés sont encore loin de respecter les nouvelles limites qui entreront en vigueur à l’horizon 2030. Loin également des seuils — encore plus bas — recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Sur le même sujet