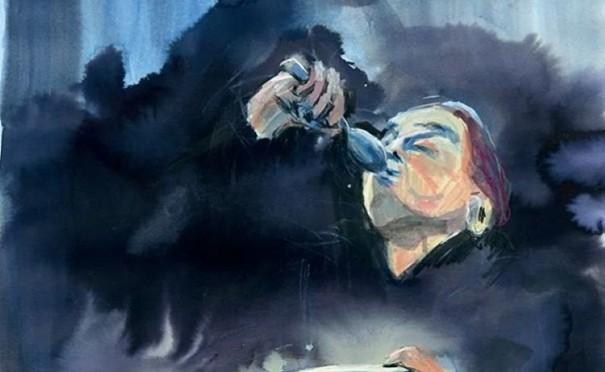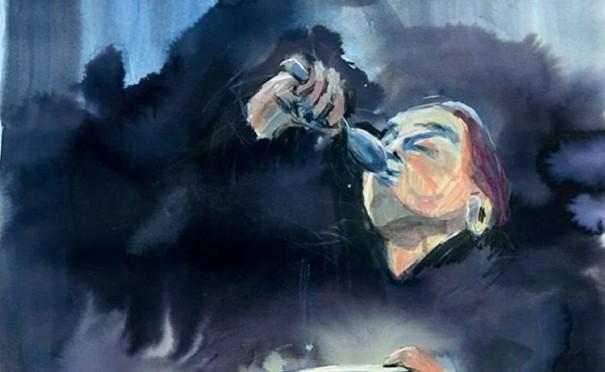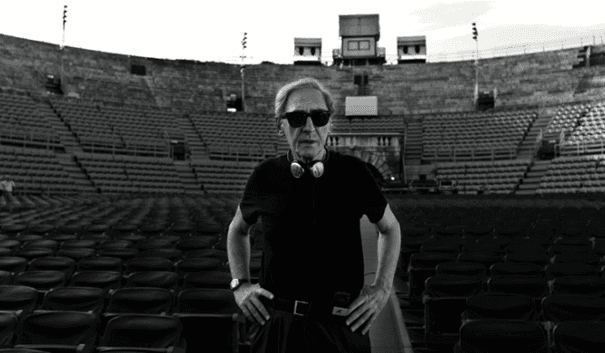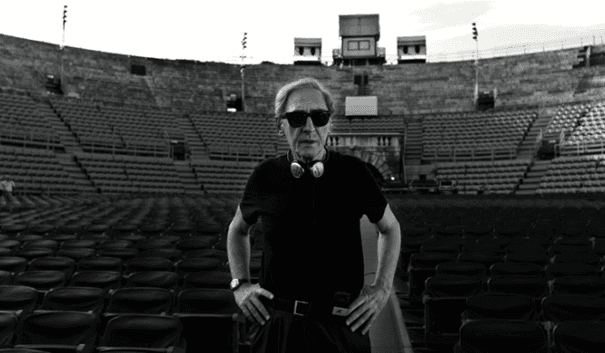En Italie la relation de travail des journalistes peut être définie comme une relation « spéciale » par rapport aux autres relations de travail.


L’activité de journaliste en Italie présente un certain nombre de spécificités, comme l’inscription obligatoire au registre professionnel des journalistes de la part du journaliste professionnel, qui exerce son activité de manière exclusive et continue, l’existence d’une loi ad hoc qui règlemente les modalités d’exercice de l’activité journalistique, c’est-à-dire la loi du 3 février 1963, n. 69 (en Italien « legge professionale »), l’exemption pour les journalistes de la semaine normale de travail de 40 heures, qui s'applique, en revanche, à tous les salariés etc.
Dans cet article, nous allons tout d’abord analyser la notion de « journalisme » fournie par la jurisprudence, en l’absence d’une définition législative, pour ensuite voir si la relation de travail des journalistes est qualifiée comme une relation autonome ou subordonnée et enfin faire un récapitulatif sur les principales spécificités qui caractérisent cette relation de travail, à la lumière de la Convention collective nationale des journalistes en vigueur en Italie (III).
Qu’entend pour « journalisme » ?
Dans le cadre du travail journalistique ni la loi professionnelle n° 69 de 1963 ni la Convention collective nationale italienne des journalistes (CCNL Giornalisti) ne définissent le contenu de l'activité journalistique ou du journalisme.
Pour combler cette lacune, la jurisprudence est intervenue, à travers l’élaboration d’une notion élastique de journalisme.
Ces précisions faites, la jurisprudence établie affirme que l’activité journalistique doit être entendue comme « l’accomplissement d’une prestation intellectuelle visant à collecter, commenter et traiter des informations destinées à faire l'objet d'une communication interpersonnelle à travers les médias (c’est-à-dire les journaux, les agences de presse, les stations de radio et de télévision et, plus généralement, tout instrument propre à assurer la diffusion de l'information, qu’il soit l'écrit, l'oral, le graphisme ou l'image), dans lequel le journaliste agit comme un médiateur intellectuel entre le fait et la diffusion de sa connaissance » (ex multis, Tribunal de Milan, 25 septembre 2023, n. 3010 ; Cour d’appel de Rome, n. 2178 de 2021 ; Cour de Cassation, chambre sociale, 20 février 1995, n. 1827 ; Cour de Cassation, Sections Unies, n. 1867 de 2020).
Comme il a été précisé par le Tribunal de Milan, « l’activité journalistique est une activité complexe et articulée qui, à partir d’un fait brut et actuel, à travers un travail typiquement intellectuel et créatif ou critique, l'élabore en nouvelles à soumettre à l'attention du public. Le travail d'élaboration consiste donc non seulement à rédiger l'article, mais aussi à concevoir les titres, les légendes, le positionnement de l'article dans les pages et le choix des images qui peuvent l'accompagner… » (Tribunal de Milan, arrêt du 2 mars 1995).
L’élément essentiel qui permet de caractériser l’activité journalistique est la créativité, c’est-à-dire la contribution personnelle et inventive apportée par le journaliste au fait « nu ».
En fait, le journaliste doit apporter sa pensée (entendue comme ses idées, sa culture et sensibilité), avec laquelle il perçoit et interprète ainsi qu'évalue le fait, en transmettant un message également avec sa propre contribution créative (Cour de Cassation, arrêt du 12 mars 2004, n° 5162 ; Cour d’appel de Rome, n. 2178 de 2021).
À cet égard, l’activité accomplie par l'opérateur de télécinéma-photo, qui, en effectuant en toute autonomie opérationnelle la prise de vue d’images, ne participe pas ensuite, en position d'autonomie décisionnelle, à la sélection, au montage et, en général, au traitement du matériel filmé ou photographié, afin d'acquérir la capacité informative du matériel lui-même, n’a pas été qualifiée comme une « activité journalistique » (Cour de Cassation, arrêt du 16 janvier 1993 n° 536 ; Cour de Cassation, arrêt du 11 septembre 2009, n° 19681).
L’activité journalistique : autonome ou subordonnée ?
L’activité journalistique peut être exercée soit de façon autonome soit de façon subordonnée.
Dans cette dernière hypothèse, on parle d’une « subordination atténuée », en considération de la créativité et de l'autonomie particulière qualifiant l’activité journalistique, ainsi que de la nature purement intellectuelle de l'activité elle-même.
Selon la jurisprudence, pour identifier le lien de subordination – et donc qualifier l’activité journalistique comme une relation de travail subordonnée – l’élément qui relève est l'inclusion continue et organique de la prestation journalistique dans l'organisation de l'entreprise (ex multis, Cour de Cassation n° 24078 de 2021 ; Cour de Cassation arrêt du 3 mai 2017, n. 10685 ; Cour de Cassation, arrêt du 7 octobre 2013, n. 22785).
En d’autres termes, l’élément qui permet de caractériser la subordination dans le travail journalistique est représenté par « l'insertion stable du service rendu par le journaliste dans l'organisation de l'entreprise en ce sens que, par ce service, l'employeur assure de manière stable, ou du moins pendant une période appréciable, la satisfaction d'un besoin d'information du journal par la compilation systématique d'articles sur des sujets déterminés et exige donc, à ce titre, la disponibilité continue du journaliste, même dans l'intervalle d'un service à l'autre. » (Cour de Cassation, chambre sociale, n. 8068 de 2009).
Également, si le journaliste assume l’obligation de traiter de façon continue un sujet particulier ou un secteur d’information et met à disposition sa prestation de travail de façon permanente, en suivant les directives reçues de la part de son employeur, il peut se qualifier comme un travailleur « subordonné » (Cour de Cassation, chambre sociale n. 6727 de 2001) ou s’il se met à disposition de l’éditeur, afin d’exécuter ses instructions (Cour de Cassation, chambre sociale, n. 18660 de 2005).
Un autre point intéressant concerne la qualification de la figure du rédacteur en chef d’un journal.
En fait, en l’absence d’une disposition spécifique dans la Convention collective nationale italienne des journalistes, le rédacteur peut être qualifié comme un dirigeant uniquement si son activité est caractérisée par une certaine autonomie et une certaine prise de décision discrétionnaire et par l'absence de toute dépendance hiérarchique réelle, ainsi que par l'étendue des fonctions, de manière à influencer la gestion de l'ensemble de l'entreprise ou d'une branche autonome de celle-ci.
À cet égard, a été qualifié comme un « dirigente » le rédacteur en chef d’un périodique à diffusion nationale, qui était responsable de la qualité et des résultats du produit éditorial, ainsi que de la gestion d’une rédaction d’une quinzaine de personnes et qui avait le choix des collaborateurs externes et du personnel à recruter.
Les principales spécificités prévues par la Convention collective nationale italienne des journalistes (CCNL Giornalisti du 24 juin 2014)
• Le journaliste dit « professionnel » doit s’inscrire à l’Ordre professionnel (« Albo professionale »)
Les journalistes dit « professionnels », c’est-à-dire ceux qui exercent la profession de manière exclusive et continue (article 1 de la loi professionnelle) doivent nécessairement s’inscrire à l’Ordre professionnel.
Le futur journaliste, qui veut devenir un « journaliste professionnel », doit remplir certains critères, qui sont les suivants :
a) S’inscrire au registre des journalistes en formation (en Italien « registro dei praticanti giornalisti ») ;
b) Exercer de manière continue l’activité de journaliste pour au moins 18 mois ;
c) Réussir l’examen d’aptitude professionnelle.
Si le journaliste exerce de manière abusive la profession, parce qu’il ne résulte pas inscrit à l’Albo Professionale, il est passible des sanctions prévues à l'article 45 de la loi professionnelle (peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou amende de 103 à 516 euros).
• Le journaliste n’est pas assujetti au respect de l’horaire de travail « normal », fixé en 40 heures par semaine
L’exercice de l'activité journalistique rend difficile la détermination du nombre exact d'heures de travail et leur répartition.
Pour les journalistes professionnels une durée maximale de travail de 36 heures par semaine est fixée, répartie, en raison de la courte durée de la semaine, sur cinq jours, à titre de meilleur faveur (Article 7 de la CCNL Giornalisti).
Le journaliste a droit, en plus du repos dominical, à un autre jour de congé payé dans la semaine, qui ne peut pas coïncider avec un jour férié (Article 19 de la CCNL Giornalisti).
• Le journaliste peut être licencié uniquement par le rédacteur en chef du journal
Les journalistes, comme la quasi-totalité des travailleurs subordonnés, ne peuvent être licenciés que s'il existe un motif justifié (en Italien « giustificato motivo ») ou une « juste cause », c’est-à-dire une raison liée à un comportement tellement grave qu’il ne permet pas la poursuite de la relation de travail, même temporaire (en Italien « giusta causa »).
Le journaliste peut être licencié uniquement par le rédacteur en chef du journal (« direttore del giornale ») au sens de l’Article 6 de la CCNL Giornalisti.
• Cotisations sociales et inscription au Fond de sécurité sociale professionnelle (en Italien « INPGI »-Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani »)
C’est l’INPGI qui remplit toutes les fonctions qui, pour les citoyens ordinaires, sont assurées par l’INPS.
En d'autres termes, c'est à l'INPGI que les journalistes versent des cotisations (directement ou par l'intermédiaire de leur employeur) et c’est l’INPGI qui verse aux journalistes les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, les allocations de chômage, les indemnités d'accident, les aides au revenu, les allocations familiales etc. (Article 21 de la CCNL Giornalisti).
Sur le même sujet