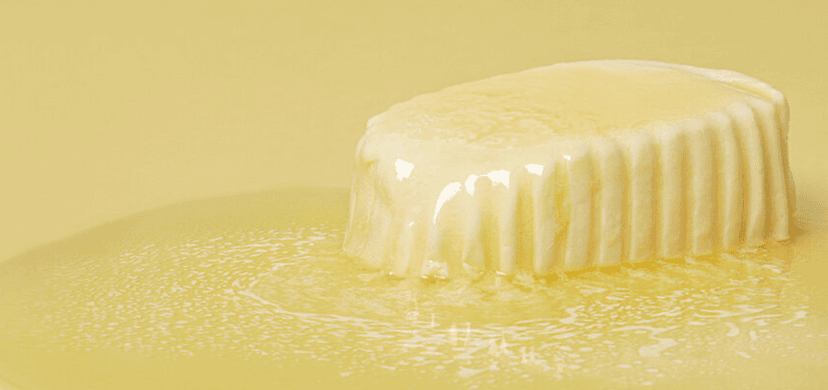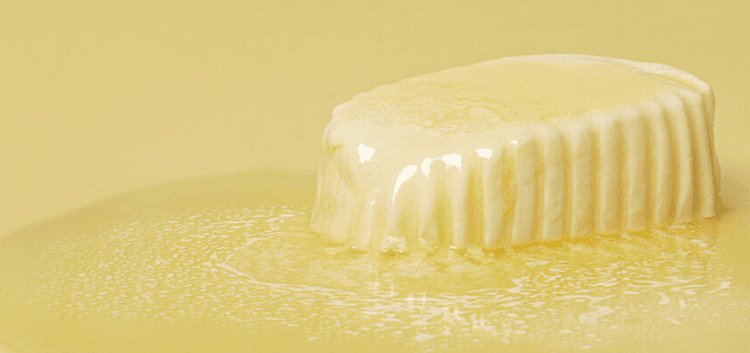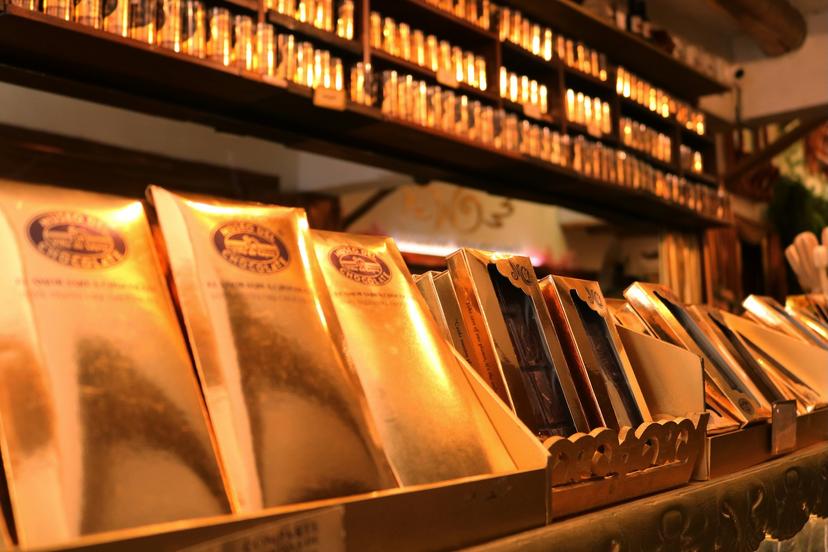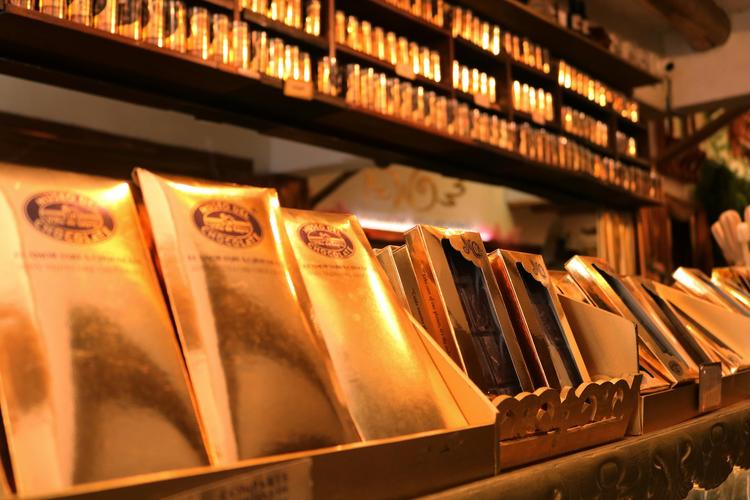Depuis plusieurs semaines, la droite et l'extrême droite françaises se livrent à un concours de déclarations agressives et revanchardes à l’égard de l’Algérie. Cette stratégie de la provocation, qui semble leur assurer une couverture médiatique à la hauteur de leurs ambitions personnelles, est une insulte à l’intelligence diplomatique et une menace pour les relations franco-algériennes. Chaque jour, des membres de LR et du RN enchaînent des propos outranciers à l’encontre de l’Algérie et des Algérien·nes. Bruno Retailleau utilise cette posture nauséabonde comme rampe de lancement vers la direction de son parti, achevant cahin-caha son chemin vers l’extrême-droitisation de LR.


Tribune des Sénateurs et députée Mélanie Vogel, Mathilde Ollivier, Akli Mellouli, Sabrina Sebaihi.
Dans cette dynamique, il outrepasse même ses fonctions en sapant les efforts de la diplomatie française et en méprisant celles et ceux qui travaillent à réparer une relation complexe et difficile. Or, cette relation n'est pas seulement une affaire d’État : elle touche des millions de nos concitoyen·nes franco-algérien·nes, des Algérien·nes vivant en France, et tou·tes celles et ceux qui ont des attaches amicales ou familiales en Algérie. Il est de notre responsabilité de préserver ces liens essentiels en dépassant ces comportements irresponsables.
Deux éléments majeurs rendent la relation franco-algérienne unique.
Le premier est le poids du passé : 130 ans de colonisation marqués par la répression, la discrimination, des massacres et une guerre meurtrière. Ce passé douloureux que nous commémorions notamment ce mercredi 19 mars lors de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, continue d’influencer nos relations. Il alimente aujourd’hui encore les discours extrémistes en France, portés par celles et ceux qui refusent d’accepter la réalité de la violence coloniale. Mais ce passé doit être abordé avec honnêteté. C'est pourquoi la reprise des travaux de la commission Stora-Zeghidi est essentielle, tout comme l’accès aux archives pour les chercheurs et l'examen des demandes de restitution d’œuvres d’art spoliées durant la colonisation.
Certains en France brandissent aujourd’hui les accords franco-algériens de 1968 comme un enjeu crucial, alors que leur contenu a été largement révisé au fil des réformes successives. Si une renégociation est possible, une dénonciation unilatérale apparaît comme totalement irresponsable et envoie un message désastreux. L’histoire récente montre que les déchirures diplomatiques et le mépris des engagements internationaux sont l’apanage des régimes autoritaires. Est-ce vraiment la voie que nous voulons suivre ?
Le second élément est notre avenir commun. L'Algérie et la France partagent une proximité géographique et humaine indéniable. A titre d’exemple, selon, l’INSEE en 2015 17% des mariages mixtes célébrés en France ont uni une personne de nationalité française à un conjoint de nationalité algérienne. Il ne tient qu'à nous de faire de l’Algérie un partenaire de premier plan, qu'il s'agisse d'échanges culturels, économiques ou diplomatiques.
L'Algérie est une nation indépendante et souveraine qui porte sur la France un regard aiguisé. Ses critiques ne sont pas toujours agréables à entendre, mais elles révèlent souvent des vérités. L'exemple du revirement français sur le Sahara occidental est éloquent : présenté en France comme un choix stratégique, il est perçu en Algérie comme la preuve d'une nostalgie coloniale persistante et d’une interprétation opportuniste du droit international. Ce n’est pas un hasard si cette décision est mise en parallèle avec le soutien inconditionnel à Netanyahou, la répression des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, et le traitement infligé à Mayotte après le cyclone Chido.
Cela ne signifie pas qu'il faille faire preuve de complaisance envers l'Algérie. Les atteintes à la liberté de la presse et les emprisonnements arbitraires doivent être dénoncés sans être accusés d'ingérence. Nous nous devons d’ouvrir les yeux, en Algérie également, sur certains acteurs qui nuisent à la relation franco-algérienne et souhaitent voir l’Algérie rompre tout lien avec la France. Ces dérives politiques se nourrissent aussi des égarements du gouvernement français.
Les expulsions d'Algérien·nes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) illustrent l'amateurisme et l’hypocrisie de certains responsables politiques. Plutôt que de respecter le droit français et les accords internationaux, ils préfèrent instrumentaliser ces dossiers à des fins électoralistes. L’expulsion ratée de l’influenceur Doualemn en est un exemple flagrant. Un État de droit commence par respecter ses propres lois et les institutions nationales ne peuvent servir de paillasson aux intérêts personnels crottés des bottes de l’extrême droite.
La France et l’Algérie semblent coincées dans une relation toxique, où rancœur et incompréhension entravent le dialogue. Il est temps de changer d'approche. Plutôt que de nous épuiser dans des postures arrogantes et agressives, misons sur l'écoute et le respect.
Le passé ne doit pas être occulté, mais il ne doit pas non plus servir d’alibi à des surenchères stériles. Nous devons assumer notre histoire tout en construisant un avenir basé sur des intérêts communs. Cette ambition exige du courage politique et une vision à long terme, loin des calculs électoralistes et des petites phrases incendiaires.
Mélanie Vogel, sénatrice écologiste des Français·es de l’étranger
Mathilde Ollivier, sénatrice écologiste des Français·es de l’étranger
Akli Mellouli, sénateur écologiste, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Sabrina Sebaihi, députée écologiste, membre de la Commission des affaires étrangères, Vice-présidente du Groupe d'amitié France-Algérie