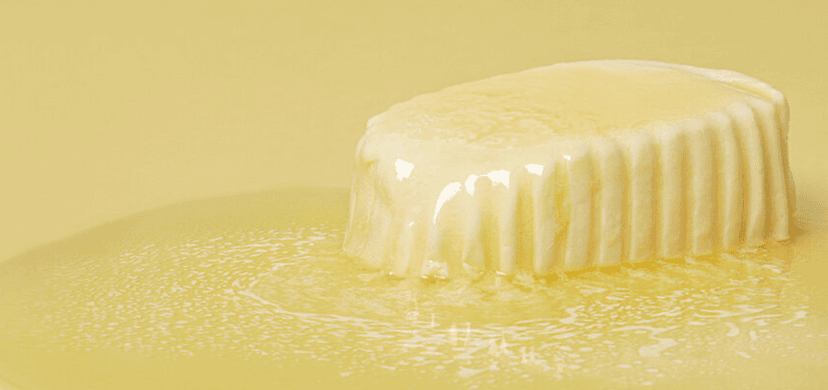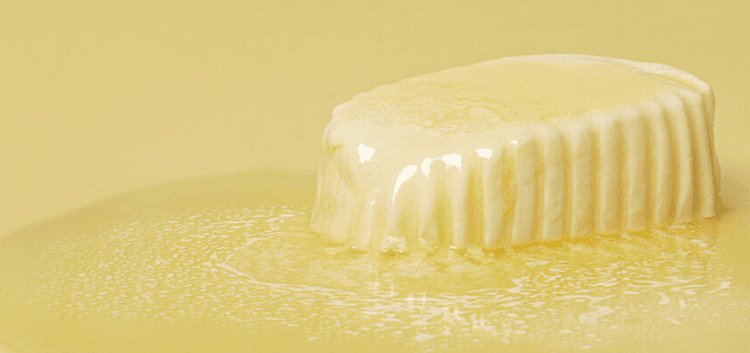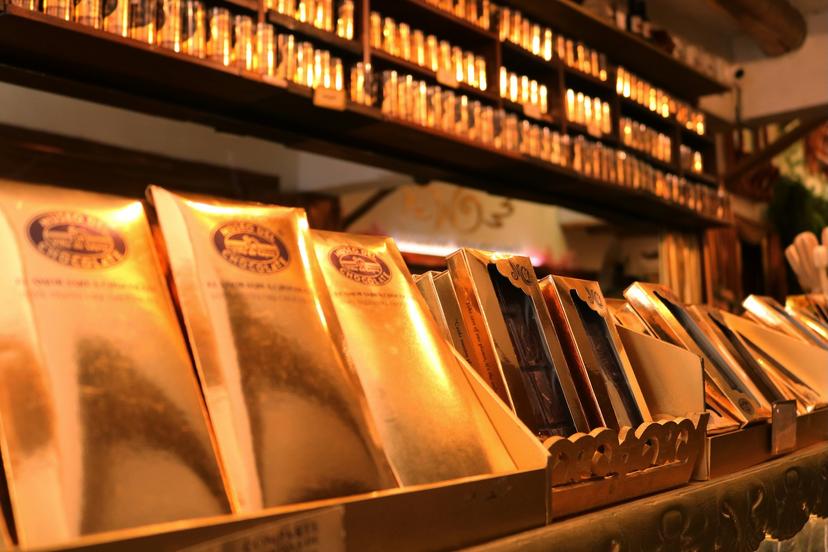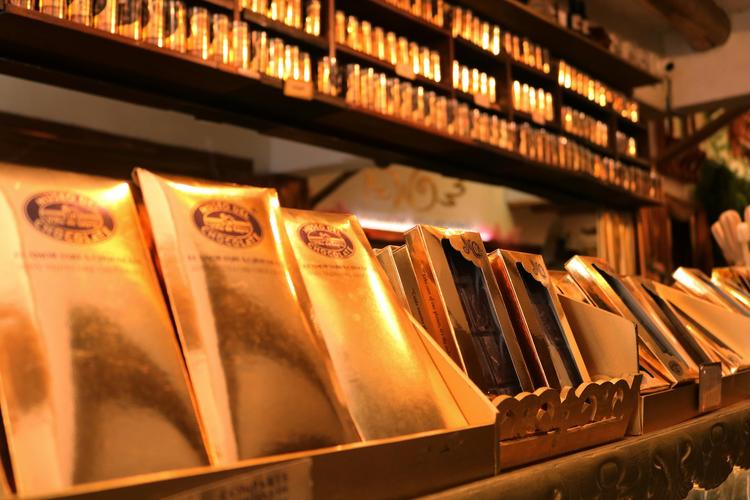Présidente de l’Institut français depuis 2021, Eva Nguyen Binh travaille à la politique culturelle extérieure de la France dans plus de cent pays. À son retour du Festival de Cannes, elle explique pour Lepetitjournal.com que « la diplomatie culturelle est une force française », rappelant combien, « en période de crise, la culture reste un vecteur essentiel de dialogue ». De la Fabrique Cinéma, « un petit programme pépite » révélant des cinéastes des Suds, aux résidences d’artistes pensées comme des espaces de création, Eva Nguyen Binh démontre que l’Institut français ne manque pas d’idées pour faire rayonner la France sur la scène culturelle internationale.


Vous revenez du Festival de Cannes. Pourquoi est-ce important pour l’Institut français d’y être présent ?
Notre présence à Cannes incarne pleinement les missions de l’Institut français : soutenir les artistes et les industries culturelles françaises à l’international, favoriser la coopération avec les professionnels étrangers, et accompagner notre réseau culturel à l’étranger. Cannes est un moment clé pour connecter les professionnels français et étrangers. Nous y organisons des rencontres, conférences, masterclasses et événements B2B. Notre pavillon accueillait environ 400 visiteurs par jour.
Nous facilitons la rencontre entre professionnels français et étrangers. Par exemple, nous faisons venir des professionnels étrangers à Cannes pour les mettre en lien avec leurs homologues français. C’est l’occasion pour les professionnels français de découvrir des talents émergents. Nous collaborons aussi avec le réseau des attachés audiovisuels qui sont présents à Cannes. C’est une occasion pour organiser des événements en lien avec eux. Nous avons notamment présenté le marché brésilien dans le cadre de la saison France-Brésil mais aussi car le Brésil est l’invité d’honneur du marché du film en 2025. Nous avons aussi organisé une table ronde sur le patrimoine cinématographique et la création africaine, avec la participation de plusieurs attachés audiovisuels du continent. C’est aussi à Cannes que se déploie la Fabrique Cinéma, notre programme phare d’accompagnement de jeunes talents issus des cinémas du Sud.

Pouvez-vous nous expliquer le concept de la Fabrique Cinéma ?
La Fabrique Cinéma est un programme de l’Institut français qui accompagne chaque année dix projets de premiers ou deuxièmes longs-métrages portés par de jeunes réalisateurs et producteurs issus des pays dits du Sud. Cette année, pour la première fois des projets du Cap-Vert et du Kirghizistan font partie de la sélection. Il s’agit d’un dispositif d’incubation, conçu pour intervenir à un stade très amont, quand le projet n’est encore qu’une idée. À ce moment-là, peu d’acteurs sont prêts à s’engager, car le risque est élevé.
Nous offrons à ces talents un accompagnement sur mesure, en amont du Festival de Cannes via des sessions en visioconférence, puis sur place, pendant une semaine, où se déroulent les rencontres décisives. La Fabrique permet à ces binômes réalisateur-producteur de rencontrer des coproducteurs, des distributeurs, des compositeurs, ou encore des prestataires techniques. Environ 90 entreprises françaises collaborent sur les films de la Fabrique, il s’agit donc d’un soutien à la fois pour les talents émergents mais aussi pour l’industrie française.
Ce programme crée de véritables passerelles. Un exemple concret : Aïcha Can't Fly Anymore, projet égyptien et tunisien passé par la Fabrique en 2022, a été sélectionné en 2024 dans la section « Un Certain Regard » à Cannes. Autre exemple, La Nuit des Rois de Philippe Lacôte, qui a suivi le même parcours jusqu’aux Oscars. Certains anciens lauréats deviennent même parrains ou marraines à leur tour, dans une logique de transmission. La Fabrique Cinéma s’inscrit dans l’écosystème plus large de l’Aide au Cinéma du Monde (ACM), que nous co-gérons avec le CNC. Ce soutien complémentaire permet à plusieurs films de franchir une nouvelle étape vers une reconnaissance internationale.

Le réseau culturel français à l’étranger fait des appels à candidatures pour des résidences dédiées à la recherche, à la création et à l’expérimentation artistique en mars et avril 2025. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le projet ?
Le concept de résidences d'artistes, comme la Villa Médicis à Rome, connaît un regain d’intérêt depuis la crise du Covid. Beaucoup d’artistes ont ressenti le besoin de voyager autrement, de s’immerger plus durablement dans les réalités locales. Les résidences répondent à ce besoin de temps, de recul, de création sans pression immédiate de production. Aujourd’hui, le réseau culturel français gère une quarantaine de résidences et nous avons aussi à Paris un programme appelé "La Fabrique des résidences", qui accompagne les postes dans la création de nouvelles résidences, avec un soutien en expertise et en budget.
Nous observons un essor important de ces initiatives. La Villa Albertine, lancée en 2021 aux États-Unis, a inspiré d’autres projets, comme la Villa Swagatam en Inde. Depuis, l’envie s’est étendue à l’Asie du Sud et du Sud-Est, avec des projets au Sri Lanka, au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam. Les pays nordiques ont également développé une résidence itinérante, axée sur les modes de transport doux, considérant que le voyage fait partie de la résidence. Ces résidences sont souvent dites "de recherche", car elles offrent un temps de recul sans obligation de production. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne sont pas productives. J’étais à la Villa Kujoyama en avril 2025, et tous les artistes avaient des œuvres à montrer.
Le budget de l’Institut français a été réduit de 1,7 million d’euros comparé à 2024. Comment cela va-t-il impacter vos projets ?
La contrainte budgétaire concerne tout le monde, et elle risque de s’intensifier. Nos ministères de tutelle, Affaires étrangères et Culture, souhaitent néanmoins nous préserver autant que possible. Nous sommes énormément sollicités, surtout en période de crise puisque la culture reste un vecteur essentiel de dialogue. Les artistes et les industries culturelles ont besoin de se projeter à l’international pour exister au-delà des frontières françaises. Nous passons donc l’ensemble de nos programmes en revue pour voir où ajuster, réformer ou même supprimer certains dispositifs si nécessaire.
Mais au-delà de l’aspect budgétaire, il est essentiel d’expliquer notre action aux citoyens français. Beaucoup s’interrogent en se demandant “pourquoi soutenir des artistes à l’étranger, financer une résidence au Japon sans obligation de production ?” Il faut montrer en quoi cela participe à l’image de la France dans le monde, à la vitalité de notre langue, à la carrière de nos artistes. Contrairement aux idées reçues, les artistes ne sont pas tous fortunés. La majorité vit dans une grande précarité. Les résidences sont souvent indispensables, à la fois pour leur permettre de créer et pour des raisons économiques. Nous leur offrons un cadre, du temps, mais ils doivent continuer à payer leur logement en France. Cela demande des sacrifices. Notre réseau est vaste : une centaine d’instituts français, des centaines d’alliances. Et dans chaque lieu, il y a des centres de langue. Ce travail est fondamental pour la diffusion de la langue française et la présence de la France dans le monde.
On entend parfois que la langue française est en déclin, que notre image est négative. C’est faux. Ceux qui le disent ne voyagent pas beaucoup. Il y a bien sûr des pays où la politique française est critiquée, mais dans bien d’autres, la France est regardée avec admiration. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas mieux faire. C’est précisément l’objet de la révision de nos programmes : mieux agir, mieux communiquer, mieux rendre compte. Nous sommes largement financés par des fonds publics, il est donc normal que les citoyens sachent ce que nous faisons. Mais comme nous travaillons à l’étranger, souvent en partenariat avec d’autres structures, notre action est moins visible. C’est pour cela que beaucoup de Français ne perçoivent pas l’impact de la diplomatie culturelle.
Avez-vous des pistes concrètes pour mieux faire comprendre cette action ?
Nous devons changer notre manière de nous exprimer. Dans le monde culturel, nous avons tendance à utiliser un langage un peu abstrait, rempli de formules qui peuvent sembler creuses à ceux qui ne sont pas du milieu. Je milite pour qu’on développe des “elevator pitchs”, ces présentations claires et concises qui permettent d’expliquer nos actions en quelques phrases. C’est essentiel, surtout quand on s’adresse à des décideurs très sollicités. La diplomatie culturelle est difficile à objectiver, mais il faut que chacun puisse comprendre, en quelques mots, l’intérêt de nos actions. C’est une vraie évolution de mentalité.

Souhaitez-vous impliquer davantage les élus dans vos actions ?
Nous avons des échanges réguliers avec les parlementaires, mais je souhaite renforcer le lien. Certains sont déjà très investis, comme Frédéric Petit, député des Français de l’étranger. Il connaît très bien nos actions. Il a d’ailleurs participé à une table ronde à Rennes dans le cadre des Dialogues européens, où il a pu intervenir et échanger avec des intervenants venus de plusieurs pays. C’était très enrichissant puisque les élus apportent un autre regard, un point de vue politique qui nous est précieux.
Je souhaite en inviter d’autres, notamment aux Ateliers de l’Institut français. Peut-être qu’ils ne pourront pas tous se libérer, leur emploi du temps est souvent très chargé, mais au moins ils sauront ce que nous faisons. Je leur écris plus souvent maintenant, pas seulement à celles et ceux qui nous connaissent déjà, pour partager nos initiatives. C’est une façon de les embarquer à bord, de les sensibiliser, de leur faire découvrir concrètement notre travail sur le terrain. Il est important qu’ils puissent voir, comprendre, et pourquoi pas, relayer cette action.
Quel message souhaitez-vous adresser aux lecteurs du média Lepetitjournal.com, Français vivant à l’étranger ?
La diplomatie culturelle est une force française. Tous les pays ne placent pas la culture au cœur de leur diplomatie. Chez nous, elle est perçue comme une richesse et un outil de dialogue entre les sociétés. Dans un monde marqué par les tensions, la culture permet de maintenir des liens. Des artistes peuvent continuer à collaborer même quand leurs gouvernements ne se parlent plus. Cela n’empêche pas les conflits, mais cela en atténue les effets. Pour moi, la diplomatie culturelle est avant tout une vision de la société. Soit l’on considère que la culture est superflue, soit on la juge indispensable. Je crois profondément que la culture est essentielle à toute société. Et la France a énormément à partager, sans jamais donner de leçons, mais avec une voix singulière.
Sur le même sujet