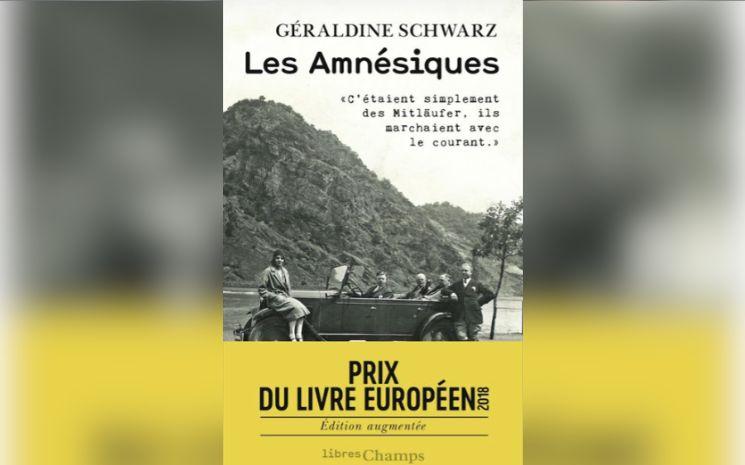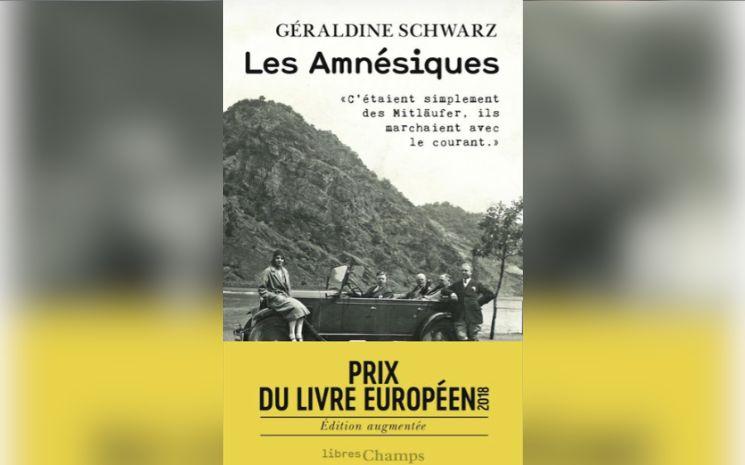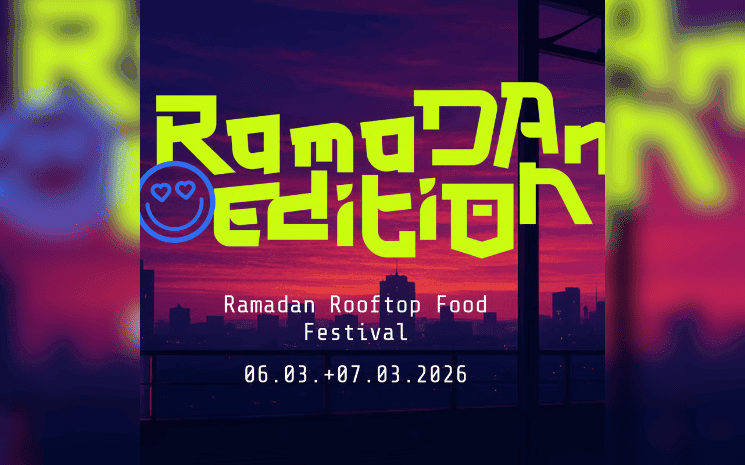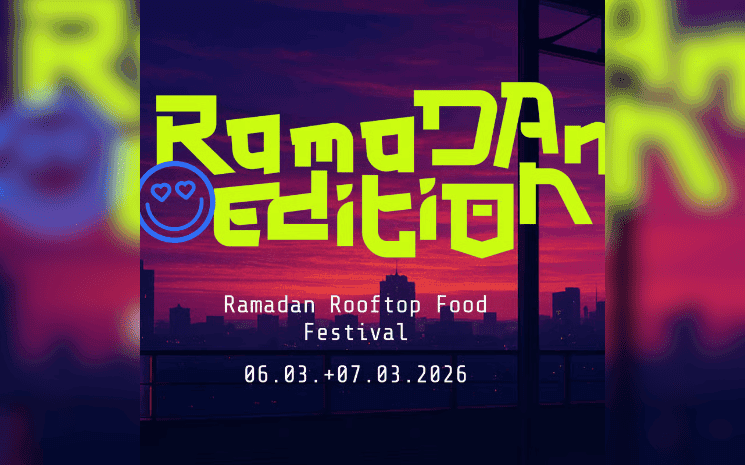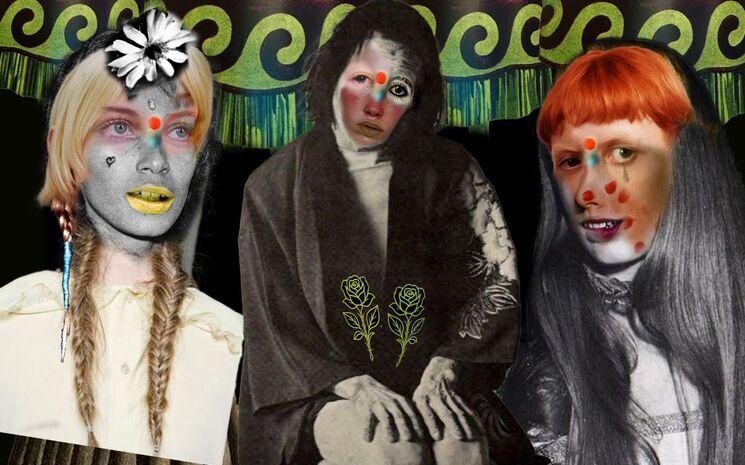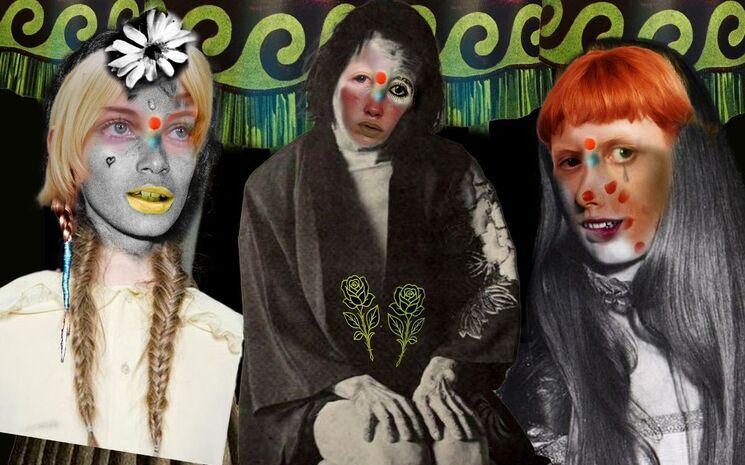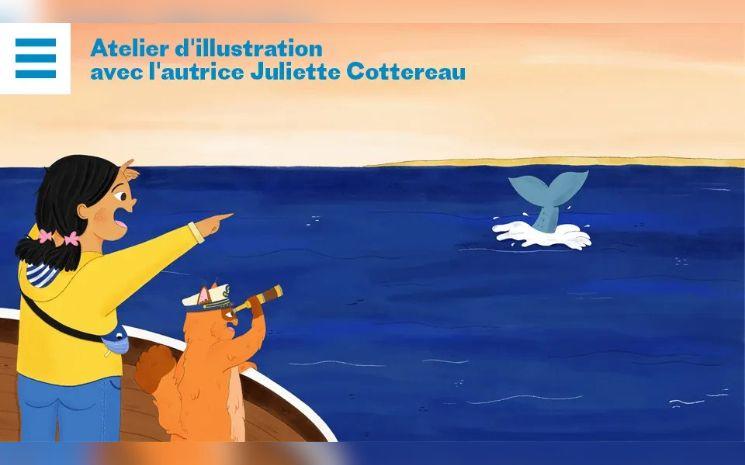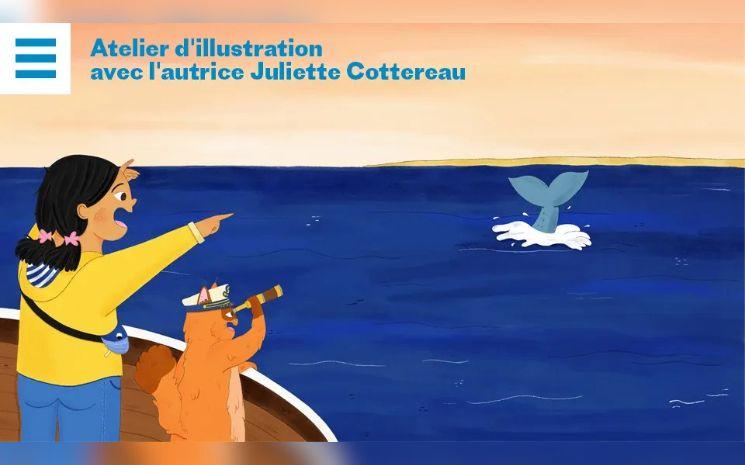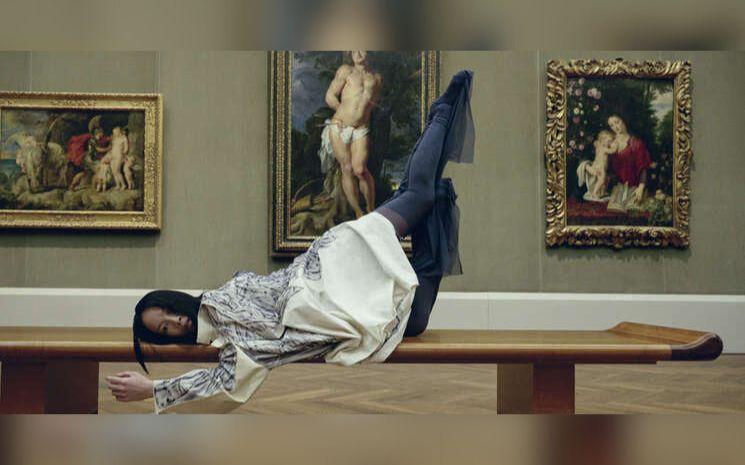À Berlin, tous les enfants scolarisés, de la maternelle au lycée, ont la possibilité d’apprendre les sciences de la nature en extérieur, par l’observation directe, au sein de véritables "écoles-jardins" (Gartenarbeitsschule). Plongée dans un programme scolaire centenaire et pourtant très actuel.


Tandis qu’un enfant d’une dizaine d’années se tourne vers sa professeure et s’exclame, manifestement ravi : "J’ai trouvé un escargot !”, ses camarades imitent le déplacement des grenouilles en sautillant accroupis, sous l'œil attentif de l’organisateur de l’atelier “Animaux de l’étang”. Autour de nous, une mare, de nombreux arbres, des parcelles de terre cultivée, et quelques moutons paissant au loin. Un écureuil roux escalade un tronc. En ce début juin, les feuilles des arbres nous cachent les quelques immeubles qui entourent ces 30 000 mètres carrés de jardin urbain, et dont la vision pourrait nous rappeler que nous ne sommes pas perdus dans la campagne, mais bien au beau milieu de Neukölln, un district du sud-est de Berlin.
Nous voici au cœur de la August-Heyn-Gartenarbeitsschule (AHGASN), la première école-jardin de ce type, créée dès 1920. Bien plus que de simples écoles de jardinage, les Gartenarbeitsschule (terme qui assemble les mots allemands pour “jardin”, “travail” et “école”) sont pensées comme de véritables “lieux d’apprentissages en dehors des murs de l’école”, nous explique Susann Sava, l’une des deux co-directrices de l’AHGASN. Uniques en Allemagne par leur ampleur et leur organisation, elles sont au nombre de 16 à Berlin, réparties dans toute la ville.

Une pédagogie active et basée sur la découverte
Concrètement, les écoles des districts correspondant réservent un créneau, en général d’une heure et demie, et y emmènent leurs élèves. Celle de Neukölln, une des plus étendues, peut recevoir jusqu’à 30 000 visiteurs chaque année (dont une majorité de scolaires), et emploie une vingtaine de personnes, dont six jardiniers. D’autres sont plus petites : dans celle de Friedrichshain-Kreuzberg, ce sont entre 5 000 et 6 000 élèves qui sont accueillis chaque année.
Les programmes sont saisonniers et régulièrement renouvelés : on y trouve des ateliers de plantation et de récolte, mais aussi des projets autour de la laine des moutons, des abeilles et du miel, de l’écosystème de la mare... Les Gartenarbeitsschule disposent en outre de salles de classe, équipées pour compléter les travaux des enfants à l’extérieur. Avec des microscopes, ils peuvent observer toute la vie contenue dans une seule goutte d’eau de la mare, ou bien apprendre à cuisiner des courges à l’automne.
L’idée qui sous-tend les Gartenarbeitsschulen est celle d’une pédagogie active, basée sur l’apprentissage par la découverte. “Pour les élèves de primaire, nous suivons également le programme scolaire de base (...), ce qui permet aux enseignants de donner vie à certains thèmes, comme celui sur les poules. Ils n’ont pas besoin de les étudier théoriquement en classe, car ces thèmes deviennent très vivants et concrets ici”, détaille Sylvia Weber, directrice pédagogique de la Gartenarbeitsschule du district de Friedrichshain-Kreuzberg, au centre de Berlin.
Mais au-delà d’un simple apprentissage par observation, la pédagogie des Gartenarbeitsschule vise également à faire découvrir la nature à des enfants qui grandissent en ville, et à leur faire comprendre qu’ils en font partie. “Certains enfants qui viennent chez nous n’osent pas marcher pieds nus dans l’herbe, car ils ne l’ont jamais fait de leur vie (...). Ici, ils en ont l’occasion”, témoigne Susann Sava. Manon, écologue française en volontariat avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) pour un an à la Gartenarbeitsschule de Neukölln, abonde : ”Beaucoup d’enfants qui nous visitent ont peur des insectes, or ce sont des peurs qui sont construites. En venant ici, ils apprennent à les dépasser”.


August Heyn, un pédagogue réformateur
Aux origines de ce dispositif, on trouve un professeur et pédagogue réformateur, qui a fondé en 1920 la première Gartenarbeitsschule à Neukölln (et qui lui donnera son nom) : August Heyn. Né en 1879 à Reetz (aujourd’hui Recz, en Pologne), il habite d’abord à Reppen (Repzin), où il plante un verger et constate les bienfaits éducatifs de ce jardin sur ses propres enfants. En 1909, il s’installe à Berlin, alors en proie à une industrialisation galopante. En tant qu’enseignant, il est le témoin privilégié des écoles surpeuplées, comptant une cinquantaine d’élèves par classe, de l’environnement des jeunes borné par les immeubles et les rues grises, mais également de la situation alimentaire catastrophique pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, déjà à Neukölln, il lance une première initiative, les Schulkolonie, de vastes champs où les jeunes issus de familles pauvres viennent cultiver la terre, tant pour sortir de la rue que pour s’alimenter.
Combien de fois au cours de toutes ces années me suis-je posé la question : n'est-il pas possible d'offrir à chaque enfant [...] les joies, les bienfaits éducatifs, pédagogiques et sanitaires d'un jardin ? L'État ne reconnaît-il pas cet important outil pédagogique ? Et s'il le fait – il le doit – pourquoi ne crée-t-il pas une Gartenarbeitsschule ?
August Heyn, dans "Die Gartenarbeitsschule", 1921
Au sortir de la Première Guerre mondiale, son idée de créer de véritables Gartenarbeitsschule est acceptée au conseil municipal, et en 1920, August Heyn est chargé de développer six nouvelles écoles dans le district de Neukölln. Si seule l'une d’entre elles persiste à Neukölln, d’autres essaiment dans les districts berlinois. Pendant la partition de l’Allemagne, les Gartenarbeitsschule de l’ouest voient leur importance diminuer. En RDA, au contraire, leur fréquentation devient obligatoire.
En 2016, leur modèle est entériné, avec l’inscription de cette offre pédagogique dans la loi scolaire de Berlin, leur assurant un financement pérenne. Un soulagement pour les directeurs de ces établissements, qui devaient négocier chaque année leur budget. Mais également une reconnaissance de l’importance d’une telle offre pédagogique, en particulier dans le contexte des crises écologique et climatique.

Des enseignements concrets pour l'éducation au développement durable
Car si à l’origine les Gartenarbeitsschulen consistaient surtout à cultiver la terre, les enseignements se sont considérablement élargis, et intègrent aujourd’hui les thématiques du développement durable. Dans celle de Neukölln, les enfants peuvent, en s’appuyant sur de la laine de mouton tout juste tondue, retracer la chaîne de fabrication d’un vêtement, et aborder les enjeux écologiques que soulève la production textile aujourd’hui.
Dans l’école de Friedrichshain-Kreuzberg, plus petite et désormais enchâssée entre des immeubles récemment construits, c’est par la récolte des pommes que les enfants abordent le thème de l’agriculture biologique et ses problématiques : “Nous allons au pied du pommier avec les enfants. Ensuite, nous regardons combien de pommes sont déjà tombées (...). Puis, nous trions ces pommes, entre celles que nous ne pouvons pas utiliser du tout et qui vont au compost, et les autres, qui n’ont pas l’air bonnes à manger, mais que nous pourrions peut-être transformer. Enfin, nous installons une échelle, et chaque enfant peut grimper et cueillir une pomme. Nous les plaçons dans un panier, et nous notons les quantités. Là, les enfants réalisent qu’il n’en reste pas autant que prévu (...). Ils font également la comparaison avec les pommes lisses et traitées qu’ils peuvent voir dans les supermarchés”, relate Sylvia Weber. Le pionnier de la pédagogie moderne, le réformateur suisse Pestalozzi, prônait, à la fin du 18e siècle et au début du siècle suivant, un enseignement qui irait dans trois directions : la tête, la main, le cœur. Ce sont des principes qui résonnent encore aujourd'hui dans les Gartenarbeitsschulen berlinoises.
En nous dirigeant vers la sortie de “l’école-jardin” de Neukölln, quelques lettres peintes sur un panneau de bois posé contre une yourte attirent notre attention : “Ici vit une maman renard avec ses petits”, pouvons-nous lire. Le terrier passant juste sous la yourte, celle-ci est fermée aux visiteurs, en attendant que les renards s’en aillent. Encore une façon concrète d'apprendre aux enfants une autre manière d'être au monde, plus respectueuse du vivant.
Pour recevoir gratuitement notre newsletter du lundi au vendredi, inscrivez-vous !
Pour nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.