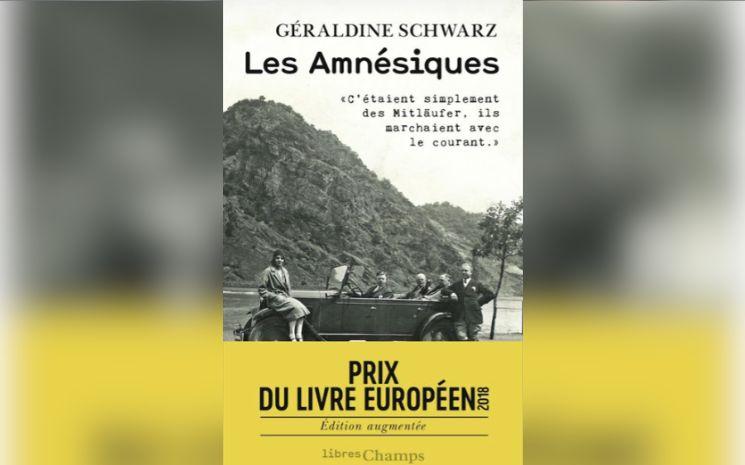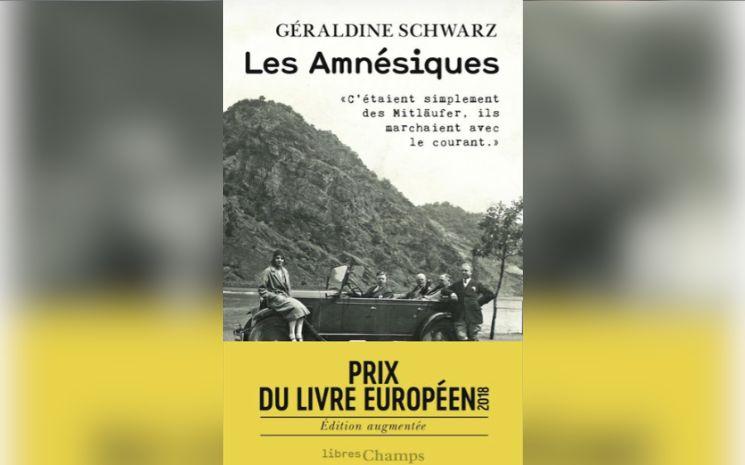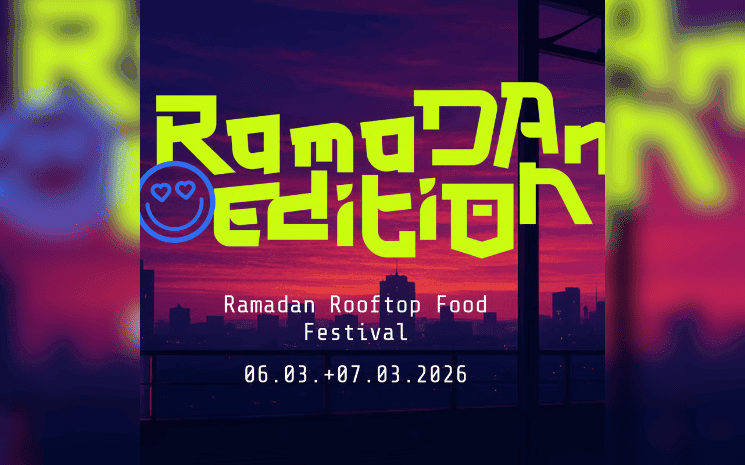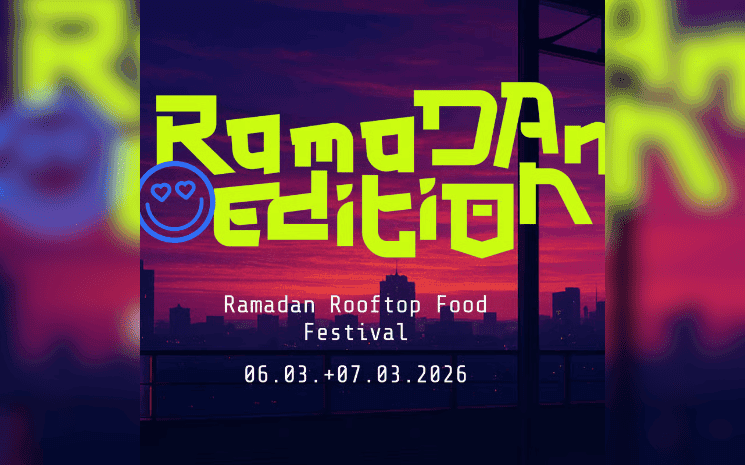Le 30 avril 1945, alors que l’Armée Rouge encercle Berlin, Hitler se tire une balle dans la tête dans son bunker, privant le monde d’un procès et aussi, peut-être, d’explications. 80 ans plus tard, une analyse ADN réalisée à partir d’un morceau de tissu ensanglanté prélevé sur le canapé du bunker livre des résultats qui fascinent autant qu’ils dérangent. Avec en filigrane, comme un besoin collectif d’expliquer l’inexplicable grâce à la biologie.


Des conclusions à manier avec prudence
Depuis quelques jours, Internet s’enflamme. Un documentaire de Channel 4 présente le travail d’une équipe internationale de généticiens et d’historiens qui affirme avoir analysé ce qui serait le premier échantillon d’ADN authentifié d’Adolf Hitler.
Les résultats, encore en cours de revue scientifique et non publiés à ce stade, confirment l’identité du sang grâce à une correspondance génétique avec un parent du côté paternel, avant qu’ils ne procèdent au séquençage du génome. Pour la première fois, on dispose d’un profil génétique complet du dictateur.
La comparaison génétique commence par balayer une rumeur qui persiste depuis les années 20 : non, Hitler n’avait pas d’ascendance juive.
Quant à l’analyse, elle révèle un point médical réel : la présence d’une mutation associée au syndrome de Kallmann, un trouble hormonal pouvant retarder la puberté, affecter la libido et entraîner des anomalies génitales. Rien de sensationnaliste ici : cela recoupe des documents médicaux retrouvés et plusieurs témoignages d’époque.
Ensuite, cela part un peu dans tous les sens. Et c’est compréhensible. Parce que dès qu’on touche à Hitler, l’imaginaire collectif bascule vers des questions qui n’ont rien de scientifiques : existait-il un “gène du mal” ? Cherche-t-on à trouver une cause simple à l’horreur ? Hitler avait-il un micropénis ?
Les chercheurs ont établi qu'Hitler appartenait au top 1 % de la population pour des prédispositions génétiques à l’autisme, à la bipolarité et à la schizophrénie. On va éviter de glisser vers le « tout s’explique ». Prédispositions ne veut pas dire diagnostic, et la majorité des personnes ayant un score similaire ne développent aucune de ces pathologies. Et des voix s’élèvent, soulignant le risque de stigmatisation en associant, même involontairement, des troubles neurodéveloppementaux à un criminel de masse.
Les spécialistes insistent lourdement : on ne lit pas dans un génome comme dans un roman. Et surtout, on ne tire pas de conclusions sur le comportement d’un individu à partir d’un score statistique.
Aucune clé pour comprendre l’horreur
Fallait-il faire cette étude ? Les avis sont partagés. Si certains historiens disent oui, au nom de la connaissance, d’autres y voient un exercice douteux, incapable d’éclairer les ressorts réels du nazisme.
Si ces résultats fascinent autant, c’est parce qu’en toile de fond, on cherchera sans doute toujours à expliquer l’horreur. S’accrocher à l’idée d’un « défaut » biologique a un côté rassurant. L’horreur serait une anomalie, pas quelque chose qui peut surgir dans une société entière.
Malheureusement, comme le rappellent les historiens, aucun gène n’explique la Shoah. Au-delà de la figure monstrueuse diabolisée d’Hitler, des millions de personnes ont participé, accepté, profité. La biologie ne raconte rien de cette mécanique collective.
Et nous, collectivement, supportons mal l’idée que des actes aussi inhumains puissent être le résultat d’un enchaînement de choix, de circonstances, de croyances, de contexte historique et social.
Si cette étude confirme un élément historique (l’absence d’ascendance juive), éclaire peut-être certains aspects intimes (le syndrome de Kallmann), elle ne dit absolument rien de la genèse du nazisme, ni de la nature du mal.
Pour recevoir gratuitement notre newsletter, inscrivez-vous en cliquant sur l’icône enveloppe en haut de la page !
Pour nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
Sur le même sujet