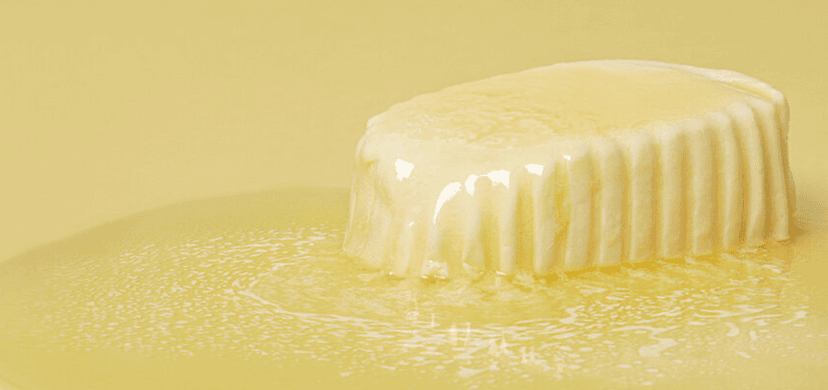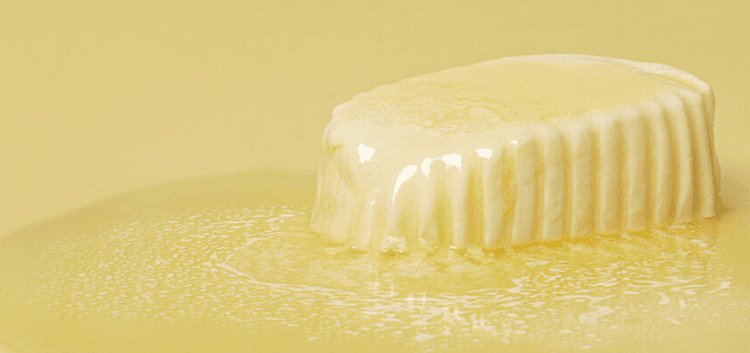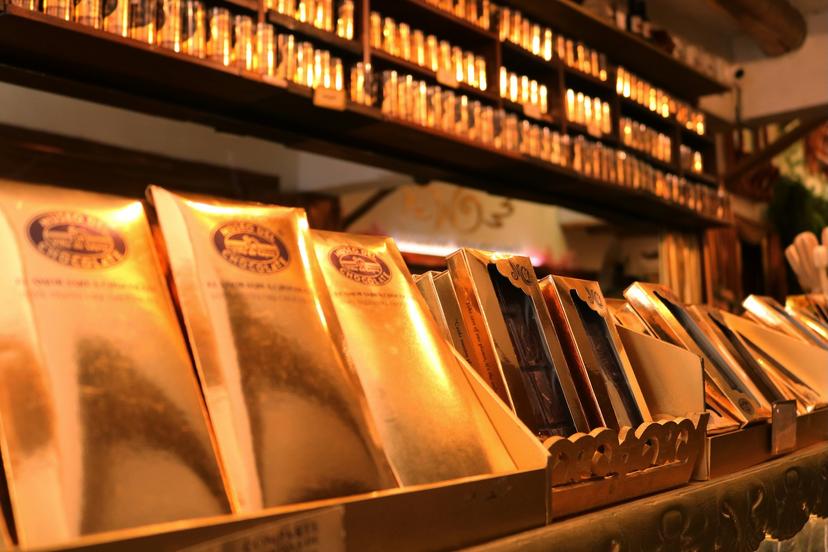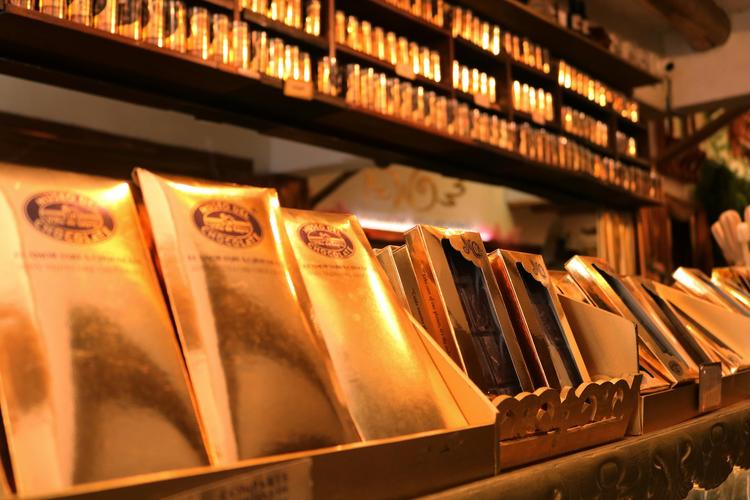Notre conversation reflète notre identité complexe. Qui de mieux que deux journalistes et auteurs canadiens passionnés par la langue française et expatriés à plusieurs reprises dans l’Hexagone pour nous observer ? A travers leur nouvel ouvrage, « Ainsi parlent les Français », Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau décryptent les subtilités de notre langage. Entretien.
Lepetitjournal.com : « En tant qu’étranger, on mesure mal à quel point la société française s’est organisée autour de la parole » peut-on lire dans votre ouvrage. On aurait tendance à penser que toutes les sociétés sont structurées sur le langage. Pourquoi estimez-vous que cela se manifeste de façon plus prégnante en France ?
Julie Barlow : La langue française est à la base de l’identité française. L’unification des différents territoires et langues s’est faite sur le français. Sa préservation reste donc une valeur en soi, contrairement à beaucoup d’autres cultures. Il y a aussi la question de l’art de la conversation, qui a été inventé en France et qui s’exprime encore aujourd’hui dans l’éducation que vous recevez. Dès le plus jeune âge, les Français sont entrainés à faire des exposés, à présenter leurs idées, à argumenter. C’est l’expression qui est valorisée, plus que la communication.
Jean-Benoît Nadeau : Il y a du non-dit dans toutes les cultures mais les Français valorisent le verbal, beaucoup plus que les Nord-Américains. Placez des Français dans une piscine, ils ont des difficultés à interagir parce qu’il n’y a pas de possibilité de parler et donc pas de code. En France, on essaie de parler comme on écrit ; la maitrise de l’expression a toujours été un outil de promotion sociale et c’est cultivé très tôt, ne serait-ce que par les oraux des examens que l’on peut voir un peu partout.
A ce sujet, les nombreux débats autour de la réforme de l’orthographe ou l’écriture inclusive ont mis en lumière la volonté de conserver la langue française sous sa forme la plus pure. Quel regard portez-vous, venant d’un autre pays du monde francophone ?
Jean-Benoît Nadeau : Il y a d’un côté, le mythe d’un français pur, même si on sait très bien que ça n’a jamais existé et de l’autre, une pratique quotidienne de la langue extrêmement variée avec beaucoup de néologismes, de régionalismes. Les Français sont des Gavroches : ils sont constamment en train d’opposer le français populaire à la norme et de tester les limites. Une manière d’afficher sa subversion d’ailleurs, c’est de le faire par la parole. Le verlan en est un exemple mais il y a beaucoup d’argots assez singuliers. La langue espagnole par exemple, a 23 académies. Même la Guinée Equatoriale a la sienne. Le Québec est un foyer de normes important : nous avons créé le premier dictionnaire de français non français, et c’est une question d’années avant que nous ayons une Académie. Tout ceci est en train d’évoluer et votre président l’a rappelé lors de son dernier discours sur la francophonie : la France est un pays francophone parmi d’autres.
L’actualité politique nous montre que les moqueries, voire discriminations liées à l’accent sont encore d’usage. Il y a toutefois des accents, comme le québécois, empreints de plus de capital sympathie que d’autres. Qu’est-ce que cela reflète ?
Jean-Benoît Nadeau : Il y a de la cuistrerie et un certain protectionnisme parisien à déconsidérer les accents régionaux, alors même que l’accent de Paris est aussi, par définition, un accent. La hiérarchie est basée sur une idée longuement entretenue selon laquelle les langues régionales étaient des patois, du Français mal prononcé et non des langues à part entière. Mais il y a aussi une question de culture dans l’accent. Les Québécois par exemple n’ont pas la même culture que les Français, ne sont pas passés par le même moule scolaire et sont moins élitistes. Ils ont tendance à écrire comme ils parlent, et non l’inverse. Aussi, lorsque je parle, beaucoup plus que mon accent, c’est cette attitude là que vous entendez, peut être beaucoup plus décontractée, par rapport aux Français qui font de l’esprit. C’est pour cela que l’accent québécois est généralement bien vu.
Les Français sont parfois considérés comme réfractaires aux prétentions universalisantes de la langue anglaise. Qu’en pensez-vous ?
Julie Barlow : Vous n’êtes pas, en France, menacés par la langue anglaise, tandis qu’au Québec il y a des lois assez strictes pour éviter que le français disparaisse. Nous sommes entourés de 300 millions d’anglophones, l’anglais entre très vite dans le discours public et quelqu’un qui veut s’angliciser chez nous peut le faire facilement : il y a des chaines de télé, de radio, le cinéma, les lycées et universités anglophones…C’est surprenant de voir comment les Français conçoivent souvent l’apprentissage d’une langue comme un jeu à somme nulle ; comme si en apprenant une autre langue, on risquait de perdre le français. Vous êtes perçus et projetez une image de personnes qui ne sont pas capables d’apprendre l’anglais. Lorsque mes filles étaient scolarisées à Paris, même le directeur de l’école tenait ce discours. Est-ce la façon d’enseigner l’anglais qui est mauvaise ou est-ce que vous avez tellement d’attentes que vous refusez de reconnaître que vous parlez anglais ? La question est ouverte. Il demeure une sorte de gêne autour de l’anglais, peut-être parce que votre méthode n’est pas adaptée à une langue moins structurée et que les variations de lexique ne sont pas compatibles avec un dictionnaire normatif à la française. On a d’ailleurs coutume de dire que l’anglais ne s’apprend pas, il s’attrape.
« En matière de pessimisme systématique, personne ne fait mieux. Les Français sont les champions du monde, catégorie poids lourd, de la négativité outrancière » écrivez-vous. Comment l’expliquer ? Quelles évolutions avez-vous observées ?
Jean-Benoît Nadeau : Un de mes bons amis dit que c’est le vieux réflexe paysan qui s’exprime encore. Historiquement, les Français étaient taxés à la richesse apparente. Ils auraient donc développé une manière de présenter les choses négativement en public - l’argent qu’on n’a pas, le fait que « non, ça ne va pas bien » - pour réclamer plus ou tout au moins ne pas s’attirer plus d’imposition. Depuis la révolution, ce discours s’est développé, en parallèle au discours apologétique du pouvoir, avec le recours à la manifestation comme un forum politique légitime, au même titre qu’un autre. Chez nous, le pouvoir de la rue est suspect. Si vous avez 25.000 personnes dans la rue, on parlera d’émeute. Aujourd’hui, beaucoup de discours politiques en France se nourrissent de ce négativisme. Je ne dis pas que ce n’est pas fondé mais l’universalité du discours questionne. Parce qu’il y a de nombreuses causes qui arrivent de toutes parts, le négativisme à la française est un sujet de réflexion constant est reste l’un des grands mystères que nous abordons dans notre livre.
Julie Barlow : Ce pessimisme n’est pas figé, il dépend des périodes. Quand nous sommes venus en 1999 par exemple, il y avait d’un côté l’euphorie black-blanc beur liée à la coupe du monde de football et de l’autre, les agriculteurs qui s’en prenaient aux fast-food. Avoir une posture de négativisme fait partie des réflexes, comme le fait de dire non pour éviter de se tromper. Quelqu’un qui vient d’une culture valorisant l’optimisme aura tendance à penser que les Français sont de mauvaise humeur. Mais ce n’est pas du tout le cas ; ils valorisent, davantage que d’autres, l’idée d’aborder les choses avec un esprit critique. Dès que l’on prend le temps de converser avec des Français, on voit bien qu’ils sortent de ce négativisme.
Quel est selon vous le plus grand tabou dans la conversation française ?
Jean-Benoît Nadeau : La peur de se tromper, de paraitre ignorant ou de se ridiculiser est un tabou suprême. Les Nord-Américains sont terrifiés par l’idée de ne pas être appréciés, d’où leur sourire constant. Pour les Français, ne pas apparaître accueillant ou sympathique, c’est secondaire par rapport à l’obsession de la faute. Ce n’est pas une coquetterie, votre droit est comme ça, l’école vous a éduqués comme ça.
Julie Barlow : Ce n’est pas votre faute !
Ainsi parlent les Français – Codes, tabous et mystère de la conversation à la française
De Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau.
Editions Robert Laffont, 396 pages, 21 €