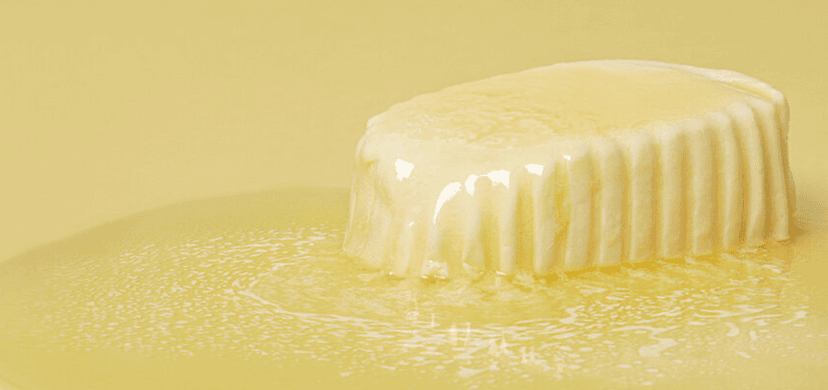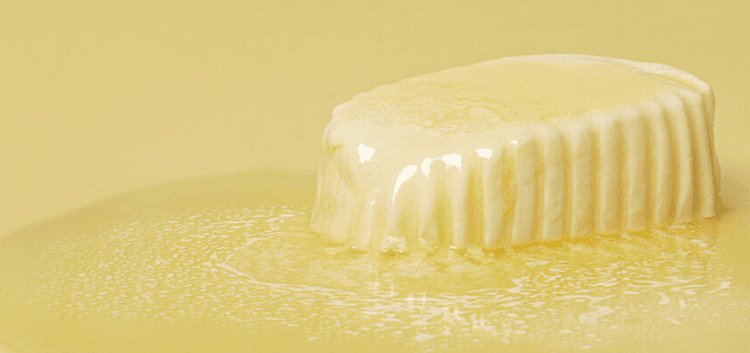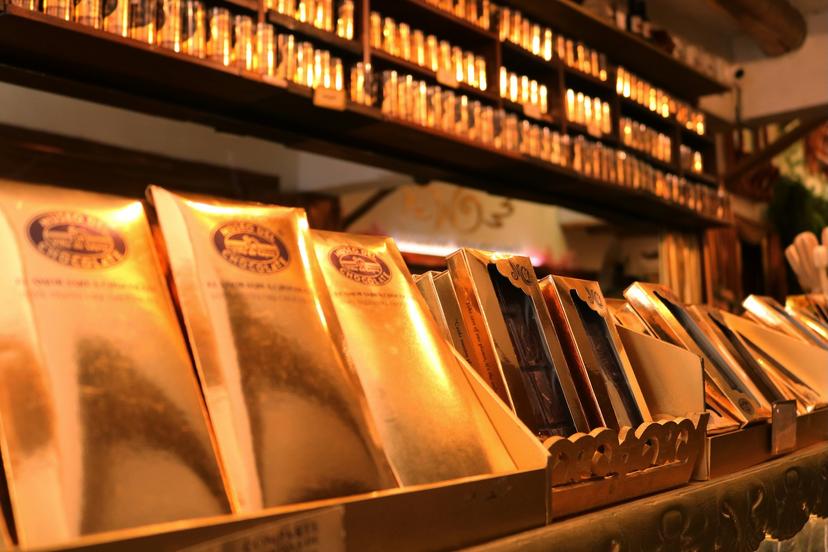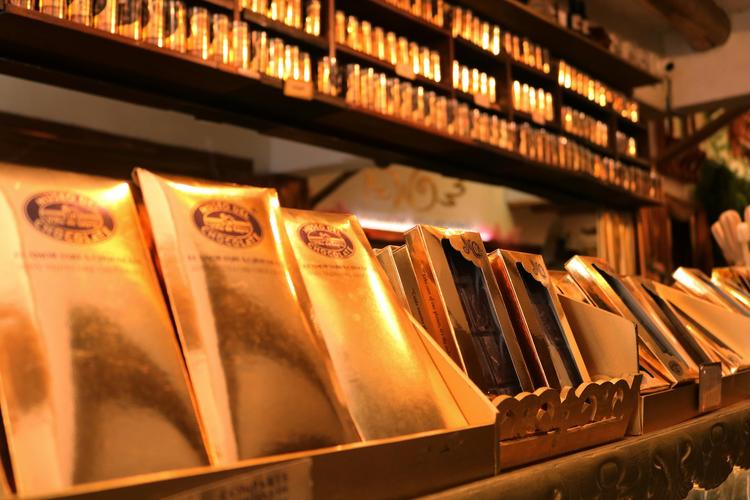Alors que la parité politique est notée comme un objectif international clé de l’Agenda 2030, les chiffres révélés par les Nations Unies et le nouvel index d’Oxfam France rappellent le retard mondial dans ce sens. Avec à peine 12 % de femmes cheffes d’État dans le monde, et une France où seuls 28 % des postes de pouvoir sont occupés par des femmes, l'ONU estime qu’il faudra attendre encore 130 ans pour que la parité devienne réalité.


Les chiffres sont sans appel. Selon les dernières estimations des Nations Unies relayées dans l’Index 2025 de la féminisation du pouvoir d’Oxfam France, il faudra encore au moins 130 ans pour atteindre une représentation paritaire entre les femmes et les hommes dans les sphères politiques à l’échelle mondiale. Un déséquilibre immense qui illustre à quel point les femmes sont encore largement tenues à l’écart des postes les plus influents.
Une exclusion politique ancrée dans l’histoire
L’inégalité actuelle dans les sphères politiques s’inscrit dans une longue histoire d’exclusion des femmes du pouvoir. En France comme dans la plupart des pays, les femmes ont été juridiquement et culturellement tenues à l’écart de la vie politique pendant des siècles. Jusqu’au XXe siècle, la notion même de citoyenneté active leur était refusée. Elles étaient considérées comme intellectuellement inférieures, moralement instables, et destinées à la maternité.
L’arrivée des femmes en politique débute lentement avec les mouvements féministes du XIXe siècle, mais il faut attendre 1944 pour que le droit de vote leur soit enfin accordé en France. Alors qu’à l’international, la première ambassadrice au monde, Alexandra Kollontaï, n’est nommée qu’en 1924 par l’Union soviétique, en France, le concours du Quai d’Orsay ne s’ouvre aux femmes qu' en 1928, mais celles-ci sont cantonnées aux services administratifs. Il faut attendre 1930 pour que Suzanne Borel devienne la première diplomate française, sans jamais accéder à un poste consulaire, et même 1972 pour qu’une femme, Marcelle Campana, soit enfin nommée ambassadrice.

« Les femmes ont longtemps été formellement exclues du pouvoir »
En parité politique, la France régresse
Ainsi, « les femmes ont longtemps été formellement exclues du pouvoir », rappelle le rapport d’Oxfam France. Des conséquences encore visibles aujourd’hui puisque selon son rapport, seules 28 % des positions de pouvoir (toutes sphères confondues) sont occupées par des femmes en France aujourd’hui. Le pays n’a jamais connu de présidente de la République, et seulement 3,8 % des gouvernements sous la Ve République ont été dirigés par une femme. À l’Assemblée nationale, la proportion de députées a reculé depuis les législatives de juin 2024, chutant à 36 %, au-dessus de la moyenne européenne (32,2%), tandis que le Sénat n’en compte que 37,4 % et qu’aucun groupe parlementaire n’atteint aujourd’hui la parité. Le déséquilibre se reflète aussi dans les cercles de pouvoir moins visibles. Dans les cabinets ministériels, 80 % des membres sont des hommes, et la tendance est similaire dans les grandes villes où deux tiers des entourages des maires sont masculins. Le bilan fait donc de la France un élève moyen malgré des lois paritaires pionnières comme la décision d’Emmanuel Macron d’appliquer la parité au sein du gouvernement.
‼️ 80% des maires sont des hommes.
— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) April 8, 2025
‼️ 60% des adjoins sont des hommes.
‼️ 90% des présidents de conseils communautaires sont des hommes.
🔴 La parité est respectée dans les communes de plus de 1 000 habitant·es. Elle doit maintenant l’être partout. C’est une victoire ! pic.twitter.com/kAe0pE85BK
Le retard est encore plus criant à l’échelon local. À peine 20,8 % des maires, 21,8 % des présidents de département et 29,4 % des présidents de région sont des femmes. Parmi les rares exceptions positives, l’Occitanie se distingue avec 5 départements sur 13 dirigés par des femmes et trois maires de préfecture (Foix, Albi, Montauban). La Réunion affiche une gouvernance exemplaire avec Huguette Bello à la région et Ericka Bareigts à la mairie de Saint-Denis. En Guyane, les trois principaux postes exécutifs locaux sont occupés par des femmes. À l’inverse, des territoires comme la Guadeloupe, la Normandie ou Mayotte présentent des taux de féminisation très faibles, voire inexistants à certains niveaux de responsabilité.
Suzanne Borel : le visage d'une femme pionnière, première diplomate française

L’Europe entre progrès et retards importants
En Europe, ce sont les pays scandinaves qui se tiennent en tête en matière de représentation féminine. En Islande, en plus d’une quasi parité chez les députés, la Première ministre est une femme. Le pays applique une politique volontariste depuis plusieurs décennies, avec des partis politiques qui se sont auto-imposés des règles de parité interne. Mêmes dynamiques au Danemark, où 45 % des élus au Parlement sont des femmes et en Finlande où l’ancienne cheffe de gouvernement Sanna Marin avait formé un cabinet à majorité féminine jusqu’à son départ en 2023. L’Espagne fait aussi office de pionnière avec le gouvernement de Pedro Sánchez qui comptait encore récemment plus de femmes que d’hommes (14 femmes pour 9 hommes).
En revanche, l’Italie de Giorgia Meloni, première femme à diriger le pays mais qui est critiquée pour avoir nommé seulement cinq femmes ministres, et surtout dans des portefeuilles non régaliens. Les pays d’Europe centrale et orientale affichent généralement des taux de représentation féminine plus faibles. En Hongrie, seulement 14 % des députés sont des femmes, presque autant qu’en Roumanie où 19,1 % femmes députés avec un gouvernement qui ne compte que 15 % de ministres féminines, sans qu’aucun ministère régalien ne leur soit confié. En Bulgarie, la situation est à peine meilleure avec 24,6 % de femmes parlementaires et 25 % de femmes ministres.
La féminisation de la diplomatie, où en est-on en France ?

Des progrès inégaux à l’échelle mondiale
Mais la France ne fait pas office d’exception à travers le monde, au contraire. À l’échelle planétaire, en 2024, seules 11,9 % des chefs d’État sont des femmes et 8,3 % des chefs de gouvernement, selon les données des Nations Unies reprises dans le rapport d’Oxfam. Cette sous-représentation est encore plus marquée dans les pays en conflit ou au sein des régimes autoritaires, mais n’épargne pas les démocraties. Ainsi, seulement 22,9 % des ministres dans le monde sont des femmes et la parité n’est atteinte que dans 14 gouvernements sur les 193 que compte l’ONU.
Même lorsque des femmes sont nommées ministres, Oxfam précise qu’elles héritent souvent de portefeuilles dits “sociaux” (santé, éducation, égalité femmes-hommes…) tandis que les ministères régaliens (défense, intérieur, économie) restent majoritairement aux mains des hommes.
Mujeres Avenir: sororité et leadership au féminin, espoirs de la diplomatie de demain
Confrontées à des propos sexistes en plein Parlement, ces 5 femmes ne se sont pas privées de répondre. pic.twitter.com/aPyixCObq8
— Brut FR (@brutofficiel) November 11, 2019
Côté législatif, la moyenne mondiale atteint 27,2 % de femmes parlementaires, un chiffre en progression (22,4% en 2015) mais encore loin de la parité. À l’international, les pays nordiques se distinguent donc, notamment en Suède (46,1 %), en Norvège (45 %) et en Finlande (48 %), qui s’approchent de la parité depuis plusieurs années. À noter la bonne surprise du Rwanda, qui compte 61 % de femmes députées grâce à une réforme constitutionnelle. À l’opposé, des pays comme le Japon (9,9 % de femmes parlementaires), le Nigeria (3,6 %) ou le Yémen (0 %) incarnent des reculs ou des blocages institutionnalisés. À noter que certains pays d’Amérique latine (Costa Rica, Argentine, Mexique) ont mis en place des quotas progressiste qui permettent notamment au Mexique de devenir l’un des seuls États au monde à atteindre 50 % de femmes à la Chambre des députés, grâce à une législation dite “contraignante”.
Diplomatie féministe et lutte contre les violences : “la France montre l’exemple”

Une féminisation freinée par des obstacles structurels et culturels
Le rapport d’Oxfam souligne que l’accès des femmes au pouvoir reste limité par une combinaison d’obstacles systémiques : sexisme politique, manque de soutien des partis, faible accès au financement électoral, répartition inégale des charges domestiques, harcèlement et violences en politique.
Dans de nombreux pays, des femmes élues témoignent régulièrement de cyberviolences, menaces de mort, voire agressions physiques en lien direct avec leur mandat. En France, la députée écologiste Sandrine Rousseau ou encore la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet ont signalé des menaces régulières, allant parfois jusqu'à nécessiter une protection policière. En Espagne, l’ex-maire de Barcelone Ada Colau a été la cible de campagnes de harcèlement numérique orchestrées, notamment à caractère sexiste. En Tunisie, la députée Bochra Belhaj Hmida a dénoncé des attaques violentes sur les réseaux sociaux en raison de son engagement féministe. Quant à la Finlandaise Sanna Marin, ex-Première ministre, elle a été largement ciblée par des propos misogynes et des campagnes de déstabilisation en ligne, notamment durant la crise du COVID-19.
« C’est du cyber-harcèlement… On peut très bien rire sans être humiliant… »
— Quotidien (@Qofficiel) August 31, 2022
Sandrine Rousseau réagit au “compte Twitter parodique” « Sardine Ruisseau »#Quotidien pic.twitter.com/COUW1uVPs8
À cela s’ajoute la faible valorisation des compétences féminines dans les milieux politiques et une médiatisation sexiste qui continue à juger les femmes politiques davantage sur leur apparence que sur leur programme. Un climat dissuasif qui agit comme un frein à leur engagement, en particulier dans les pays où les normes patriarcales sont fortement enracinées.
« La juste représentation des femmes aux postes de pouvoir est à la fois une question de justice mais également une condition essentielle pour faire avancer les droits des femmes

Un changement de modèle à imposer ?
Si la parité politique reste un objectif lointain, l’exemple de pays comme le Rwanda, qui a revu sa constitution, ou le Mexique, qui a fait voter une loi sur la parité, mettent en avant une action volontariste des États. C’est notamment ce que plaide Oxfam qui encourage des mécanismes contraignants, un suivi statistique précis, la formation des partis politiques à la parité et des sanctions financières pour les formations qui ne respectent pas les règles.Selon l’association, « la juste représentation des femmes aux postes de pouvoir est à la fois une question de justice mais également une condition essentielle pour faire avancer les droits des femmes ». Ainsi, les politiques publiques, encore majoritairement pensées par et pour les hommes, peinent à prendre en compte les problématiques spécifiques aux femmes.
À l’échelle internationale, les Nations Unies appellent à accélérer la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n°5 sur l’égalité des sexes, et à considérer la parité politique non plus comme une option, mais comme une condition démocratique essentielle. Mais le problème dépasse le cadre politique puisque si les Nations Unies estiment qu’il faudra 130 pour arriver à la parité dans les sphères du pouvoir, l’ONU est plus pessimiste pour le reste des secteurs. Selon l’organisation, il faudra attendre près de 300 ans pour que l’égalité entre les sexes soit pleinement atteinte dans le monde, tous domaines confondus.
Sur le même sujet