

Edwin Koo est un jeune photojournaliste singapourien talentueux, connu pour ses belles images noir et blanc, dans la grande tradition de la photographie humaniste. Ses photographies sont basées sur un travail de terrain à long terme et la volonté de raconter des histoires
Edwin Koo a travaillé cinq ans pour le groupe du Straits Times comme salarié photographe avant de se lancer en 2008 dans une démarche personnelle à plein temps, à partir de Kathmandou. Il a travaillé sur les Tibétains et la guérilla maoïste au Népal, la Swat valley au Pakistan. En 2011, il est rentré à Singapour, où il a chroniqué la campagne électorale sous le titre de "Notes for a singapourean son". Il a reçu en 2012 le prix ICON de Martell Cordon Bleu. Il avait obtenu déjà en 2009, le prestigieux prix "The Getty Images Grant for Editorial Photography" et son travail sur le Pakistan avait reçu le troisième prix UNICEF Photo of the Year. Il prépare actuellement un gros travail sur le métro singapourien, déjà intitulé "Another space".
Lepetitjournal.com - Comment en êtes vous venu à devenir un photographe indépendant ?
Edwin Koo - J'ai étudié le journalisme à Singapour. Je me suis formé en autodidacte à la photographie et j'ai consacré mon projet étudiant final à un travail de photojournalisme. Avec un ami, nous avons fait une histoire sur le train en Thaïlande. Nous avons publié un livre de 100 pages dont une des copies se trouve à la NTU bibliothèque. Il est considéré comme le premier exemple de photojournalisme réalisé à l'extérieur du pays fait par des étudiants singapouriens. Ce travail m'a permis de rentrer dans le groupe du Straits Times. Au bout de cinq ans, j'ai démissionné car j'en avais assez de faire des photos de funérailles d'accidents de voitures ou des portraits de célébrités. Un de mes professeurs, un journaliste indien, m'a aidé à partir au Népal en 2008. Je voulais devenir "story teller".
Comment avez-vous choisi vos histoires à Katmandou ?
Un peu par chance, j'ai été en contact des Tibétains vivant dans un camp de réfugié devenu un véritable village. J'y ai tissé des liens d'amitié et j'ai vite été obsédé par cette énigme : pourquoi ces réfugiés essayaient-ils régulièrement de traverser la frontières alors qu'ils vivaient plutôt bien hors de la Chine ? Bien que comme immigré de la troisième génération, je me sens loin d'être aussi passionné par mes racines chinoises. Je me vois comme un Singapourien, moins pour le drapeau qu'à cause de mes expériences vécues, des gens avec lesquels j'ai grandi, de la nourriture que j'ai mangé enfant.

Swat Valley- Pakistan Paradise Lost
J'ai aussi travaillé sur la guérilla maoïste que j'ai filmé quand ils avaient posé les armes. J'ai mis plusieurs mois à comprendre pourquoi j'étais intéressé par eux. J'ai fini par trouver et j'ai intitulé ce travail "les would-be heroes". C'est une histoire sur une jeunesse perdue qui a rêvé qu'elle pouvait faire changer le monde, changer le Népal très pauvre où ils avaient grandi. C'était ça leur communisme? J'ai réalisé que j'étais un peu comme eux. Je crois aussi à un monde meilleur. Mais, au lieu de me servir d'armes, j'ai choisi de raconter des histoires et à travers mes photos, je cherche des réponses aux questions que je me pose. Ces réponses m'éclaircissent mais ne sont jamais définitives. Je pense que le pouvoir d'une photo réside précisément dans cette ambiguïté. C'est pour cela que j'ai quitté le photojournalisme salarié. J'ai cherché à m'éloigner de l'évident.
Pourquoi êtes-vous finalement rentré à Singapour ?
Pour y élever mon fils et y faire un travail politique avec un impact social. En rentrant il y a deux ans, j'ai observé que la ville avait beaucoup changé, plus de centres commerciaux et de moins en moins d'arbres en centre-ville. Le système que nous avons créé pousse les gens à rechercher ce qui se mesure en dollars et en cents. Cela finit par créer une société de classes. On importe une main d'?uvre étrangère pour répondre aux besoins de consumérisme et nos enfants s'habituent à ce que les gens qui les servent soient des étrangers. Ils finissent par penser que ces personnes sont inférieures. Nous risquons de nous retrouver dans une société raciste comme celle d'Afrique du sud.
J'ai commencé par une série de photos sur la campagne électorale de 2011. Beaucoup de Singapouriens l'ont suivie sur Facebook. Je faisais des photos tous les jours durant la campagne et les gens m'envoyaient des messages. C'était la première fois qu'un travail très personnel sur une campagne électorale était diffusé à Singapour. J'ai photographié aussi bien des leaders de l'opposition que des meetings du PAP. Je voulais montrer l'histoire, car je ne crois pas que raconter l'histoire puisse être seulement le droit des gens qui sont au pouvoir. L'histoire appartient à tous. Ces élections ont d'ailleurs été suivies par toute une nouvelle vague de photographes qui se sont retrouvés spontanément dans la rue et sentaient que quelque chose était en train de changer.
Pouvez-vous nous parler de ces nouvelles forces plus libres et créatives à Singapour ?
Pour l'instant, on voit encore surtout l'art qu'on regarde pour sa valeur commerciale alors que nous avons besoin d'art qui traite des problèmes sociaux. La photographie a ce type de pouvoir. Sa responsabilité est de montrer la vérité. Il y a une place à Singapour pour la photographie comme miroir de la société, un medium de changement social.
Êtes-vous personnellement reconnu par l'establishment singapourien?
Franchement, si je présente mes photos dans des galeries Singapouriennes, je suis convaincu qu'on va me demander de les modifier ou qu'on va les refuser: la guérilla maoïste népalais à cause de notre passé de lutte anti communiste, les Tibétains à cause de la Chine, la Swat valley pakistanaise à cause de la contagion terroriste ?Singapour reste un pays très méticuleux sur ce qu'on peut montrer ou pas. Notre système essaie d'aider les gens sur ce qu'ils doivent penser.
Mais je reconnais que je n'ai pas vraiment essayé de présenter mon travail à des galeries singapouriennes. J'ai présenté l'année dernière mes photos de la campagne électorale. Je veux commencer par des sujets importants pour Singapour. Pour me faire un nom, il faut d'abord que je montre un travail qui concerne les singapouriens en direct. Quand les gens commenceront me connaitre, je pourrais leur montrer d'autres sortes de travaux.
Avez-vous des inspirations singapouriennes ?
Je fais partie de la deuxième génération. J'ai été inspiré par Tay Kay Chin un des premiers photographes de Singapour à documenter la ville de façon très personnelle, même si son travail est très différent du mien. Il est de la génération qui m'a précédé. J'aime aussi Sam Kang Li qui est un peu plus jeune que moi.
Si vous ne passez pas par les galeries, comment montrez-vous votre travail à Singapour ?
La nouvelle vague de photographes a le vent en poupe. Nous nous rencontrons tous les mois au Musée national pour nous montrer notre travail. C'est ouvert et gratuit. Nous organisons des expositions à la School of photography. Le festival Singapourien de la photo, présente peu de photographes singapouriens, mais nous avons une plateforme sur le web. Nous montrons aussi notre travail sur une plate-forme de photographes asiatiques "Invisible photographer". On peut aussi citer la galerie off line IPA gallery .
Vos photographies sont tendres. Vous aimez les gens que vous photographiez ?
J'enseigne la photographie documentaire à ?The school for photography?. Je dis toujours à mes étudiants qu'il ne faut pas prétendre être objectif. J'aime ce qu'a dit Garry Winogrand : "je prends une photo pour voir à quoi ressemblent les choses quand elles sont photographiées". Je fais des photos pour vous montrer ce que j'ai vu. Mon moteur c'est la curiosité.
Propos recueillis par Anne Garrigue (www.lepetitjournal.com-Singapour) mardi 20 novembre 2012
Sur le même sujet
























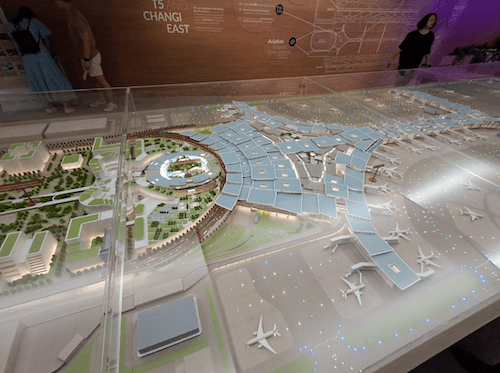
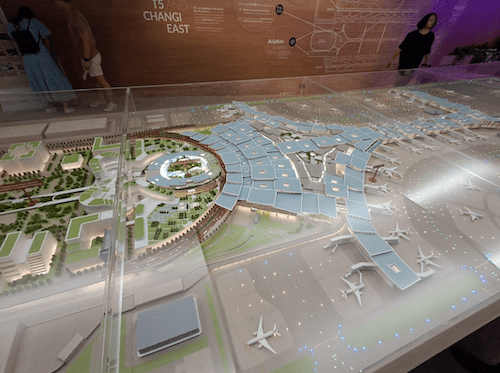


![Quatre comédiens de la comédie [title of show] sur un fond jaune semblent chanter.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbackoffice.lepetitjournal.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2025-12%2F%255Btitle%2520of%2520show%255D.jpeg&w=828&q=75)
![Quatre comédiens de la comédie [title of show] sur un fond jaune semblent chanter.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbackoffice.lepetitjournal.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2025-12%2F%255Btitle%2520of%2520show%255D.jpeg&w=750&q=75)

