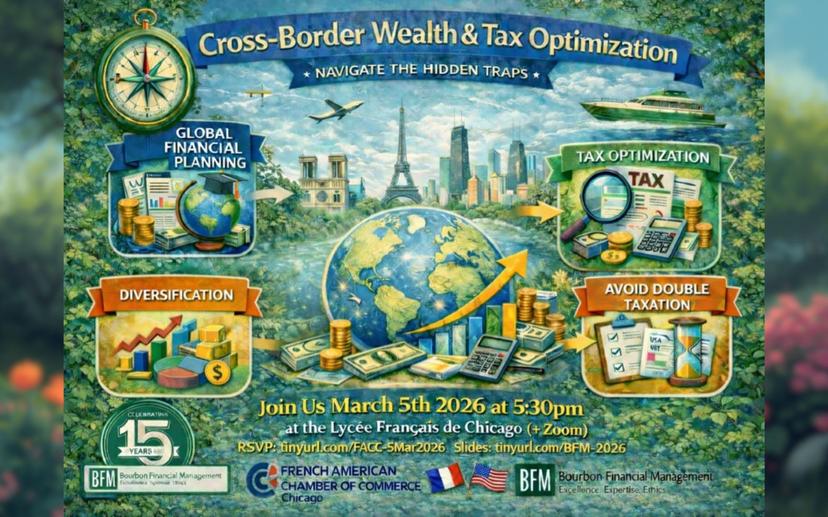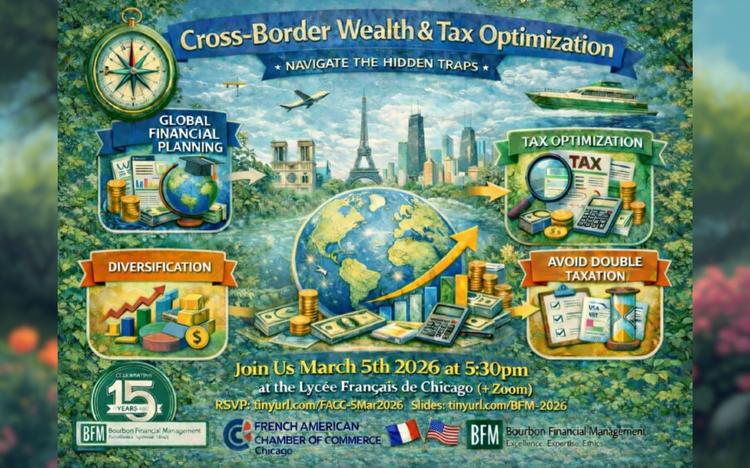Après une élection marquée par les polémiques et un retour en force sur la scène politique, Donald Trump entame son second mandat avec une volonté affichée d’accélérer la mise en œuvre de son programme. Plus qu’un candidat, il est devenu un phénomène politique polarisant, tant aux États-Unis qu’à l’international. Comment expliquer son ascension et son impact sur la démocratie américaine et mondiale ? Entretien avec Sébastien Boussois, auteur de Donald Trump, retour vers le futur, qui décrypte cette nouvelle ère trumpiste.


Réélu après une élection controversée, Donald Trump entame son second mandat avec la ferme intention d’accélérer son programme. Devenu un phénomène politique polarisant, son influence dépasse les frontières américaines. Sébastien Boussois, auteur de Donald Trump, retour vers le futur, décrypte cette nouvelle ère trumpiste.
Quelque part, ces quatre années où il a eu le sentiment qu'on lui avait volé l'élection, cet acharnement pour revenir, a décuplé ses forces
Comment décririez-vous la campagne de Trump de 2024 par rapport aux deux précédentes, de 2016 et 2020 ?
Il y a tout d'abord un phénomène de décuplage des recettes gagnantes de Donald Trump. En 2016, lorsqu’il a commencé, il n’était pas vraiment connu en politique. Les gens accrochaient surtout au côté paillettes. Petit à petit, il s’est professionnalisé et quand il est élu, il s’agit presque d’une surprise. Je pense qu'il était quand même à taton pour essayer de voir quelles étaient les recettes qui plaisaient le plus auprès de son électorat en termes de messages à diffuser et de moyens de le faire.
En 2020, Trump se retrouve face à Biden, cet homme politique en poste depuis plus de 40 ans, qui représente l'establishment et tout ce qu’il déteste, finalement. Et puis finalement, en 2024, Trump s’est présenté en monomaniaque. Il avait déjà été président une première fois, il promettait monts et merveilles. Il a véritablement mis en place cette machine de guerre qui avait été déjà très incarnée en 2020. Et puis, son programme : il disait ce qu’il allait faire.
Cette campagne 2024, qui, au début, était concentrée sur l'acharnement contre un vieil homme, s’est transposée sur l’acharnement ethnique de Kamala Harris. Quelque part, ces quatre années où il a eu le sentiment qu'on lui avait volé l'élection, cet acharnement pour revenir, a décuplé ses forces, mais également, celles de tout son électorat. Électorat qui, pendant cette période, a évolué. Ce n’étaient plus juste les patrons, ce n'étaient plus juste les tarés du Capitole. Il est parvenu à capter monsieur et madame Toutlemonde parce qu’il représentait pour eux la possibilité d'augmenter leur pouvoir d'achat. Il a surfé dessus.
Donald Trump n’adopte pas le ton mesuré des discours politiques traditionnels. Il est direct, cash, ce qui séduit une partie de l’électorat lassée des promesses creuses et des compromis du système politique classique. En ce sens, il incarne une forme de sincérité, ou du moins une posture perçue comme telle.
Comment expliquez-vous que Donald Trump soit un personnage aussi polarisant, tant aux États-Unis qu’à l’international ?
Donald Trump est polarisant parce qu’il a – si l’on peut dire – le mérite de faire ce qu’il dit et de dire ce qu’il fait. Lorsqu’il prend des engagements, il met tout en œuvre pour les concrétiser. Il aime aussi marquer les esprits par des symboles forts : des décrets signés en grande pompe à la Maison-Blanche, puis annoncés immédiatement devant ses partisans dans une arène. C’est ce qui effraye justement.
Ses positions sont tranchées, parfois jugées archaïques, mais elles incarnent une certaine vision de l’Amérique : ce qu’elle a été, ce qu’elle est et ce qu’elle devrait redevenir. Son discours est simple, voire binaire. Or, plus un message est simplifié, plus il a tendance à diviser. Ses déclarations fracassantes sur les Haïtiens qui mangeraient des chiens et des chats illustrent cette capacité à cliver.
Il n’adopte pas le ton mesuré des discours politiques traditionnels. Il est direct, cash, ce qui séduit une partie de l’électorat lassée des promesses creuses et des compromis du système politique classique. En ce sens, il incarne une forme de sincérité, ou du moins une posture perçue comme telle.
À l’international, sa politique protectionniste, qui vise à faire primer les intérêts américains, l’a aussi rendu impopulaire. Il a remis en question les accords commerciaux, imposé des sanctions à des pays qu’il estime ne pas jouer le jeu en matière d’échanges économiques, et s’est montré intransigeant sur l’immigration. De plus, il a exigé que les membres de l’OTAN contribuent davantage à leur propre défense, lassé de voir les États-Unis assumer une part disproportionnée du fardeau financier.
Cette posture l’a conduit à des affrontements diplomatiques, car il n’hésite pas à mettre ses alliés face à leurs contradictions. Il les pousse à se questionner sur leur souveraineté énergétique, militaire et stratégique. Il agace, inquiète, mais il force aussi l’Europe et d’autres régions du monde à prendre leurs responsabilités. En fait, Trump suscite autant d’attraction que de répulsion. D’un côté, son Amérique inquiète et dérange. De l’autre, elle oblige ses partenaires internationaux à repenser leur autonomie. C’est sans doute ce qui dérange le plus.
Voyez-vous une volonté de la part de Trump d'accélérer sa politique par rapport à 2016 ?
Donald Trump a réellement mis en place une usine à gaz. Plusieurs analystes politiques américains pointent l’état d’épuisement en moins d’un mois des journalistes américains, qui doivent faire feu de tout bois. Je pense qu’il y a une volonté de sa part de multiplier la signature des décrets, pour que certains passent entre les mailles du filet. Mais après, les lignes de conduite, elles sont celles dont il avait parlé, c'est-à-dire son obsession de résoudre les conflits. Il ne discute qu’avec les plus forts, l’Ukraine et la Palestine ne seront pas les gagnants.
Autour de lui, ses conseillers sont expérimentés et ont de l’ancienneté, même s’ils sont radicaux et trumpistes. Ils ont tous une volonté d’apporter rapidement des résultats et de mettre en application tout ce que le président souhaite mettre en place.
Enfin, Trump veut surtout prouver aux dirigeants du monde entier qu’il peut réaliser énormément de choses de son programme dans le temps qui lui est imparti, en contradiction avec certains dictateurs ou chefs d’Etat, qui disent avoir besoin de plus de temps que le mandat qui leur est offert.
Donald Trump a su mobiliser un électorat bien plus large que son cercle de partisans inconditionnels habituel.
Est-ce qu’il y a des leçons à tirer du phénomène Trump et de son élection, notamment pour l’Europe ?
C’est une question complexe, car nous assistons aujourd’hui à l’essoufflement d’un cycle démocratique. Depuis 2020, la démocratie américaine a été largement critiquée, notamment après l’assaut du Capitole, qui a franchi des limites inacceptables. Ces événements étaient scandaleux et inédits dans l’histoire politique récente des États-Unis.
Mais si l’on prend du recul, on constate que Donald Trump a dû faire face à une opposition massive : la justice, une partie de l’establishment politique, les médias traditionnels… Malgré cela, il a remporté l’élection avec une marge significative. Ce qui interpelle, c’est que, dans de nombreux pays européens, les présidents élus bénéficient souvent du soutien des grands industriels, du complexe militaro-industriel ou encore de connivences médiatiques et s’ils représentent 30% de l’électorat, c’est déjà beaucoup. Or, Trump s’est imposé dans un système qui lui était largement hostile, sans ces appuis traditionnels.
Son élection repose sur une forme de plébiscite. Bien sûr, ses opposants restent nombreux et déçus, mais il a su mobiliser un électorat bien plus large que son cercle de partisans inconditionnels habituel. Il a notamment attiré des minorités – afro-américaines, latinos, asiatiques, arabes – qui, a priori, n’étaient pas acquises à sa cause. C’est un phénomène marquant, surtout lorsqu’on compare cela aux démocraties européennes, où l’abstention atteint des niveaux records et où l’électorat est devenu extrêmement volatil.
En France, par exemple, nous avons un président qui ne représente plus grand-chose aux yeux de la population. Il convoque des élections, mais ne respecte pas toujours le vote majoritaire des Français, ce qui renforce encore la défiance envers les institutions démocratiques.
Nous passons beaucoup de temps à critiquer ce qui se passe aux États-Unis, mais il ne faut pas perdre de vue nos propres fragilités démocratiques. Paradoxalement, malgré ses dérives et ses dysfonctionnements, la démocratie américaine conserve une forme de vitalité que l’on peine à retrouver en Europe.
La question centrale sera de savoir si, à l’issue de ce mandat, les Américains auront le sentiment d’avoir inversé la tendance du déclin perçu. C’est cette perception qui a joué un rôle clé dans son élection et qui conditionnera l’évaluation de son bilan.
Pensez-vous que ce second mandat de Trump marque un tournant définitif dans la politique américaine et les démocraties telles qu’elles sont ?
Ce second mandat marque indéniablement un tournant spectaculaire, car tout ce qui est mis en place aujourd’hui se fait, selon Trump, exclusivement dans l’intérêt des Américains. Il est prêt à tout remettre en cause : détricoter les accords internationaux, renégocier ou sortir des accords bilatéraux, avec le Canada, le Mexique ou le Groenland, défier les organisations internationales en les privant de financements et même sanctionner la Cour pénale internationale, dont les États-Unis ne font même pas partie. Son objectif est clair : restaurer la position dominante des États-Unis sur la scène mondiale.
La question centrale sera de savoir si, à l’issue de ce mandat, les Américains auront le sentiment d’avoir inversé la tendance du déclin perçu. C’est cette perception qui a joué un rôle clé dans son élection et qui conditionnera l’évaluation de son bilan.
Un autre changement majeur, bien qu’il ne soit pas directement de son fait mais dont il se sert allégrement : le déclin du multilatéralisme des institutions internationales. Trump exploite habilement cette situation pour remettre en question la légitimité de ces structures. Il a fallu son arrivée au pouvoir pour mettre en lumière la perte d’influence des Nations Unies, aujourd’hui largement paralysées. Les déclarations d’Antonio Guterres, par exemple, ne débouchent sur aucune action concrète.
Trump n’hésitera pas à contourner les règles si cela sert les États-Unis.
Un paradoxe intéressant est que Trump ne s’attaque pas directement à ses adversaires traditionnels, mais plutôt et surtout à ses alliés. Certains ironisent en disant qu’il pourrait devenir le leader des puissances dites “sub-globales”, en amorçant des rapprochements stratégiques avec des pays traditionnellement opposés aux États-Unis. Il n’a par ailleurs jamais exclu un retour de la Russie dans le jeu diplomatique via un allègement des sanctions. Il n’a pas non plus écarté un accord économique avec la Chine, quitte à abandonner Taïwan en échange de meilleures relations commerciales.
Ce qui se joue actuellement est une transition du multilatéralisme au transactionnalisme, où les décisions ne passent plus par les grandes assemblées internationales, mais se nouent directement entre États, de manière pragmatique et opportuniste. Trump ne fait que précipiter un phénomène déjà en cours : la marginalisation des institutions créées après 1945.
L’impact de cette évolution sur la stabilité mondiale reste incertain. Sommes-nous en train d’entrer dans une ère où chaque nation négocie en direct, hors des cadres établis ? Cette approche pourrait favoriser une sorte de “société internationale du troc”, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts immédiats.
Ce qui est sûr, c’est que Trump n’hésitera pas à contourner les règles si cela sert les États-Unis. Il ne cherche plus à être le maître des institutions internationales, mais à construire un nouvel ordre mondial alternatif, affranchi des structures traditionnelles.
Sur le même sujet