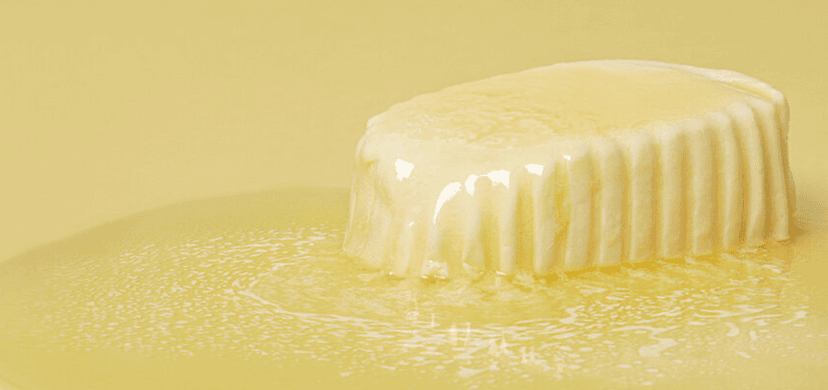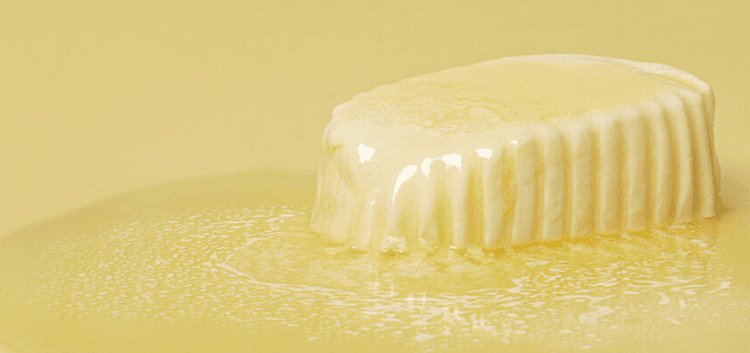La célèbre expression « femme d’expat’ » semble se décliner de plus en plus au masculin. Entre pères poules et mères carriéristes, le modèle familial se recompose aussi à l’étranger, générant sacrifices et déboires mais aussi joies et réinvention de soi. Adrien, Jean-Michel, Nathanaël et Stéphane lèvent le voile sur leur expérience de conjoint suiveur.
« Ma conjointe avait une opportunité professionnelle réelle pour démarrer sa carrière. Ça n'a pas été une décision facile à prendre car j'avais une très bonne situation en France. Le plus dur est de faire le saut ». Pour Adrien, comme pour beaucoup, ce « saut » est synonyme de renoncement. Celui ou celle pour lequel le couple s’expatrie gagne généralement en salaire et en responsabilités, alors que le suiveur doit parfois accepter de se brader pour rester actif. Néanmoins, lorsqu’entrent en jeu l’équilibre du couple et le souhait commun de se lancer dans une nouvelle étape, le sacrifice devient marginal. « Beaucoup de personnes saluaient mon courage mais je crois que ça n’a rien à voir avec ça. Pour mon couple, c’était une évidence ». Alors qu’il travaille depuis vingt ans comme chef de rayon à Toulon, Jean-Michel quitte tout pour rejoindre, à Hanoi, celle qui deviendra son épouse.
D’après une étude menée par Expat Communication auprès de 3 000 expatriés français, seuls 9% des conjoints d’expatriés étaient des hommes en 2015.
« Penser à d’autres choses et penser les choses autrement »
C’est ainsi qu’Adrien, qui a suivi sa conjointe en Colombie, définit la réinvention de soi nécessaire au conjoint. « L'avantage principal, le temps libre à disposition, peut être relativement stressant après 7 ans d'activité professionnelle. La difficulté est dans la recherche de sa raison d'être ici, ce qui demande de redéfinir son quotidien et de se fixer de nouveaux objectifs ». Ressenti partagé par Nathanaël, nordiste de 45 ans qui occupait un poste de responsable du développement de l’offre bancaire à la MACIF lorsque sa femme est mutée à Valence, en Espagne. « Il faut beaucoup positiver. Surtout au départ, car, sans contrainte, les journées peuvent parfois paraître longues ». Sport, lecture, écriture, cinéma, visites, tout est bon pour occuper ses journées.
Le tout est de garder cette soif de découvertes que partagent nos quatre interlocuteurs. Stéphane, Mauricien embarqué par sa compagne française à Nosy Be (Madagascar) puis Katmandou (Népal), raconte avoir « beaucoup sillonné la ville à pieds. J’écrivais pas mal sur mon blog, j’étais curieux, à l’affût de tout ». Pour Nathanaël, la première année en tant que conjoint suiveur a été l’opportunité de se consacrer à la photo. « J’en fais depuis tout petit mais je n’avais jamais eu le temps de les retravailler, les trier, les partager avec mes proches ». L’apprentissage de la langue locale, formalité pour certains et calvaire pour d’autres, constitue une clé de l’intégration. « Moi qui détestais le karaoké », confie Jean-Michel, « j’étais bien obligé de faire illusion en chantant en vietnamien ».

Allô papa bobo. Le nouveau quotidien des hommes aux fourneaux
« Ici, j’ai vraiment un rôle d’homme au foyer, je conduis mes filles à l’école le matin, je vais les chercher le soir. Entre temps, je m’occupe du jardin, de la piscine, j’ai même appris à faire la cuisine. Et puis il y a l’administratif qui prend un temps fou. L’immatriculation du véhicule, la fiscalité, la sécurité sociale, m’ont valu pas mal de déplacements et occupé les premiers mois ». Nathanaël ne voit cependant pas sa « retraite avant l’heure » comme une contrainte. « Même si j’ai perdu tout le relationnel que j’avais en France, le temps consacré à mes filles et ma femme est un gros avantage. La découverte, ensemble, d’un nouveau terrain de jeu crée des liens extraordinaires ».
Après avoir déménagé d’Hanoi à Singapour, toujours pour suivre sa conjointe, Jean-Michel devient père au foyer de Clément, son nouveau-né. « Je m’en suis occupé à 100%, du matin au soir, pendant 6 mois. Il me regardait comme le Messie. Je faisais aussi toutes les tâches ménagères, c’était génial pour l’expérience mais c’était épuisant. C’est un sacré boulot, un vrai métier, dont on ne se rend pas forcément compte ».
« Qu’est-ce que tu fais ? Tu ne vas quand même pas faire ça toute ta vie ! »
A côté des proches de Jean-Michel qui trouvent son nouveau rôle admirable, on trouve autant de détracteurs de son statut de « dépendant ». C’est ainsi que sont généralement qualifiés les conjoints pour l’administration de leur pays d’adoption. Outre les obstacles classiques à toute expatriation (choc culturel, solitude, barrière de la langue, isolement) et malgré toute la bonne volonté du conjoint suiveur, la pression sociale reste forte. Celui qui peine à trouver, à l’étranger, un statut social substituant celui qu'il vient d'abandonner, peut devenir l’objet de jugements acerbes. Pour Stéphane, « il y avait un peu d’étonnement de la part des malgaches. Pas mal de condescendance aussi, surtout de la part des expatriés, qui pouvaient faire des blagues quand l’addition arrivait sur la table du restaurant. Quant aux Népalais, c’était carrément impensable pour eux, au vu du statut de la femme dans le pays ».
« Sangsue », « vivre aux crochets », « la famille trouvait cela périlleux » : les mots choisis par nos interlocuteurs reflètent la peur d’une image dégradée de leur dépendance financière. « J’ai l’impression que parfois l’homme d’expat’ se cache, qu’il n’assume pas », nous dit Jean-Michel. Or, plus que la perte de revenus, c’est surtout la sortie du marché du travail traditionnel qui inquiète les conjoints suiveurs.

Transformer un trou sur le CV en un nouveau projet
L’expatriation de Stéphane a été synonyme de tremplin pour lancer sa carrière de journaliste. Alors qu’en parallèle à son travail dans le tourisme, il écrit pour le magazine « No Comment » à Madagascar, il est sélectionné pour faire partie du « Mondoblog », la plateforme des blogueurs francophones de RFI. Arrivé au Népal, c’est donc tout naturellement qu’il se tourne vers ses premières amours et décroche rapidement un poste dans un journal hebdomadaire national. La recherche d’emploi à l’étranger, chez Stéphane, semble être une formalité d’une facilité déconcertante. Son secret ? Rester optimiste, curieux et accepter d’avoir un parcours non linéaire. « Il n’y avait pas forcément la question financière en jeu mais je voulais remplir mon CV. Je suis certain que quelque part derrière, les recruteurs se disent « celui-là c’est un original mais on tente l’expérience ».
S’il redoute une dévalorisation de son expérience sur le marché du travail français, Nathanaël profite également de son statut pour lancer le projet qui lui trotte en tête depuis des années. « Il faut que je valorise ce que j’ai fait, 3 ans ça passe vite et dans mon métier, je ne suis pas sur que ce soit très bien vu d’avoir pris une pause aussi longue. J’aimerais ouvrir une galerie d’art en rentrant à Lille donc je me renseigne, je noue des contacts. Ma mère est prof de dessin, ça m’a toujours chatouillé ».
Après six mois de tête à tête avec son fils, Jean-Michel commence à chercher activement du travail et se faire un réseau. « J’ai d’abord pris le premier poste qui passait par là, le temps de réfléchir à comment lancer mon activité. Depuis un an et demi, je développe un business de glaces artisanales à Singapour, toujours dans l’intention d’être plus tard à mon compte ».
Malgré les difficultés, qui ressemblent à s'y méprendre à celles des femmes d'expat', nos interlocuteurs louent à l’unisson les bienfaits de leur expérience. « Comme marathonien que je suis, je sais qu’il faut puiser dans des ressources morales pour tenir la distance. Mais l’expatriation permet de mettre plein de choses sur les rails. J’ai l’impression que rien n’arrive par hasard ». Les propos de Nathanaël résonneront-ils chez les futurs hommes d’expat’ ?
Réédition