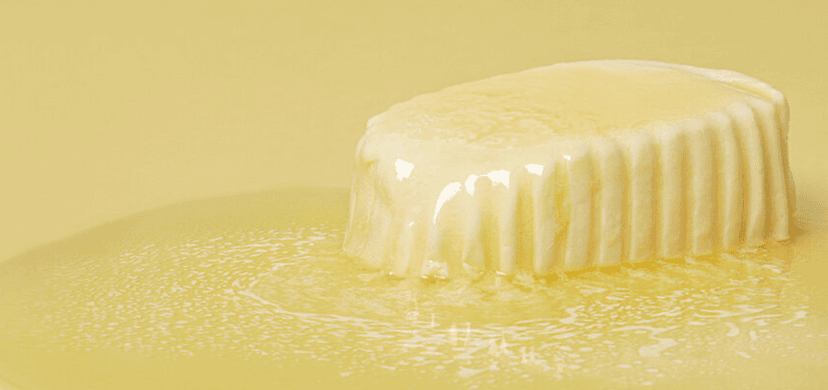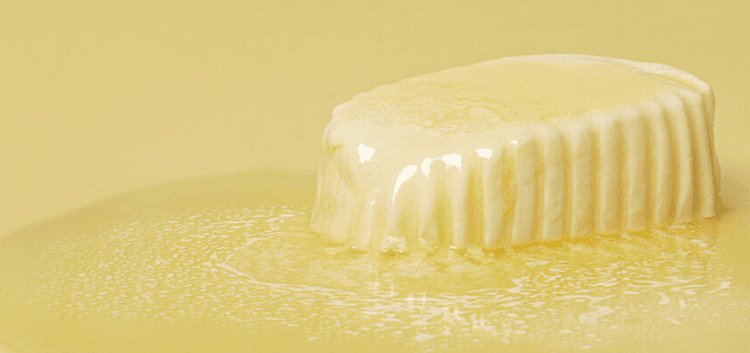De chef de rayon à directeur du plus gros marché de la marque, François Haimez (SKEMA PGE 1997) a exercé tous les métiers chez Kiabi, le leader français du prêt-à-porter. Installé au Brésil depuis mars 2018, il nous présente les enjeux du développement international de l’entreprise, et les challenges que pose le management interculturel.

lepetitjournal.com : Avez-vous toujours travaillé dans le retail ?
François Haimez : Je suis tombé dans la distribution alors que j’étais encore étudiant. J’ai travaillé chez Décathlon et à la suite d’un stage j’ai démarré chez Auchan, un an. J’ai débuté chez Kiabi en 1998 complètement par hasard, sans me poser beaucoup de questions, d’abord comme responsable de rayon puis directeur de magasin. Dans ce domaine, le terrain est indispensable. Cela permet d’avoir une vraie structure, des fondations pour travailler durablement. On comprend ainsi ce que les collègues qui sont en contact avec le client vivent tous les jours. Ces premières expériences sont gravées dans ma mémoire. Ce parcours n’était pas le plus prisé, être responsable de rayon n’est pas le rêve des étudiants en école de commerce. Mais ça m’a permis de découvrir, d’avancer à mon rythme et d’apprendre la globalité du métier. J’en suis à ma 8e vie chez Kiabi. Ma crédibilité repose sur ce parcours. Je connais les coulisses.
Comment expliquez-vous votre fidélité à cette entreprise ?
Je n’intellectualisais pas mon plan de carrière. Je ne suis pas passionné par la mode, mais j’aime les valeurs de cette entreprise. Après une infidélité de 5 ans chez Camaïeu et un congé sabbatique, j’y suis revenu. J’avais le goût d’apprendre. Mon professionnalisme m’a permis de progresser, on m’a accordé de la confiance. Je suis revenu comme directeur régional, puis directeur opérationnel assez vite (management d’un tiers de la France). Ensuite au siège, j’ai pris les fonctions de directeur marketing France. C’est seulement après qu’a commencé mon aventure internationale.

Quels sont les enjeux pour Kiabi à l’international ?
Kiabi est longtemps resté franco-français. Selon les baromètres, notre marque est leader sur le marché de la distribution textile en France (hors chaussure et accessoire) avec une clientèle populaire assumée. On entre chez Kiabi avec les rayons maternité, enfance, on y reste jusqu’à l’adolescence.
Mais le marché a été bouleversé par l’arrivée de géants du prêt-à-porter comme H&M ou Zara. Nous avons réagi en nous recentrant sur les petits prix et la famille. Pour rester forts, il fallait nous développer à l’international. On est en Espagne depuis 25 ans, on est en Italie également, mais ces dix dernières années on a mis l’accent sur une vraie stratégie de développement afin de passer au travers des secousses du marché européen. On s’est développé de deux manières : des partenaires franchisés dans de nombreux pays (une quinzaine) et des investissements en fonds propres sur les grands marchés. Après la Russie puis le Brésil, on vise bientôt l’Inde et la Chine.
C’est donc dans ce contexte que vous êtes d’abord parti à Moscou ?
Je n’avais pas spécialement envie de déménager en Russie mais il fallait quelqu’un qui ait la confiance de l’actionnaire. J’ai accepté le challenge après des débats familiaux. Ce n’est pas facile de changer de vie quand on a trois enfants, mais on aime les voyages. C’était d’ailleurs pour faire un tour du monde que j’avais posé un congé sabbatique. Professionnellement, cela a été une super expérience. On était au démarrage du projet. Kiabi avait trois magasins. On a retravaillé notre modèle commercial, notre modèle économique. C’était au moment des JO, suivis de l’annexion de la Crimée et de la crise économique russe. On a décidé de se positionner moins cher que les concurrents internationaux et à la hauteur des concurrents locaux. Quand je suis parti, une dizaine de magasins avaient été ouverts, aujourd’hui il y en a plus de 20.
Personnellement aussi cela a été très riche. On a pu découvrir le pays, la culture russe, et vivre dans une mégapole alors qu’on est des provinciaux lillois ! Grâce à la grande solidarité des Français expatriés, tout le monde a trouvé son compte. Les enfants se sont adaptés très facilement. Ma femme n’a pas pu travailler mais s’est investie dans des associations. Nous sommes restés un peu plus de deux ans. En rentrant, j’ai pris la direction de la France.
Comment êtes-vous passé de la direction de la France au marché mature à celle du Brésil, un pays où Kiabi se lançait ?
La France pour Kiabi, c’est 350 magasins, un gros morceau en termes de chiffres et de résultats. Pour quelqu’un qui a commencé comme chef de rayon comme moi, c’est un super job. Lorsqu’on m’a proposé de relever le défi au Brésil au bout de deux ans, j’ai trouvé ça curieux : pas de magasin ! Je passais d’une équipe de 5.000 personnes en France à une équipe de 25 qui avait travaillé au projet d’ouverture. Je ne suis pas un pionnier. J’ai besoin de voir la réalité concrète, des magasins, des clients, des produits. Assez vite, je l’ai vu comme une opportunité de découvrir encore autre chose. J’ai 46 ans, j’ai le temps avant de prendre des jobs sans risque. C’est une nouvelle aventure personnelle et professionnelle.
Vous venez d’ouvrir deux magasins au Brésil. Donnez-vous une identité française à la marque ?
Notre positionnement a été arrêté il y a 10 ans. Nous faisons partie de l’association familiale Mulliez, comme Auchan, Décathlon ou Leroy Merlin. Là où ces magasins s’installent à l’étranger, ils adoptent un mode de fonctionnement distributeur. Ils adaptent leur concept, leurs produits au marché, sourcent sur place et finalement rentrent dans le paysage en devenant des marques identifiées comme locales. Les Russes pensent que Auchan est une entreprise russe !
Sur le marché du prêt-à-porter, on constate une uniformisation de la mode partout dans le monde. Nous avons donc pris le parti d’implanter notre concept au Brésil, de travailler avec une collection internationale qui est la même dans tous les pays, et les adaptations sont plutôt liées aux saisons. Bien sûr, ici on va mettre un poids supplémentaire sur les maillots de bains, les débardeurs, on s’adapte au timing des saisons, et on a quelques produits spécifiques s’il y a des grandes tendances de mode dans le pays.

Les magasins sont-ils installés dans les centre-ville ?
Kiabi est né dans un format stand alone (une boite posée sur le parking d’un supermarché). Cela a très bien fonctionné en France mais c’est trompeur à l’international car ce mode de consommation n’existe que chez nous. Dans la plupart des pays, on achète du prêt-à-porter dans les centre-ville ou dans les galeries. Cela a été un handicap pour nous. Depuis seulement 10 ans on travaille sur un format différent en galerie.
On a eu la volonté de rester grand puisqu’on on sert toute la famille et qu’on veut proposer un large choix. Au delà de la surface de nos magasins, on a dû aller plus vite dans le renouvellement des produits, qu’on hausse notre niveau de mode, du fait de la concurrence directe avec H&M, Zara ou Primark. Toute notre logique a changé.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l’étranger ?
Professionnellement j’ai pris mes marques. Mais je suis encore en pleine découverte du Brésil, de sa culture, de sa langue. Je prends des cours de portugais. Je suis un manager, spécialiste de rien qui doit être crédible en tout ! Ce qui est important pour moi, c’est donc de pouvoir communiquer.
Deux choses restent un challenge pour moi. D’abord, l’adaptation interculturelle. Je suis patient, calme, avec peu de variations d’humeur. Pour les Brésiliens, c’est très étrange. Ils aiment percevoir les émotions du leader. Je ne pique pas de colères et ça les perturbe ! Je travaille donc sur moi pour montrer plus de choses, pour les rassurer. Au bout de 6 mois, ils apprécient mais ça les a surpris. En Russie c’était d’autres paramètres. D’un point de vue managérial, c’est très impactant de changer de pays. Un compte d’exploitation reste un compte d’exploitation au Brésil ou en France. Mais en termes de relations humaines, c’est super important de s’adapter.
Autre point perturbant : notre modèle commercial est populaire en France. Dès qu’on trouve une source d’économie, on en profite pour baisser les prix afin d’être accessible au plus grand nombre. Ici au Brésil, pays très protectionniste, à cause des taxes d’importation, on vend les produits 50% plus cher qu’en France. On est bien par rapport à nos concurrents mais ça ne me satisfait pas. Pour l’instant, on s’adresse à la classe moyenne voire à la classe supérieure des Brésiliens, ce qui n’est pas l’ADN de Kiabi. Avec l’élection de Jair Bolsonaro, on verra si le Brésil s’internationalise, cela nous permettrait de nous appuyer sur notre force d’achat. L’autre option, c’est d’utiliser la force de production brésilienne ou sud-américaine pour produire à moindre coût. On teste le modèle commercial et s’il réussit comme on le perçoit en ce moment, on fera un mix progressif de collections produites en local.
Ces marchés demandent de la persévérance. C’est une vraie chance pour nous d’avoir des actionnaires familiaux qui ont une vision à long terme plutôt que d’être côtés en bourse.
La distribution va faire face à de grands bouleversements avec les nouvelles technologies, l’essor de la vente en ligne. Comment voyez-vous cette évolution ?
Personne ne sait ce que sera le retail dans 10 ans. Ça bouge d’un point de vue distribution, paiement, shopping expérience, et c’est passionnant parce que certains formats vont disparaître. Mais je ne crois pas à la mort du réseau physique. On va se transformer en fonction des évolutions technologiques et des clients. Il y en a encore qui ne sont pas encore connectés, d’autres qui le sont complètement et dont on n’arrive pas à satisfaire les attentes. Le retail reste une super école de commerce et de management. C’est un marché en pleine mutation, à challenge, notamment pour les jeunes diplômés.
Sur le même sujet