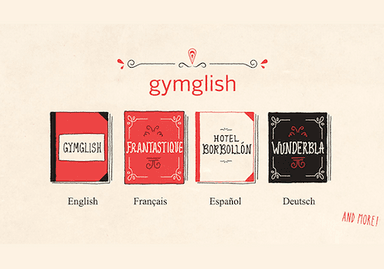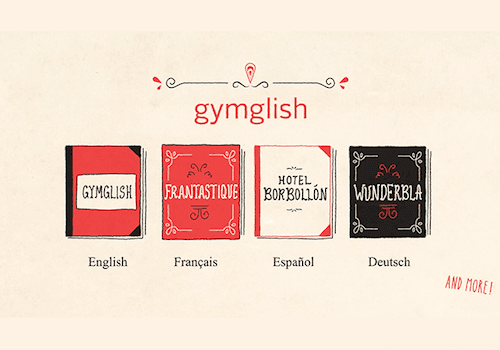Le quechua, autrefois langue dominante des Andes, disparaît peu à peu. Pourtant, certains refusent de le voir sombrer dans l’oubli.


En interview avec Le Petit Journal Lima, Héctor Dávila La Torre, découvrez une autre facette de l’histoire du Pérou et de ses communautés méconnues. Pourquoi publier un livre en version bilingue espagnol-quechua ? Quels mystères entourent encore la conquête du Pérou ? Comment reconstruire une identité péruvienne au-delà du mythe inca ? Autant de questions passionnantes auxquelles il apporte une réponse unique, entre littérature et mémoire collective.
L’histoire fascinante de la Langue des Incas, désormais en péril
Langue des Incas et l'une des plus parlées en Amérique du Sud, le quechua est le plus grand héritage vivant de l'Ancien Pérou. Pérou, Bolivie, Colombie, Équateur ou encore Argentine, ce sont près de 10 millions de locuteurs qui continuent de l’utiliser. Autrefois confinée à une petite région des Andes, la langue se développe parallèlement à l’extension de l’empire Inca autour du XVe siècle. De Lima jusqu’à Cusco et la Vallée sacrée, la langue se divise alors en de nombreux dialectes, s’étendant de la côte Pacifique jusqu’au bassin Amazonien.
A l’origine, la langue portait le nom de « Runa Simi », soit littéralement « langue du peuple », avant de devenir appelée quechua par les colons espagnols, chargés de formaliser sa grammaire par des règles écrites. Peu à peu adoptée par les incas, elle devient langue officielle du pays andin et remplaça les langues indigènes la précédant.
“Chaque année, de moins en moins de personnes parlent le quechua. Les jeunes ne s’y intéressent pas beaucoup.”Héctor Dávila La Torre

Sauf qu’aujourd’hui, comme précisé par l’écrivain Héctor Dávila La Torre, le quechua est en voie de disparition, du moins connaît un déclin en termes de locuteurs, mettant en danger non seulement une langue, mais une partie de l’identité péruvienne et de son histoire.
Pour lutter pour sa préservation, l’écrivain a notamment publié un de ses livres intitulé « El Crepúsculo de los Apu » en version bilingue espagnol-quechua, afin de pouvoir représenter l’histoire du point de vue des deux protagonistes, et ainsi d’éviter une domination de la perspective espagnole. Son roman sur la chute de l’Empire inca offre ainsi une nouvelle manière d’apprendre l’histoire, souvent résumée à quelques lignes dans un manuel scolaire, en s’intéressant à des personnages clés comme Vilac Amu, dernier prêtre et protagoniste de l’histoire. Malgré le fait que la langue soit devenue langue officielle du Pérou en 1993, de l’Équateur en 2008 et de la Bolivie en 2009, son futur reste menacé.
Quand la fiction éclaire l’histoire : une manière alternative de voir le Pérou
Ce qui a notamment poussé l’écrivain à prendre cette direction d’écriture part d’une volonté de proposer un récit alternatif à l’histoire officielle. Il prend ainsi l’exemple de l’Inca Garcilaso de la Vega, auteur péruvien à l’héritage espagnol, qui participe à la rédaction de l’histoire officielle des conquêtes espagnoles et des guerres coloniales sur le territoire péruvien. Lorsque l’histoire est racontée uniquement du point de vue des vainqueurs, elle peut être biaisée, perdant en objectivité en occultant d’autres versions des événements.

Mais alors comment sortir des chemins battus ? La solution de l’écrivain est de s’intéresser aux sources d’information alternative, à l’exemple des quipus. Un quipu est un système de nœuds et de cordes colorées utilisé par les Incas et d'autres civilisations andines pour enregistrer des informations. Souvent désignée comme une forme d’écriture numérique, elle pouvait aussi contenir des informations narratives et historiques, intéressant les historiens tout particulièrement. Ils restent cependant difficiles à interpréter.
Entre histoire et fiction : une frontière floue
Comment distinguer la fiction du réel ? L’écrivain Héctor Dávila La Torre précise ainsi que si son travail s’apparente à celui d’un historien, ses oeuvres restent de l’ordre de la fiction historique, qui questionne des événements phares tels que la défaite soudaine de l’empereur Inca Atahualpa face aux colons espagnols de Francisco Pizarro. Son but ? Dévoiler les histoires cachées derrière les récits dominants. Pour autant, ce sont des personnages de fiction qu’on retrouve dans ses romans, il ne prétend pas s’opposer à l’histoire officielle.
“C'est chercher les histoires cachées derrière l'histoire officielle, pour comprendre la vérité. Rechercher l'identité de nous, les Péruviens.”
Ainsi ce qui le motive par dessous tout, c’est comprendre l’identité complexe des péruviens, entre héritage colonial espagnol et civilisations pré-colombiennes. Difficile de déterminer qui est Inca ou non, compte tenu du nombre de communautés autochtones qui ont fait partie des siècles d’histoires du pays. Par exemple, l’écrivain provient du petit village de Chachapoyas, au bord de la Cordillère des Andes. En réalité, ces habitants sont considérés incas sans vraiment s’identifier entièrement comme tels. Chercher son identité et origine précise en tant que péruvien est difficile, en témoigne la recherche personnelle de l’écrivain, qui va sortir dans plusieurs jours un ouvrage sur ses origines.
Conserver un trésor linguistique face aux obstacles
Quel futur pour le quechua ? Son futur est intimement lié à la survie des communautés autochtones, de leurs écosystèmes et mode de vie traditionnel, au cœur des montagnes andines.
Pourtant, les menaces se multiplient. Les marées noires de plus en plus fréquentes mettent en danger les communautés Quechua et Achuar dans le nord de l’Amazonie, contaminant les cours d’eau et donc entravant leur accès aux ressources naturelles. Selon une étude d’Oxfam en 2016, Teddy Guerra, leader d’une communauté autochtone en Amazonie, entame une lutte pour que soient reconnus les droits sur la terre de sa communauté, qu'elle cultive depuis des siècles. Discrimination et marginalisation, accès limité aux services publics, exploitation des ressources naturelles et changements climatiques : autant de menaces qui pèsent sur les peuples quechua et mettent en péril leur culture, leur langue et leur mode de vie ancestral.
Préserver le quechua, c’est bien plus que sauver une langue : c’est défendre une mémoire, une identité et un regard alternatif sur l’histoire. Face aux défis qui menacent sa survie, sa transmission et sa reconnaissance sont plus que jamais essentielles pour les générations futures.
Sur le même sujet