Malgré les défis d’un territoire immense, de faibles densités de population et d’un accès inégal aux ressources culturelles, les associations littéraires francophones actives dans les provinces et territoires canadiens, à l’exception du Québec, jouent un rôle crucial. Présentes en Acadie, en Ontario, dans les Prairies et jusqu’à la côte Pacifique, elles soutiennent les auteurs, animent les communautés et assurent la transmission d’un patrimoine littéraire riche et diversifié. Leur action contribue à maintenir vivante une francophonie littéraire souvent minoritaire, mais résolument dynamique.
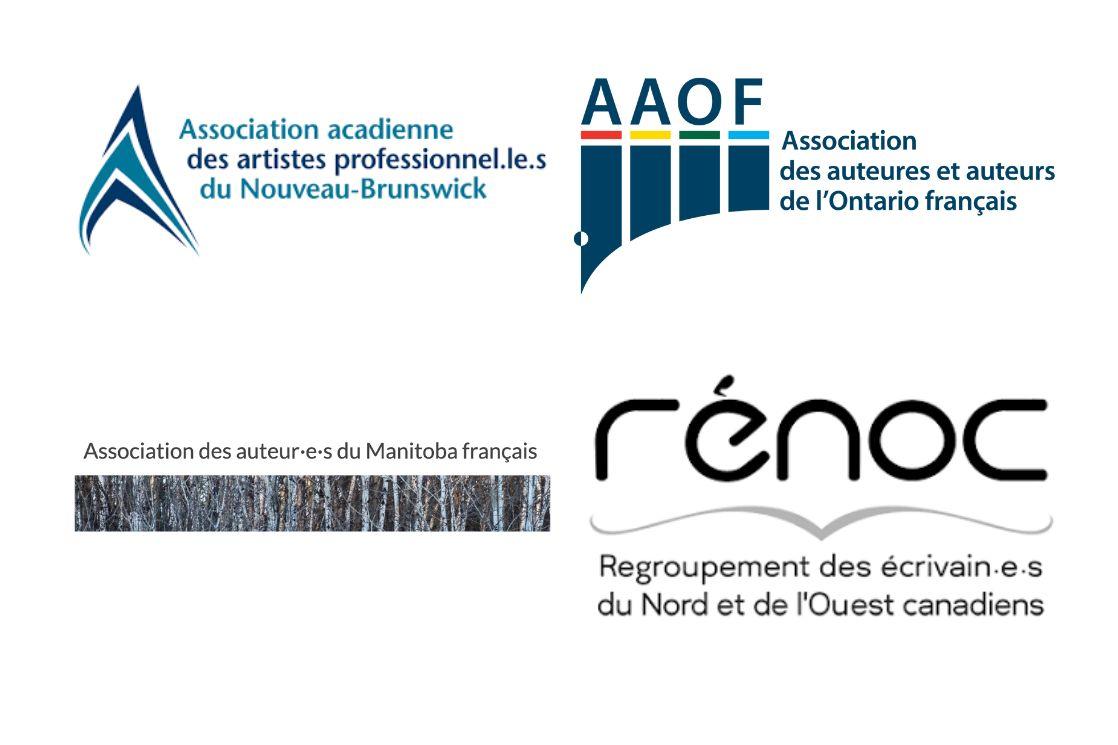

Une mosaïque de structures au service des auteurs
À l’extérieur du Québec, le Canada compte plusieurs associations littéraires francophones, chacune ayant ses spécificités. L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) regroupe des créateurs de toutes disciplines, incluant les écrivains. Elle se distingue par son travail sur le statut de l’artiste et son rôle dans la reconnaissance des talents acadiens.
Dans l’Ouest canadien, des regroupements récents comme le RÉNOQ (Regroupement des écrivain.e.s du Nord et de l’Ouest canadien) rassemblent des auteurs francophones de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires. Ces structures répondent à un besoin de proximité pour des auteurs souvent isolés.
Des mandats adaptés aux réalités locales
Contrairement au Québec, où les associations se concentrent sur des genres ou des disciplines spécifiques, les associations franco-canadiennes et acadiennes adoptent souvent un mandat multidisciplinaire.
Par exemple, l’AAAPNB inclut les écrivains dans un écosystème artistique global, qui englobe le théâtre, la danse, la musique, le cirque, les arts médiatiques et les arts visuels.
D’autres, comme l’Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF), se spécialisent dans la littérature tout en tenant compte des mutations du secteur, telles que l’auto-édition et la publication numérique. Ces mandats reflètent les besoins locaux, tout en s’adaptant aux défis liés à la taille réduite des communautés francophones.
Soutenir la carrière des écrivains francophones
Ces associations jouent un rôle crucial en offrant des services sur mesure. L’AAOF propose des programmes de compagnonnage et de lecture critique, permettant aux auteurs de perfectionner leurs manuscrits avec l’aide de pairs expérimentés.
Au Manitoba, l’Association des auteurs du Manitoba français (AAMF) met en avant la diversité de ses membres grâce à des événements comme des lectures publiques ou des ateliers.
Ce travail permet aux écrivains de renforcer leur visibilité et de tisser des liens avec leur lectorat. "Nos associations sont souvent la seule structure capable d’accompagner les auteurs dans leur parcours", explique un consultant.
Les initiatives pour rapprocher les communautés
Face à l’éparpillement géographique des auteurs francophones du Canada, les associations littéraires s’efforcent de réduire les distances, tant physiques que culturelles.
Des collaborations inter-provinciales, comme celles entre le RÉNOQ, l'AAMF, l'AAAPNB et l’AAOF, pourraient montrer comment les associations peuvent mutualiser leurs ressources pour renforcer leurs actions. Ces partenariats permettraient de mieux répondre aux besoins des écrivains isolés, tout en favorisant une approche collective des enjeux littéraires.
En parallèle, des outils numériques tels que ontarioterredemots.ca une plateforme développée par l’AAOF, jouent un rôle important pour connecter les écrivains et le public.
Ce site web, conçu pour valoriser les auteurs franco-ontariens, est un exemple de la manière dont les associations peuvent utiliser la technologie pour surmonter les défis de dispersion.
Ces initiatives renforcent les liens entre les communautés tout en donnant une visibilité accrue à la littérature francophone sur la scène nationale.
Une reconnaissance à consolider : vers quelle solution idéale ?
Les auteurs francophones du Canada qui œuvrent à l'extérieur du Québec ont-ils besoin d’une structure nationale dédiée ou d’une simple coordination renforcée entre les principaux acteurs ?
Avec seulement quatre associations majeures – l’AAOF, l’AAMF, l’AAAPNB et le RÉNOQ – une collaboration plus étroite pourrait-elle suffire pour répondre aux besoins des auteurs et mieux défendre leurs intérêts ? Cette solution permettrait d’alléger les défis administratifs tout en renforçant le rôle des associations comme porte-paroles des écrivains francophones au Canada.
Et si ces associations développaient une stratégie unifiée tout en préservant leurs identités régionales, serait-ce suffisant pour garantir le rayonnement de la littérature francophone à travers le pays ? Ou est-ce qu’une structure formelle, avec une vision nationale clairement définie, pourrait mieux relever les défis communs ?
Des questions qui restent ouvertes et qui méritent réflexion alors que le milieu littéraire évolue dans un paysage culturel et technologique en pleine transformation.
Article réalisé en collaboration avec le RIMF, avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie
Sur le même sujet















