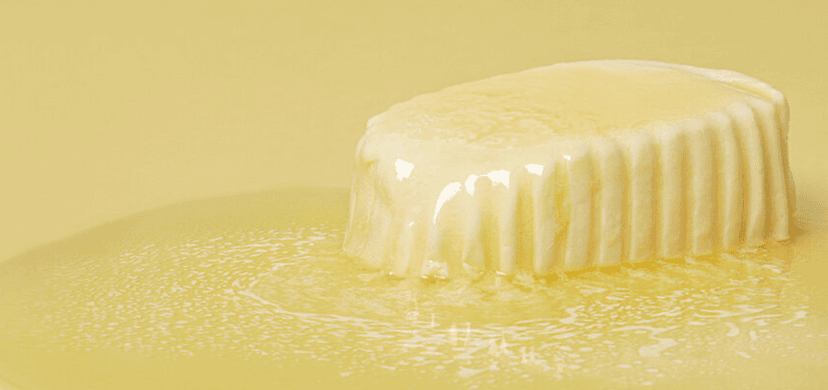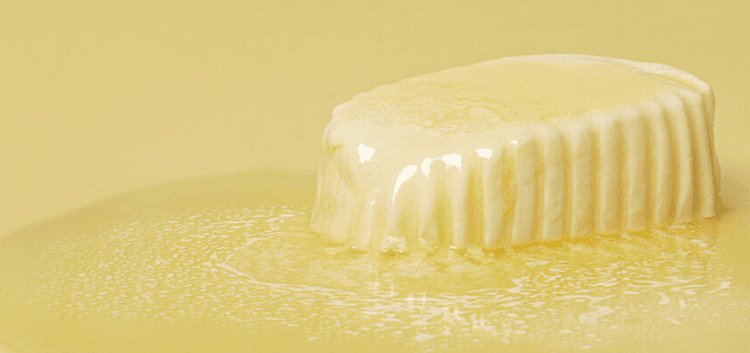En cas de séparation de couples franco-japonais, de nombreux enfants sont « enlevés » par l’un des conjoints, sans que les autorités nippones ne bougent le petit doigt. Parents français et parlementaires lancent un énième cri d’alerte.
Lorsque Vincent Fichot rentre à son domicile tokyoïte, l’après-midi du 10 août dernier, sa vie vole en éclats. Les lieux ont été vidés, ses deux enfants volatilisés. Aucun doute dans l’esprit du Français résidant au Japon depuis 12 ans : la mère les a enlevés.
La pratique concernerait près de 150.000 mineurs chaque année dans le pays. En cas de divorce dans l’archipel, l’autorité parentale n’est confiée qu’à l’un des deux parents, et, selon les statistiques officielles, à la mère dans 80% des cas. Commence alors pour Vincent une série d’interminables démêlés avec les autorités policières et judicaires nippones, pour tenter de revoir ses enfants. « J’ai porté plainte à trois reprises. On m’a ri au nez ou rappelé que si j’essayais de récupérer mes enfants, je serais condamné pour kidnapping, nous raconte-t-il, fébrile. J’ai ensuite été menacé de poursuites judiciaires si je participais à une conférence de presse. Ma femme m'a demandé de rédiger un courrier dans lequel je déclarais être un homme violent pour pouvoir revoir mes enfants. Je n’ai cédé à aucun de ces chantages ». Résultat : cela fait sept mois qu’il reste sans nouvelle de sa progéniture.
Ce sentiment d’impuissance et de désarroi, Emmanuel de Fournas ne le connaît que trop bien. Le Français passe 23 jours en garde à vue lorsque sa femme, lui promettant qu’il reverrait sa fille, le fait arrêter pour tentative d’enlèvement. En 2014, il est le premier père d’un enfant franco-japonais à engager une procédure judiciaire dans le cadre de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Bien que le Japon l’ait ratifiée en 2014, la législation nippone en freine encore aujourd’hui l’application. « Lors de l’audience, on m’a demandé de verser 500 euros par mois à mon ex-épouse le temps de la procédure, à l’encontre des règles de la Convention. C’est leur joujou, ils en font ce qu’ils veulent », condamne Emmanuel, excédé par tant d’années de démarches infructueuses.
Justice entravée
« La détresse des parents et des grands-parents privés de leur enfant demeure immense », déplore le sénateur des Français de l’étranger Richard Yung, qui planche sur le dossier depuis 16 ans. En vertu du principe de continuité (celui qui a la garde de l’enfant au moment de la décision de justice la conserve), « les juges japonais ont complètement ignoré la loi », estime Thierry Consigny. Ce conseiller consulaire élu à l’Assemblée des Français de l’étranger dénonce le commerce juteux des avocats spécialisés en divorce dans l’archipel. « Nombreux sont ceux qui suggèrent à l’épouse d’enlever l’enfant, de se plaindre d’être victime de violence conjugale. Les juges accordent alors facilement la garde exclusive ainsi qu’une pension alimentaire, indépendamment de l'intérêt de l’enfant qu’ils déclarent pourtant protéger », condamne-t-il.
Pour limiter ou retarder l’application des conventions internationales liées aux droits des enfants, la justice et le législateur japonais se sont retranchés derrière un lot d’exceptions. « Les droits de visite sont généralement de 2 à 4 h par mois dans un lieu public et en présence d’une tierce personne, expose Paul-Georges Touja, président de l’association Sauvons nos enfants Japon. Mais si l’enfant a plus de 37° de fièvre, s’il a d’autres activités prévues, s’il ne veut pas…alors les visites sont annulées ».
Face à ce que les parents français considèrent comme un déni de leurs droits et de ceux de leurs enfants binationaux, la justice hexagonale est également pointée du doigt. « Lorsqu’elles reçoivent une notification de déplacement illicite d’enfant, les autorités centrales françaises saisissent le procureur qui confiera l’affaire à un juge. Mais au Japon, c’est le parent lui-même qui doit introduire la demande de retour devant la justice. Nous pouvons lui fournir une liste d’avocats, lui expliquer les modalités de l’aide juridictionnelle ou de la médiation familiale, mais ne saurions intervenir dans le système judiciaire japonais. C’est bien là toute la limite de la convention de la Haye » se défend Nelly Chretiennot, magistrate au sein du bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile au ministère de la Justice. « Si vous choisissez la médiation au Japon, vous renoncez justement au cadre de la Convention », s’étouffe Paul-Georges Touja. Demander une aide juridictionnelle là-bas, c’est faire un emprunt et se saigner. Il faut être précis dans les termes utilisés. Tant qu’un enlèvement ne sera pas considéré comme tel, il n’y aura pas de solution. »
« Au Japon, le premier qui enlève l’enfant a gagné »
Embourbés dans un combat à l’issue incertaine, les parents multiplient les appels à l’aide et échangent des conseils au sein d’associations comme Sauvons nos enfants Japon ou Kizuna Child Parent Reunion. « N’y aurait-il pas moyen de faire pression sur le Japon comme le Golden Act aux Etats-Unis ? Au Japon, le premier qui enlève l’enfant a gagné. La seule solution qui nous reste c’est d’y aller, prendre l’enfant par la main et l’enlever à notre tour » assène Abigaël Morlet, terrifiée à l’idée de partager la garde de ses enfants avec son ancien compagnon japonais, comme le lui impose la justice française.
« La mère de mon enfant est attaquable mais par qui ? Par quoi ? C’est long, c’est coûteux, c’est énergivore. Je ne suis qu’un quidam dépourvu de moyens face à une personne issue d’une famille influente. Cela fait trois ans que ma fille est élevée dans la haine de son père », s’épanche Fabrice Taurelle, séparé de sa fille depuis 2016.

Des familles sacrifiées sur l’autel de la souveraineté
Interpellation du gouvernement français par les parlementaires, lettre envoyée en mars 2018 par 26 ambassadeurs européens au ministre de la justice japonais, pétitions et rapports à ne plus savoir qu’en faire. Le dialogue piétine. Les Japonais font profil bas, voire carrément la sourde oreille. Le siège laissé vaquant par l’ambassadeur japonais à la table ronde organisée sur le sujet par le sénateur Yung, le 8 mars dernier, donne du grain à moudre aux parents désemparés. Leur seul ressort : faire du bruit, quitte à bousculer une diplomatie officielle trop peu encline à aborder l’épineux sujet lors des grandes messes internationales ou visites bilatérales. « Je sais bien qu’il est particulièrement frustrant de s’entendre opposer sans cesse la souveraineté du Japon. Pour autant, notre ambassade multiplie les appels aux autorités japonaises », indique Sylvain Riquier, chef du service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
La problématique est d’autant plus critique qu’elle s’applique à bien d’autres pays et couples binationaux. 450 parents américains seraient ainsi concernés. Si on multiplie ces cas par le nombre d'Etats dont la juridiction s’inspire des pratiques nippones (Algérie, Allemagne, Egypte, Liban, Russie, etc.), les chiffres sont vertigineux. « Ce serait utile d’avoir un décompte, observe Richard Yung. Au moins l’on connaitrait l’ampleur du problème. Nous pouvons également former les magistrats français à cette problématique et avoir un magistrat de liaison français auprès des tribunaux japonais, comme nous l’avons fait en Allemagne, avec des résultats positifs. Mais la solution reste diplomatique et notre gouvernement doit avoir le courage d’exposer le sujet à chaque visite ».
« Quel est l’intérêt de donner la nationalité française à des enfants qui naissent à l’étranger pour qu’on nous rétorque ensuite que le Japon est souverain ? interpelle Vincent Fichot. Pourquoi aucune administration ne prend de position publique sur le sujet ? Avec le récent rappel de l’ambassadeur italien, elle a montré qu’elle en était capable. Pourquoi, quand cela concerne des droits de l’enfant bafoués, des mesures similaires ne peuvent-elles pas être prises ?
Sur le même sujet