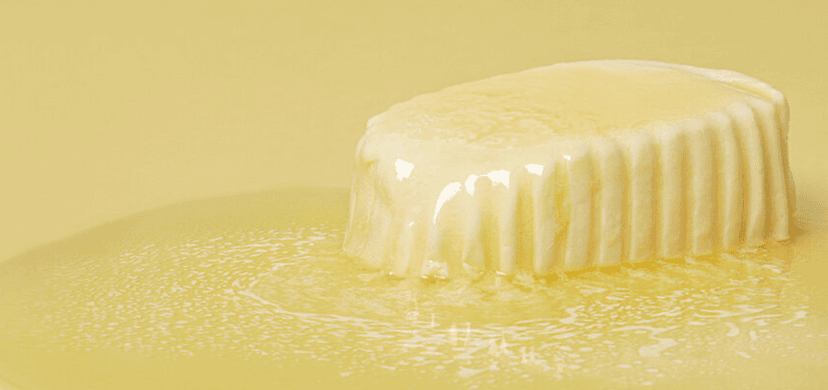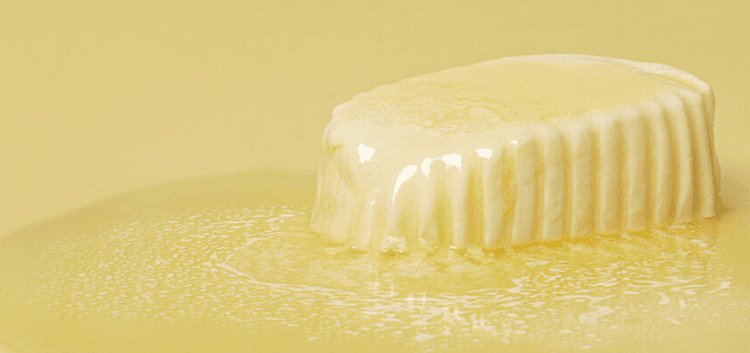Gilles Béroud, diplômé de Skema en 1996, a accompagné avec talent le développement de plusieurs marques françaises de cosmétique à l’international. Il est aujourd’hui Managing Director Asia chez Yves Rocher, basé à Singapour. Marié à une Espagnole et père de deux enfants, Gilles apprécie la richesse de son expérience professionnelle en Asie : le potentiel de croissance dans son industrie y est encore immense, malgré une concurrence des marques locales de plus en plus forte.

Lepetitjournal.com : Vous avez fait toute votre carrière dans l’industrie cosmétique, est-ce un hasard ?
Gilles Béroud : Je suis sorti de SKEMA en 1996. C’était l’époque de la bulle internet qui faisait rêver tous les jeunes diplômés, mais ça ne s’est pas fait pour moi. J’avais fait ma dernière année d’études en échange à Penn State (Etats-Unis), je n’avais pas forcément envie de rester en France.
Je devais faire mon VSNE (Volontariat du Service national en Entreprise, équivalent du VIE aujourd’hui, ndlr). J’avais sollicité une personne que je connaissais et trouvais charismatique pour avoir une première expérience professionnelle. Elle m’a donné l’opportunité de commencer en tant que coopérant à Madrid pour m’occuper des marques de fragrance du groupe Clarins. C’est une industrie dont on ne rêve pas quand on est un garçon, j’aurais préféré faire de la finance de haute voltige ou d’entrer dans une startup (rire) mais j’y ai pris goût !
Vous avez très vite évolué…
J’ai eu la chance d’avoir une carrière assez rapide. Il y a toujours eu une possibilité d’évolution au sein de la marque avant que je n’en ressente la nécessité. Je me suis pris au jeu. A 23 ans, je me suis retrouvé à monter une structure commerciale aux Canaries avec une petite équipe.
Un an et demi après, le poste de directeur commercial de la filiale espagnole s’est libéré, on me l’a proposé. Je devais gérer les grands magasins et les chaines européennes de parfumerie, avec une centaine de vendeuses. C’était le début de la concentration dans le secteur, l’avènement de Sephora, Marionnaud… Cela a été ma première vraie expérience de management. Je devais être le plus jeune du département et le seul homme, c’était un défi, mais qui s’est bien passé !
On a dû ensuite trouver quelqu’un au pied levé pour remplacer le DG du Mexique. J’étais mobile, je me suis retrouvé patron de filiale à 27 ans. Encore une fois, j’ai eu beaucoup de chance. Trois ans plus tard, on avait doublé le chiffre d’affaire et redressé les comptes. Je me suis donc retrouvé catapulté patron de l’Asie en 2001, à 31 ans.
L’Asie était-elle déjà stratégique pour Clarins à l’époque ?
Il y a treize ans, le marché était en croissance comme nulle part ailleurs. C’était le début des investissements de tous les grands groupes de cosmétique internationaux sur ce continent. L’engouement des Asiatiques pour les produits de beauté existait déjà au Japon et en Corée dans la classe moyenne et supérieure, mais en Asie du Sud Est, il y a eu une explosion du niveau de vie permettant l’accès aux cosmétiques pour de plus en plus de femmes. Dans cette région, la beauté est considérée un peu comme un investissement.
Le marché n’était pas encore aussi encombré qu’aujourd’hui de marques locales à part les marques japonaises. A présent, elles sont de plus en plus qualitatives, notamment les marques coréennes ou les marques chinoises qui atteignent un niveau acceptable.
Venant d’Espagne ou du Mexique, avez-vous dû adapter votre façon de travailler en arrivant en Asie ?
J’ai dû adapter mon management en effet. Il y avait plusieurs entités et notamment 6 pays avec des filiales qui appartenaient à la marque avec des patrons locaux expérimentés. Sur ce continent où le respect des anciens est fondamental, voir arriver un jeune homme de 31 ans sans connaissance de l’Asie et sans expérience de management à ce niveau-là n’est pas simple.
Je me suis adapté à chacun à force de disponibilité, de curiosité, de travail. Je n’ai rien imposé mais je n’ai rien laissé tomber non plus. Au bout d’un moment, ils se sont rendu compte que j’avais aussi des idées intéressantes et que je comprenais leur business. J’étais là en support, pour guider, pour donner un miroir, plus que pour imposer une quelconque recette.
Vous êtes ensuite rentré quelques années en Europe, était-ce un choix ?
J’ai du rentrer en Espagne pour des raisons familiales. En Asie, j’étais en contact avec l’Occitane avec laquelle on avait développé une joint venture en Corée. La position de patron Espagne s’est libérée. C’est là qu’il y a eu pour moi un choc culturel ! J’ai retrouvé un environnement européen plus figé. En Asie, tout est possible, les gens ont envie d’aller plus loin, ils sont entrepreneurs. Tout à coup, vous rentrez dans la vieille Europe, où la prise de risque n’est pas récompensée, où il faut faire de la politique… J’ai très mal géré ça, ça ne s’est pas bien passé.
Avez-vous fait en sorte de repartir en Asie ?
Pas dans l’immédiat. J’ai pu travailler chez Sisley, marque française de produits très haut de gamme, il y avait un challenge intéressant : la restructuration du réseau en Europe et la gestion de la Belgique en propre.
Au bout d’un an et demi, j’ai été contacté par Yves Rocher, la marque numéro 1 en France, un groupe familial extraordinaire qui était très peu implanté en Asie, le marché étant alors géré depuis Paris. Il était temps de créer une structure. Je n’ai pas hésité car c’est en Asie que j’avais eu mon expérience professionnelle la plus significative.
Comment vous êtes-vous développé ? Quel est votre positionnement ?
On a créé un bureau régional, une filiale existait déjà en Thaïlande, on a créé une filiale à Hong Kong en début d’année, on a une joint-venture à Singapour, on a lancé des marchés là où on n’était pas présents… Les investissements humains et financiers consentis par la marque commencent à payer.
On a une belle marque qui doit résonner auprès des consommatrices asiatiques. On est clairement en positionnement masstige (mot constitué sur la base des mots « mass » et « prestige » ndlr) : une marque de soins botaniques importée et accessible. On n’a pas beaucoup de concurrence : Avene ou La Roche-Posay sont plus sur la dermo cosmétique. Notre concurrent principal, The Bodyshop, n’a pas su autant se renouveler. En termes de produits et de formulations, la marque Yves Rocher a fait des progrès énormes. Aujourd’hui, nous sommes très innovants, en gardant les valeurs de M. Rocher, grâce à l’impulsion de son petit-fils Brice Rocher, qui a repris les rênes il y a deux ans.
Il y a encore de la place dans ce secteur ultra concurrentiel ?
Il y a de la place pour des bons produits. On a une expérience de plus de 50 ans dans des produits à base de « botanical active », ça fait la différence. Ce métier ne s’apprend pas du jour au lendemain. On a des chercheurs qui innovent, trouvent la bonne formulation avec en plus ce côté émotionnel de la marque familiale, que vous ne pouvez pas avoir si vous avez été créé dans un bureau de marketing.
La France est un gage de qualité, de sureté, les normes françaises étant plus strictes. Et Yves Rocher est encore plus strict dans ses normes internes. On a encore un potentiel de croissance impressionnant sur les 5 années à venir.
Sur le plan familial, est-ce facile de vivre à l’étranger ?
Oui, cela a été une décision simple. Mon épouse espagnole est partner chez Accenture, avec peut-être 300.000 employés dans le monde. Elle pouvait être mutée facilement à Hong Kong ou en Chine. L’Europe étant un peu ankylosée, je n’avais pas forcément envie que mes deux enfants y grandissent. Nous sommes une famille bilingue donc pour l’école on a évité de choisir et ils suivent un cursus en anglais. Du coup, ils se moquent de mon accent quand je parle (rires).
Allez-vous rentrer en Europe bientôt ?
La question ne se pose pas en ces termes. Je veux juste continuer. On vient de retrouver un deuxième souffle. Au Vietnam ou aux Philippines, le marché explose. Tous les jours, on a des consommateurs potentiels qui accèdent à la classe moyenne. J’ai envie d’accompagner ces projets. Vous savez, je viens d’Antibes. Grâce à mon travail, j’ai pu vivre une ouverture d’esprit, géographique, politique, humaine… Toutes ces expériences que vous avez en tant qu’expatrié que vous avez du mal à atteindre si vous ne quittez pas la France, où c’est un peu bloqué. Il y a une part de risque mais aussi d’excitation quand on s’expatrie. A l’étranger, on vous donne la possibilité de vous tromper tant que vous ne vous entêtez pas (rire) et travailler sur des pays en croissance, c’est moins compliqué. Vous avez une latitude de mouvement pour trouver des solutions que vous n’auriez pas en Europe où c’est trop stratégique.
Avez-vous un message pour les jeunes étudiants ?
Qu’ils profitent bien de leurs années d’études !! Cela fait 21 ans que je suis diplômé et mes amis les plus proches restent mes copains de promo. Ce sont les soirées qui nous ont liés. On ne s’est pas pris au sérieux, on était curieux et c’est ça qui est important. Une carrière, c’est essentiellement de la chance, et de l’envie. Le travail… Tout le monde bosse aujourd’hui. Si vous êtes passionné, la notion de travail est annexe. Le futur est une succession d’opportunités, il ne faut pas en avoir peur.
Propos recueillis par Marie-Pierre Parlange
Sur le même sujet