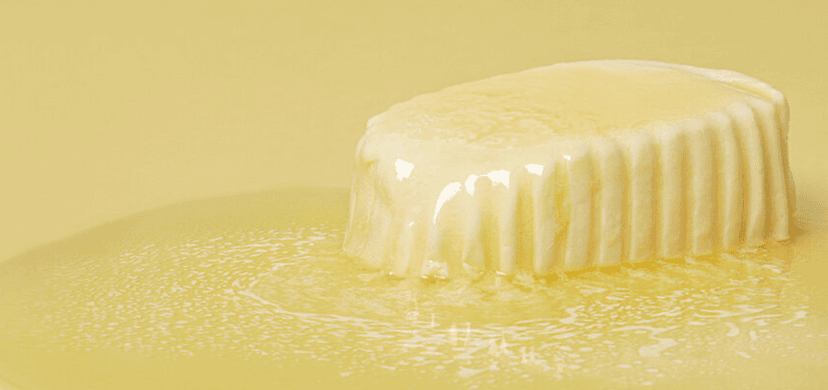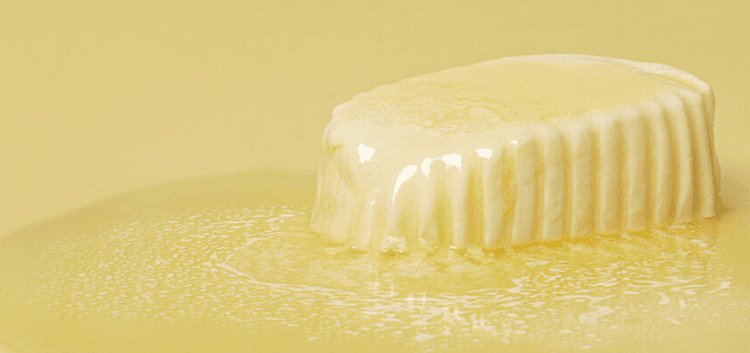Paraboot est une marque de chaussures artisanales fabriquées principalement en Isère et exportées partout dans le monde. Riche de son histoire et de ses valeurs, elle a particulièrement séduit le public japonais. Le directeur marketing et communication de l’entreprise, Pierre Colin, nous présente Paraboot.
Pouvez-vous raconter à nos lecteurs l’histoire de la marque Paraboot ?
La marque a une longue histoire familiale de 114 ans, qui débute au 19ème siècle. Rémy Richard est un cordonnier, fils de paysans, qui vit et travaille en Isère, où nous sommes encore aujourd’hui. L’Isère est un grand bassin de fabrication de chaussures. Grâce à la grande présence d’eau dans la région, il y avait beaucoup de tanneries. En 1908, Rémy Richard se lance à son compte et fabrique des chaussures de cuir. Après avoir été blessé pendant la Première guerre mondiale, il est envoyé réparer les chaussures des soldats. À l’époque, les corps de métiers de l’extérieur (montagnards, cultivateurs, soldats) portaient des chaussures avec des semelles en bois plantées de clous pour assurer l’accroche au sol. Les bottes en caoutchouc de la société Aigle existaient déjà, mais pas de chaussures en cuir avec des semelles en caoutchouc. En 1922, Rémy Richard lance la marque Galibier qui fabriquait des chaussures de montagne pour les clients autour de son atelier en Isère, entre la Chartreuse, le Vercors et les Alpes.

Rémy Richard était un grand voyageur, cela a-t-il influencé sa vision de la marque, de l'artisanat de la chaussure ?
Après la guerre, Rémy Richard voyage aux Etats-Unis et découvre la pratique américaine qui consiste à couvrir les semelles de petites chaussettes (« boots ») en caoutchouc pour les protéger. Rémy Richard a donc l’idée de créer des semelles directement en caoutchouc. Cette matière naturelle venait de l’ancien port de Para au Brésil, d’où le nom de la marque qu’il dépose en 1927 : Paraboot. Ce qui était d’abord le nom de la semelle est devenu ensuite le nom de la chaussure. Son idée est de travailler le « cramponnage », c’est-à-dire des crampons en caoutchouc pour remplacer les semelles cloutées. Cela a donc donné ces chaussures de travail, épaisses, qui font l’ADN de la marque. L’entreprise propose déjà des chaussures de ville avec des semelles en cuir mais les chaussures de travail restent son atout principal à ce moment-là.

Après la Seconde guerre mondiale, le fils de Rémy, Julien, reprend la société Richard Pontvert. Il a plutôt un profil de commerçant et se lance dans les Trente glorieuses avec brio. C’est un chasseur, un bon vivant, il développe l’image de marque et lie des contacts. Les années 50-60 sont aussi le moment des grandes épopées montagnardes, notamment dans l’Himalaya. Des explorateurs comme Pierre Alain; René Desmaison ou Paul-Emile Victor étaient équipés de chaussures Galibier. Cela a bien sûr contribué au succès de l’entreprise dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis où la montagne est importante. Vers la fin des années 70, la société exporte beaucoup vers l’Amérique du Nord.
En parallèle, la marque Paraboot se développe dans le bassin français auprès de gens plus ancrés dans le travail de ville : des médecins, vétérinaires, des personnes (hommes et femmes) qui ont besoin de beaucoup marcher dans leur quotidien, avec des chaussures solides et résistantes. Paraboot ne fait pas de la chaussure de Dandy.

Votre marque a connu une période sombre, comment Paraboot a-t-elle réussi à s’adapter au marché, à la clientèle ?
Effectivement, arrivent les années 1980 et la période difficile de la société. La fin des Trente glorieuses, l’élection de François Mitterrand et plus tard de Ronald Reagan ébranlent beaucoup d’entreprises. En 1983 la compagnie dépose le bilan, malgré les 600 employés à l’époque. Mais en 1985, un phénomène nouveau apparaît, venue d’Italie : le sportswear. Un modèle de Paraboot est alors mis en avant : la Michael, un modèle créé en 1945. Le nom du modèle vient du fils de Julien né en 1945, Michel, à l’époque où il était de bon ton d’américaniser les prénoms. La Michael s’arrache en ville, et plus seulement en campagne. Elle se portait avec une veste en tweed et un pantalon velours côtelé. Paraboot entre alors en ville.
Les années 90-2000 sont des périodes de crise pour les chaussures épaisses, le grand public s’intéresse plutôt aux chaussures fines et clinquantes, à l’italienne. Paraboot se retourne alors vers sa clientèle traditionnelle. Mais ce style des années 80 revient aujourd’hui depuis 6 ou 7 ans. C’est pourquoi Paraboot se trouve de nouveau sur le devant de la scène.

Qu’est-ce que la chaussure cousue ? Quelle est sa spécificité ?
Dans le monde, 90% des chaussures qui sont vendues ont des semelles collées ou soudées. 7 à 8%, comme les mocassins, sont cousues par une seule couture, le montage Blake. Puis, les 2 à 3% restants des chaussures relèvent de la couture Goodyear ou de la couture norvégienne. Ce sont les coutures les plus nobles et les plus compliquées de l’industrie de la chaussure. La plupart des grandes marques de chaussures font du Goodyear, nous sommes presque les seuls à faire du cousu norvégien, il en relève de notre image de marque. L’avantage est de pouvoir découdre la semelle de la chaussure pour la changer, et faire ainsi augmenter la durée de vie de la chaussure. C’est notre côté « sustainable » et RSE. Cela demande 150 manipulations par chaussure : c’est noble, authentique et solide.

Est-ce une réelle fierté aujourd'hui d'avoir des produits fabriqués en France ?
Nous fabriquons effectivement dans nos ateliers en Isère, surtout les chaussures qui nécessitent la technique du cousu norvégien. Les chaussures plus légères de nos collections d’été sont fabriquées en Espagne, au Portugal et en Italie, mais cela ne représente que 20% de notre chiffre d’affaires. L’importance du Made in France est grande pour cette entreprise familiale. Nous avons récemment investi 10 millions d’euros pour créer une nouvelle fabrique ici en Isère. Mais nous avons du mal à recruter des travailleurs, car nous devons en plus les former sur place à la technique du cousu norvégien, il n’existe pas de formations spécifiques et de nombreux secteurs en France peinent à recruter ces derniers temps.

Devez-vous faire face comme d'autres marques haut de gamme qui s’exportent à la contrefaçon ?
Nous faisons moins face à la contrefaçon qu’à la copie. Lorsque j’ai rejoint Paraboot en 1998, on disait que la Michael était le modèle le plus copié au monde. Aujourd’hui encore, beaucoup de marque le reprennent : de petites marques mais des grands noms du luxe aussi. C’est à la fois glorifiant et vexant car dans l’industrie de la chaussure il n’y a pas de dépôt de brevet.
Quelles sont vos stratégies pour exporter votre artisanat à l’international ?
Nous exportons depuis très longtemps. D’abord les marchés nord-américains puis dès les années 1970 avec le Japon. Le marché européen, et en particulier italien est très important pour nous, depuis les années 80. Nous travaillons aussi avec le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique.

Comment expliquez vous votre succès au Japon et en Corée du Sud ?
Nous avons des relations très solides avec le marché japonais, établies depuis des décennies, sur du rapport humain avant tout, de l’amitié avec notre partenaire Japonais. Les Japonais sont intéressés par le Made in Europe, l’authenticité des produits, la qualité des matières premières. Ils sont aussi friands de la belle histoire que nous avons, et que nous racontons. Nous avons, avec notre partenaire fidélisé les clients japonais grâce à un travail de longue haleine qui nous permet aujourd’hui de nous hisser au Japon au côté des plus grandes marques de luxe. Nous avons ouvert la semaine dernière une boutique dans le quartier de Marunouchi à Tokyo, en face de la boutique Hermès. Nous avons une image de marque de luxe au Japon, alors qu’en France nous conservons cette image de tradition, de terroir. Nous travaillons, au Japon et en Corée du Sud notamment, sur des collaborations entre marques, ce qui plait beaucoup à ces publics. Nous le faisions déjà dans les années 1980 avec Yves Saint Laurent ou Yamamoto. Nous avons ouvert notre première boutique à Séoul il y a cinq ans.
Sur le même sujet