

Professeur émérite de hindi et linguistique indienne et générale à l'Inalco (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales), Annie Montaut a été récompensée en 2022 par le Prix de la traduction Inalco-Vo/Vf, pour son travail sur le roman de Geetanjali Shree, « Ret Samadhi. Au-delà de la frontière », paru en France aux Éditions Des Femmes.
L’enseignante-chercheuse et traductrice, au double parcours en lettres modernes et linguistique, nous parle de son travail sur ce livre, de son expérience d’enseignement et de vie en Inde, et de son appréciation des auteurs hindiphones, dont elle a traduit de nombreux ouvrages.
lepetitjournal.com Bombay : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs pour commencer ?
Annie Montaut : Présentement, je suis professeur émérite, c’est-à-dire retraitée mais en conservant mes activités de recherche, mon laboratoire, et éventuellement mes doctorants. Auparavant, j’ai été très longtemps à l’INALCO (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales), anciennement Langues O’, où j’enseignais la linguistique générale et le hindi. J’ai enseigné la langue hindie des premières années jusqu’au doctorat.

Je suis diplômée de l’École Normale Supérieure et agrégée de lettres modernes. J’ai enseigné un peu en collège-lycée, puis j’ai fait un PhD sur le style de Céline, à la Queen’s University, au Canada. J’ai ensuite enseigné à l’Université Jawaharlal Nehru de Delhi, à partir de 1981. Après un doctorat sur le système verbal hindi en 1988, à Paris 3, j’ai été en poste à Paris-Nanterre, anciennement Paris-X, en Sciences du langage, ce qui m’a amenée à être dans plusieurs laboratoires de recherche en linguistique.
Mais mon titre de gloire essentiel, c’est que j’ai le bac 68, ce qui n’est pas donné à tout le monde !
Au-delà de mes responsabilités « banales » d’enseignante, j’ai développé la formation en traduction à l’INALCO, et non seulement en traduction littéraire, mais aussi en traduction technique et interprétariat.
À l’INALCO, nous avons une batterie de langues très intéressante, qui répond à des besoins forts, pour les échanges avec l’Europe de l’Est, et maintenant avec les migrants. Développer la formation traduction est l’une de mes grandes satisfactions.
Qu’est-ce qui vous a amenée à enseigner à Delhi ?
À l’époque, on m’a proposé deux postes, et j’ai choisi l’Inde parce que j’y étais déjà allée en voyage, et je savais que quelque chose m’attendait là. J’y serais restée si j’avais pu. J’ai renouvelé mon contrat autant que possible, mais il y a eu un moment où il a fallu partir. Et bien entendu, c’est là que j’ai appris le hindi.
Quand on est dans un pays, je trouve qu’il faut apprendre la langue. Au début c’était pour communiquer avec plus de gens et pas simplement avec l’élite anglophone, qui était moins nombreuse qu’aujourd’hui, et ensuite ça a été par goût.
Qu’est-ce qui vous plaît dans la langue hindi en particulier ?
Ses écrivains ! Mais pas seulement, bien entendu. Ce qui me plaît, et je le partage certainement avec tous les apprenants étrangers, c’est son exotisme. On dit du hindi que c’est une langue européenne, qu’elle est de la même famille que le français et autres langues européennes, qu’elle est proche. Mais c’est très différent en réalité. Il y a au départ un sentiment d’exotisme assez fort, à cause des sons, et surtout à cause de la syntaxe.
Je ne dis pas que c’est exotique comme le chinois, par exemple, mais je dirais comme le japonais, puisque j’en ai fait un petit peu aussi. On est piqué par cette surprise. Ça a beau être une langue sœur, c’est une sœur étrangère.
Quelles autres langues parlez-vous ?
Je parle espagnol, anglais, allemand, puisque ma fille a épousé un Allemand et vit en Allemagne, et aussi parce que la littérature allemande est très intéressante ! Les autres langues, je les lis, je les ai eu parlées, comme on dit dans mon français du Sud, où le passé surcomposé est encore employé ! Un peu l’italien, pas trop mal le russe, un peu le persan... Mais je ne parle plus, parce que je ne pratique plus. Je suis loin d’être une polyglotte à la Hagège. (Claude Hagège, linguiste français) Ce n’est pas mon but dans la vie.
Comment s’est passé votre vie à Delhi dans les années 1980 ? Quelles ont été vos premières impressions, qu’avez-vous aimé, moins aimé ?
Tout était génial, tout m’a plu ! Évidemment, il y avait des choses désagréables, mais que je ne qualifierais pas de déplaisantes ! Les longues attentes au FRRO (Foreigners Regional Registration Office) pour faire renouveler son visa, les queues pour payer sa facture d’électricité, le fait qu’il n’y avait pas de téléphone, mais que des cabines publiques... Mais c’est à peu près tout, c’est anecdotique. La nourriture était fabuleuse, c’est d’ailleurs la seule chose qui soit restée à peu près au même niveau aujourd’hui ! Les marchés, c’était un bonheur.
Et la musique ! Peut-être le deuxième soir de mon arrivée là-bas, j’ai eu la chance d’écouter des maîtres du dhrupad, l’un des genres de la musique classique indienne. Je n’étais pas encore remise du décalage horaire et j’étais abasourdie, c’était magnifique. Ce fut grâce à Laurence Bastit, qui a été mon mentor, et je tiens à le souligner à sa mémoire, puisqu’elle nous a quittés en 2020. C’était une grande dame de la relation France-Inde, elle habitait à Delhi, et elle pratiquait le dhrupad depuis un an, avec ses maîtres, les Dagar Brothers. Et cette famille, la famille Dragar, qui m’a accompagnée pendant tout mon séjour, je l’ai revue lors de tous mes séjours en Inde, et je les rencontre quand ils viennent en France. Ça a énormément compté dans mon bonheur d’être à Delhi.

Une autre chose qui a compté, qui avait ses côtés crispants, mais surtout ses côtés exaltants, c’était JNU (Jawaharlal Nehru University) à l’époque. Mes étudiants étaient des personnes extraordinaires. Certains ont eu des carrières brillantissimes. Certains ont fait l’ESIT (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs) et se sont installés en Europe comme interprètes de conférence. Ce ne sont pas des études faciles. D’autres ont fait des thèses, avec des gens exigeants, comme Julia Kristeva (philologue, psychanalyste et auteur française). Ils ne se contentaient pas d’étudier le français langue appliquée pour devenir professeur de français et chacun avait une personnalité extraordinaire. Ils m’ont portée et ils avaient une telle indulgence avec moi, fraichement débarquée en Inde, qui estropiait tous les noms et n’avait pas idée du niveau des élèves... C’est une fac qui recrute dans tous les États. Il y avait des Kashmiris, des Tamouls... Après trois ans d’études à JNU, ils arrivaient pour mes cours déjà complètement francophones grâce à Beatriz Magraner, qui était en charge de l’enseignement du français pour les trois premières années de la formation, en collaboration avec un Indien.
À quelles occasions retournez-vous en Inde ?
J’y vais par exemple à l’occasion de la remise du Prix Romain Rolland, créé en 2017 par les attachés et conseillers culturels précédents, et qui récompense la meilleure traduction dans une langue indienne, y compris l’anglais, d’un livre en français, parmi une vingtaine de titres. Je suis dans le jury pour le hindi. Jusqu’à l’année dernière, la remise du prix se faisait lors du festival de littérature de Jaipur. Mais pour moi ce n’est pas vraiment un voyage en Inde, car c’est une citadelle très particulière, le Lit Fest de Jaipur, et je n’en profitais pas toujours pour rester plus longtemps.
Comment êtes-vous devenue traductrice du hindi ? Est-ce venu d’un premier livre, d’une rencontre décisive ?
Comme j’ai toujours aimé la littérature, j’ai voulu faire partager ce que j’admirais dans la littérature hindie. Il y avait très peu de traductions quand j’ai commencé. Le premier roman que j’ai traduit était de Nirmal Verma (Un Bonheur en lambeaux, Actes Sud, 2000). Mais avant ça, j’avais traduit d’autres choses, comme des nouvelles, mais en choisissant, toujours.

Lorsque vous choisissez de traduire un auteur, c’est ensuite vous qui proposez à un éditeur de le publier en France ?
Oui. Personne ne me fait jamais de commande, et c’est pareil avec toutes les langues indiennes qui ne sont pas l’anglais. Il faut forcer les portes. Les éditeurs ne connaissent pas, tout simplement. Ils peuvent lire les livres en anglais, mais pas les livres en malayalam, en bengali... Il faut donc déjà avoir traduit une bonne partie de l’ouvrage pour leur montrer à quoi ça ressemble. Quand il y a une traduction anglaise, ça peut aider à les convaincre, mais ils n’ont pas l’idée de demander d’eux-mêmes à un traducteur français.
Je me bats beaucoup et j’ai sur les bras des choses qui n’ont jamais été publiées. Mais pas tant que ça ! Ça veut dire que ça vaut le coup de tenter et retenter ! J’ai, par exemple, une traduction terminée depuis 10 ans, d’un livre de Mrinal Pande, que j’aime beaucoup et qui enchante toutes les personnes à qui je le fais lire. Mais aucun éditeur n’en veut !
J’ai du théâtre aussi. Personne ne veut de théâtre. Contre toute attente, un petit éditeur, L’Asiathèque, a accepté deux pièces de théâtre, alors qu’ils étaient déjà débordés, avec trop de titres à sortir. Comme souvent avec L’Asiathèque, ce sont des éditions bilingues, c’est très différent. On n’a pas droit aux rentrées littéraires, mais on s’en fiche ! C’est un instrument pédagogique que je trouve extrêmement précieux. J’ai moi-même appris des langues grâce à cet outil essentiel.
Comment en êtes-vous venue à traduire Ret Samadhi, de Geetanjali Shree ? Vous aviez déjà traduit l’un de ses romans par le passé.
Oui, Maï, une femme effacée, chez un autre éditeur. Je l’ai rencontrée grâce à Nirmal Verma, qui m’a présentée à elle, il y a longtemps. Mais à l’époque, quand je travaillais, je ne pouvais pas traduire autant. Je faisais un livre par an, maximum. Certains livres se traduisent vite, mais les plus difficiles prennent beaucoup plus de temps.

Ret Samadhi, c’était infernal ! Mon contrat me donnait un délai de cinq mois, mais j’ai expliqué à l’éditrice que c’était terriblement compliqué, et elle a compris. Donc j’envoyais chaque partie une par une, et pendant qu’une partie partait à la correction et à la mise en page, je traduisais la suivante.”
Alors que j’avais déjà réalisé trois réécritures avant d’envoyer le texte à l’éditeur, ce dernier a posé des questions et cela a donné lieu à une dernière réécriture. Il me semble que la traductrice en anglais a commencé la traduction avant moi et a fini un an après. Et ce sont des délais normaux. L’auteur a mis huit ans à écrire et réécrire ce livre. Cinq mois pour le traduire, c’était un pari un peu fou, mais l’éditrice souhaitait une sortie avant le Salon du Livre. Malheureusement, ce dernier n’a jamais eu lieu, puisque nous étions en 2020, année du Covid-19. Ce fut terrible pour le livre, en tant qu’objet.
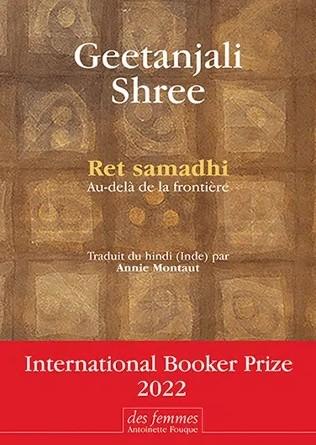
Le roman est paru le 14 mars 2020, et le 17, la vie s’arrêtait, les librairies fermaient… Quand elles ont rouvert, c’était devenu un vieux livre. En France, c’est comme ça, un livre qui vient de sortir, est neuf et fringant, il a droit à des articles de presse et tout ce qu’il faut, mais, quand il a six mois d’existence, il faut qu’il laisse la place aux jeunes et il tombe dans l’oubli.
Quelles étaient les difficultés posées par sa traduction ?
C’est un roman difficile, pour le fond, la conduite de l’histoire... Je connais des gens qui n’ont pas pu aller au bout, et je comprends. Le style aussi est difficile, aussi difficile que celui de Céline, par exemple.
Si vous allez jusqu’à la fin de la première partie, vous irez au bout, je vous le garantis ! Parce qu’après il se passe beaucoup de choses, c’est très mouvementé, tourbillonnant. C’est vrai que dans la première partie, on peut avoir l’impression qu’il ne se passe rien, qu’on ne voit pas où l’auteur veut en venir.
Il était beaucoup plus difficile à traduire que le précédent, Maï, une femme effacée, pour lequel j’ai eu bien plus de temps. Il m’a fallu plusieurs années avant de trouver un éditeur, et ensuite l’éditrice ne m’a pas bousculée, elle m’a donné des délais classiques. Le style de l’auteur a beaucoup évolué depuis Maï.
Les commentateurs en Inde étaient tous d’accord pour dire qu’avec Ret Samadhi, Geetanjali Shree a fait une expérience des limites de l’écriture. Tout le monde l’a remarqué et lui a dit, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, on se demande ce qu’elle va faire !
Quelle sera votre prochaine traduction ?
Je traduis en ce moment Kulbhushan ka Naam Darj Kijiye, d’Alka Saraogi. Je n’ai pas encore trouvé d’éditeur. J’avais déjà traduit un livre d’elle pour la collection Du monde entier de Gallimard (Kali-katha). Elle a donc souhaité qu’on s’adresse d’abord à Gallimard pour ce nouveau livre. Nous attendons leur réponse.
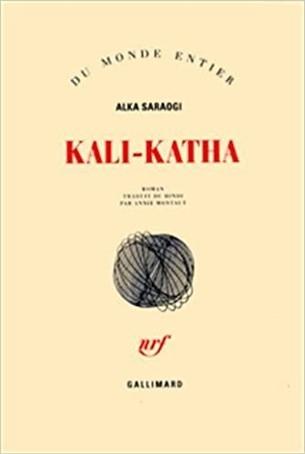
Pendant le confinement, j’ai travaillé sur autre chose, que je ne pense pas une seule seconde pouvoir publier : le dernier long poème de Kunwar Narayan, régulièrement salué comme le plus grand poète de langue hindie de la deuxième partie du XXe siècle. Il a reçu le Jnanpith Award en 2005. Il est décédé en 2017 sans voir son livre publié en français, et je sais qu’il voulait qu’il le soit. Mais il écrit de la poésie, et en plus, son sujet dans ce livre, est un personnage du IVe siècle, qui lui-même a traduit un personnage du VIe siècle avant J.-C., Bouddha, et en plus, c’est un homme. Alors il a tout pour être un perdant sur la plateforme éditoriale en France ! C’est typiquement le genre de texte qu’on ne va pas pouvoir placer.
Lors de votre résidence à l’IEA de Nantes en 2016, sur le thème « Anglais ou hindi ? Grammaires de la culture indienne », vous mentionniez « Les cultures indigènes ne sont aptes à produire des alternatives à la ‘monoculture de l’esprit’, que dans un jeu entre leurs propres traditions et les apports extérieurs, jeu que risque de compromettre l’évolution de la scolarisation ». Quelle est cette évolution de la scolarisation que vous évoquez ?
Je fais référence au fait que dès qu’on est un peu aisé en Inde, on met ses enfants dans une école anglophone, avec une progression exponentielle du nombre d’enfants désormais scolarisés en anglais. Gandhi, après avoir étudié dans une école anglaise, décrit son retour à la famille comme une expérience d’exil, qui lui semblera une perte difficile à réparer. Ce n’est pas qu’il avait oublié sa langue, évidemment, mais il avait changé de cadre cognitif, à tel point qu’il n’était plus dans les préoccupations, dans la culture des gujaratiphones qu’il avait quittés.
C’était la raison pour laquelle Gandhi tenait absolument à ce que l’Inde ait comme langue nationale, ou à vocation nationale, une langue indienne, et pas l’anglais, en étant bien conscient qu’aucune langue indienne n’était panindienne, bien sûr, c’est ça le problème, parmi d’autres.
L’éducation, ça veut dire dans quelle tradition linguistique on a été élevé. Depuis très longtemps, les linguistes estiment que les catégories de pensée, ce sont les catégories de la langue. Il est sûr et certain qu’on a les catégories de pensée de la langue qu’on a dans le coeur. Et donc les alternatives susceptibles de résister à la monoculture en Inde se trouvent évidemment dans des traditions culturelles qui ont des langues qui sont diverses.
Il n’y a pas que les langues qui font la culture, il y a aussi les pratiques, bien sûr. Et justement, énormément de pratiques agraires, en particulier liées au travail de l’eau, n’ont de nom que dans la langue locale.
J’ai beaucoup travaillé sur le sujet des systèmes traditionnels de gestion de l’eau, pas seulement de collecte mais de diffusion, d’usage, grâce à Anupam Mishra, dont j’ai traduit l’ouvrage Les Gouttes d’or du Rajasthan. Anupam Mishra a écrit en hindi, puisque c’est sa langue, mais pour décrire les techniques sophistiquées élaborées au Rajasthan au fil des siècles, il utilise des mots en rajasthani. En Inde, il y a énormément de villages qui ne sont pas alimentés par le réseau d’eau, et c’est donc utile de restaurer les systèmes de collecte traditionnelle. Je pense aussi au système d’agroforesterie en Andhra Pradesh, qui a reçu les encouragements du gouvernement, et à d’autres techniques. Voilà le lien entre l’éducation et l’alternative à la « monoculture de l’esprit ».
Quand on fait une grande école de commerce en anglais, on ne va pas apprendre les techniques traditionnelles locales, ce sont d’autres modes de pensée et d’autres savoirs techniques.
Qu’est-ce qui est fondamentalement différent dans la manière de voir et de décrire le monde, entre une personne parlant hindi et une personne parlant français, par exemple ?
Pour cette question, je vous renvoie au célèbre article d’A. K. Ramanujan, paru dans Contributions to Indian Sociology, et intitulé « Is there an Indian way of thinking? ». L’auteur y évoque un mode cognitif indien, qui l’explique de plusieurs manières, dont ce qu’il appelle la réflexivité.
Pour lui, ça veut dire que rien n’est isolé, et rien n’est linéaire. Par exemple, pour citer une œuvre très connue, le Ramayana (épopée en sanskrit et l’un des textes fondateurs de l’hindouisme). Il n’y a pas un seul Ramayana. Il est reflété par tel autre, et par tel autre, et de répons en répons, cela construit une structure qu’il appelle réflexive. Il parle d’autres choses, mais pour lui cette notion est fondamentale.
En Occident, nous sommes habitués à envisager l’histoire des idées de rupture en rupture. Le mode d’évolution indien ne fonctionne pas par grandes ruptures. En Inde, ce sont des réécritures, des commentaires, des déformations, augmentations, subversions, inflexions... Et je trouve que c’est très vrai. Je considère que ce type d’explication est conforme à ce que je peux observer.
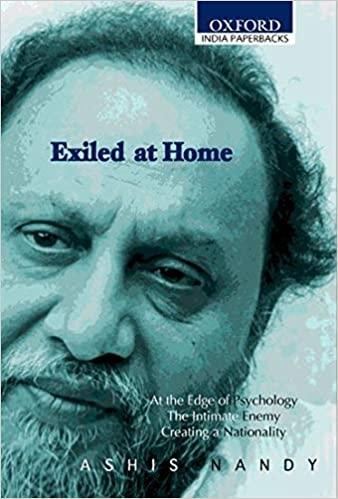
Il faut lire aussi le livre d’Ashis Nandy (psychologue indien spécialisé en politique et sociologie), The Intimate Ennemy. Il y raconte des choses assez semblables. Cela fait partie de la collection de ses trois livres, Exiled at home, un titre qui en dit long.
En 2016, vous participiez aussi à un colloque, « L’Arbre en Asie », avec une intervention intitulée « L’Arbre, les bois sacrés et les luttes pour les conserver en Inde ». Pouvez-vous nous dire ce que sont ces bois sacrés, pour qui ils sont sacrés, et qui tente de les conserver ?
Les bois sacrés, « sacred groves » en anglais, il y en a un bon millier, encore maintenant. Au début, ils étaient sacrés pour tout le monde et personne n’aurait imaginé y pénétrer chaussé ou mettre le bétail sur ces terres. Rien d’autre ne les sacralise que le fait d’être des biens communs, que doivent entretenir les populations locales et dont elles se servent, pour la nourriture, pour les plantes médicinales, pour beaucoup d’autres choses. Ce concept de « communs » vient de l’anglais « commons ».
Ce sont des terrains de taille variable qui n’appartiennent à personne, ils ne sont ni la propriété d’État ni propriété privée, ils appartiennent au village, à tous. Et c’est crucial dans une forme d’agriculture vivrière.
Aujourd’hui, c’est vrai qu’ils sont sacrés pour moins de monde. Autour de Jaisalmer, où il y a un impluvium, c’était pareil. Il n’y a guère que cette source d’eau dans la partie occidentale du Rajasthan, et l’eau était donc sacrée, pas juste dans les poésies et les imaginations. Aujourd’hui, il y a des ordures. Donc pour qui c’est sacré ? Ça change avec les générations, c’est sûr.

Et qui tente de les défendre ? Le mouvement le plus célèbre, que le monde entier connaît, mais sans qu’un rapprochement soit toujours fait avec les micro-luttes qui continuent de faire le tissu de la diversité culturelle en Inde, c’est Chipko.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Chipko ?
Ce mouvement de femmes est né dans le Garhwal, dans l’État de l'Uttarakhand, avant d’essaimer. Dans les montagnes de l’Himalaya, ces bois sacrés étaient la seule source d’un bois à la fois très souple et très résistant, qui fournissait tous les outils agricoles, mais aussi beaucoup d’autres choses, fourrage, chauffage, venus d’autres végétaux.
Commencé en 1973, Chipko était un mouvement de femmes. En général, ce sont les femmes qui n’ont pas un travail salarié, et qui s’occupent de l’agriculture, des ressources vivrières, et notamment du bois. Et quand on vous prive de vos instruments de travail, et donc de votre nourriture, il y a de quoi être en colère.

Lorsque les bûcherons du gouvernement sont arrivés pour abattre des arbres qui étaient dans ce périmètre de communs, les femmes se sont enlacées aux troncs. Généralement, ces colères sont rapidement matées par la force très supérieure qui leur est opposée, comme ça s’est passé pour les Bishnoïs, au XVIIIe siècle. Mais là, au XXe siècle, le mouvement l’a emporté. Ensuite, cela a mis des années avant qu’elles ne gagnent des statuts légaux qui freinent la spoliation des espaces communs. Les communs n’en ont pas moins énormément reculé. Il n’y en a presque plus.
Le même phénomène de disparition est en cours pour l’habitat de ceux qu’on appelait les « tribaux » avant, et qu’on appelle aujourd’hui plutôt les Adivasis (noms donnés aux aborigènes de l’Inde).
Ces luttes continuent-elles aujourd’hui ?
La poétesse Adivasi Jacinta Kerketta, que j’ai traduite également, et avec bonheur, puisque c’est la partie engagée de ce que je fais, dénonce ce scandale, qui est passé inaperçu. Elle raconte la destruction des communs, et la paupérisation de toute une partie de population qui possèdent des langues inutilisables sur le marché du travail national et même régional, et des savoirs techniques et savoir-faire qui n’intéressent pas la société de marché. Les Adivasis rejoignent le lumpenprolétariat des bidonvilles des mégalopoles. C’est l’une des conséquences de la destruction des communs.

Il y a aussi des gens comme Vandana Shiva, à qui j’ai emprunté les mots « monocultures de l’esprit ». Elle combat cette destruction, avec son ONG Navdanya, destinée à la préservation des semences paysannes. Voilà un autre énorme chapitre, et un chapitre qui n’est pas uniquement indien. Les combats que peut mener l’Inde dans ce domaine intéressent le monde entier. Les grands semenciers vous expliqueront qu’ils sont la seule solution pour nourrir une population nombreuse à bas coût, sauf que dans la pratique, ce n’est pas vraiment à bas coût, sinon il n’y aurait pas tant de suicides paysans, et ça n’apporte pas beaucoup à la ration journalière du quidam.
Ces thèmes, vous y étiez sensible, ou vous les avez découverts en vivant en Inde, ou en traduisant les auteurs ?
Je m’y intéressais déjà avant, j’ai été membre d’ATTAC très longtemps, par exemple. Mais puisque j’étais en Inde, je me suis intéressée à ce qui se passait là-bas. Et c’est vrai que je connais mille fois mieux ce qui se passe dans le domaine des technologies traditionnelles hydrauliques en Inde qu’en France. Il faut dire qu’elles sont moins dégradées en Inde qu’en France.
Et les auteurs, oui, bien sûr. C’est grâce à Anupam Mishra que je me suis intéressée à l’eau, mais c’est parce que je m’intéressais à des sujets semblables que j’ai connu pas mal de gens, pas seulement des auteurs, mais aussi des journalistes, comme Ashutosh Bhardwaj.
Sur le même sujet















