Ancien sélectionné au prix Goncourt et lauréat du prix Femina pour son roman Peste et Choléra, Patrick Deville s’est lancé dans une ambitieuse œuvre littéraire, nommée Abracadabra, pour laquelle il entend écrire 12 romans de non-fiction en deux tours du monde. Invité par le Tata Littérature Festival (le Tata Lit Live!), il était de passage à Bombay. C'était la première fois qu’il posait le pied sur le sol indien. Lepetitjournal.com Bombay a eu la chance de le rencontrer pour un entretien exclusif.


Amazonia, son dernier livre, publié à la rentrée littéraire de septembre au Seuil, est le 7ème du projet Abracadabra, dont le nom découle d’une de ses lectures de jeunesse et qui ne devra se composer que d’ouvrages finissant par la lettre A. Oui, ici, la règle est importante et évocatrice, comme l’appétit de l'écrivain pour les coïncidences et les recoupements de dates, tel des clins d’œil de la marche du temps. L’écriture de Patrick Deville est érudite. L’auteur plonge allègrement dans l’histoire des pays où il s’arrête, convoque artistes, explorateurs, anthropologues et amis et fait ainsi résonner la grande Histoire avec les parcours individuels.
Après, entre autres, Peste et Choléra (sur la découverte du bacille de la peste), Kampuchéa (après qu’il a lui-même suivi le procès des Khmers rouges), Taba Taba (où il remonte les archives de sa lignée paternelle et l’histoire de France, de Napoléon aux attentats récents), Amazonia explore le continent sud-américain du Brésil au Pérou, ainsi que la relation père-fils, alors qu’il embarque avec Pierre, son propre fils, pour un voyage fluvial sur un bateau dont il emprunte le nom à Jules Verne, la Jangada.
Ces hommes qui ne suivirent pas le conseil pascalien de demeurer au repos dans une chambre sont morts pour que nous puissions écrire des histoires - Patrick Deville
De l’écologie et des crises actuelles
Vous mettez en exergue d’Amazonia cette phrase de Claude Lévi-Strauss : "Je hais les voyages et les explorateurs", ce qui est tout de même assez surprenant et je dois l’avouer m’a fait rire. Plus tard, vous citez de nouveau l’auteur "Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité". Que pouvez-vous m’en dire ? Pourquoi ?
Cette citation liminaire d’Amazonia est la première phrase de Tristes tropiques. Le fait de la mettre en citation liminaire est effectivement une blague, c’est pour faire rire, donc je suis heureux de voir que cela marche ! La deuxième, en revanche, n’est pas du tout drôle ! Elle est terrible et d’autant plus si l’on se souvient qu’elle a été écrite il y a plus de 50 ans. Il constate déjà les ordures ! Bien sûr, cela peut être une métaphore. Mais, c’est aussi à prendre au sens propre. Et les ordures de notre civilisation ont augmenté en volume de manière incroyable depuis ! Les ordures le long des rivières d’Amazonie, dans ses villes, mais aussi en Inde, en Indonésie, en Afrique, ces montagnes de plastiques et de saloperies … Quand on voyage, nous sommes confrontés à nos propres ordures. C’est le résultat de cette civilisation industrielle. Les pays d’Asie commencent tout juste à renvoyer des conteneurs de saloperies européennes. On peut aussi l’entendre de façon métaphorique : ordure, par rapport aux civilisations indiennes, c’est aussi ce gout de l’accaparement et de l’accumulation des biens inutiles…
Cela fait écho à cette autre phrase que vous mettez dans le livre où Lévi-Strauss s’inquiète du sort de son propre monde.
C’est la lucidité de Lévi-Strauss ! Il écrit sur la disparition très probable et rapide de toutes ces petites civilisations (petites en terme démographique) sur lesquelles il travaille en tant qu’ethnologue… Or, 40 ans après, à la toute fin de sa vie, il découvre que c’est sa propre civilisation qui est en péril.
C’est quelque chose que vous avez ressenti dans vos voyages ?
Oui, et encore plus à Paris qu’au Brésil.
C’est une coïncidence, mais il s’avère que les incendies en Amazonie cet été ont été concomitants avec la sortie de votre livre…
Oui alors ce n’est pas moi… Je n’ai pas foutu le feu. (Rires) Plus sérieusement, il est vrai que sur la jaquette qui a été choisie par les services commerciaux et validée par moi, on voit de la brume. J’aime immensément les brumes. Ce qu’il y a de plus beau, de plus touchant en Amazonie, ce sont les brumes - il y en a d’ailleurs beaucoup dans les deux films de Werner Herzog que je mentionne - mais quand le livre a paru, tout le monde y a vu de la fumée. C’est ce qu’il y avait sur tous les écrans de télévision.
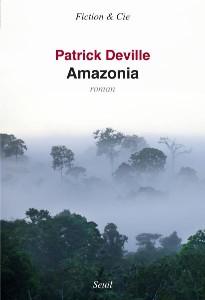
Si ces incendies étaient apparus avant l’écriture de votre livre, est ce que cela aurait changé quelque chose ?
Non, cela brûle toujours et partout ! Il suffit de prendre l’avion… La nuit, la planète est en flamme. Que ce soit l’Indonésie, la forêt équatoriale africaine et toutes les forêts latino-américaines. Et ce pour des raisons très diverses. Au Brésil, ce qu’il y a de particulier c’est que cela a pris une ampleur énorme et surtout c’est lié à l’élection de Jair Bolsonaro. Mais ce n’est pas une surprise ! C’est un homme qui ne ment pas. Il a été élu démocratiquement et pour l’instant il ne fait qu’appliquer les monstrueuses promesses électorales qui furent les siennes, parmi lesquelles l’ouverture de la forêt à l’industrie agroalimentaire, la réduction des terres indiennes…
Or, votre livre n’est pas politique dans le sens où il ne pointe pas du doigt. Il est littéraire.
Oui, mais il dit les choses. En même temps, cette catastrophe écologique est en fait encore plus impressionnante aux Galapagos (Ndlr : où se finit le livre Amazonia). Au Brésil, on peut se dire qu’il y a des causes politiques et donc on pourrait se réconforter en pensant qu’il y a une solution. Alors qu’aux Galapagos, un archipel perdu au milieu du Pacifique, qui est tout entier et depuis longtemps une réserve naturelle, on voit les effets de la catastrophe écologique planétaire ! Celle qui a des répercussions dans un endroit absolument protégé, sans agriculture, sans feux de forêt : là ce sont des causes qui excèdent la politique. Ces effets sont liés au bouleversement des courants marins, le courant chaud El niño et le courant froid Humboldt. De la même façon la possible déviation du Gulf stream, cette fois ci dans l’Atlantique, aurait des conséquences terribles et complexes. On est là face à une véritable responsabilité planétaire.

De la Littérature
Dans le contexte d’Abracadabra, vous dites écrire des romans de non-fiction et jouer avec les géographies et histoires littéraires. Pouvez-vous nous en dire plus ? Où réside l’invention dans vos livres ?
Il y a là deux choses différentes. La première est l’envie de jouer avec tous les genres littéraires : le récit, le reportage, la biographie, l’autobiographie... Ensuite, cette tentative, je l’applique à des zones géographiques différentes.
Je ne me permets absolument pas de placer des propos imaginaires dans la bouche de mes personnages ou d’inventer des faits. L’invention réside dans la construction, le choix des histoires que j’écris ou non, les manières de les assembler, les recherches de coïncidences, d’éphémérides, de lieux.
Je fais commencer tout cela en 1860, la date à laquelle, pour la première fois, il n’y a plus aucune civilisation isolée sur la terre. Sauf celles, petites, cachées dans la forêt. C’est la première fois où sur l’ensemble de la planète tous les événements, où qu’ils se passent, sont connus et ont des conséquences ailleurs. C’est le récit de cette mondialisation que j’écris.
Je reprends aussi mes personnages qui circulent à travers mes livres.
Alexandre Yerzin (Ndlr : un pasteurien qui a découvert le bacille de la Peste), dont je raconte la vie dans Peste et Choléra, parmi ses multiples activités, est celui qui le premier acclimate l’hevea brasiliasis en Indochine française et donc il réapparaît dans Amazonia, car il est l’un de ceux, avec les Anglais à Singapour et Ceylan et les Néerlandais en Indonésie, qui participent à ruiner le Brésil avec la culture du caoutchouc de plantation.
De même, Auguste Pavie (Ndlr : explorateur et diplomate) dont j’ai raconté la vie dans Kampuchéa, et que Yerzin a lui-même connu brièvement, est devenu l’ami de Savorgnan de Brazza, le personnage principal d’Equatoria, et apparait aussi dans Amazonia.
Donc vous créez cet espace littéraire où ces personnages historiques peuvent circuler et habiter, et vous nous dites quelque chose du monde actuel ?
Oui, il y a aussi cette préoccupation du présent ! L’intérêt est de remettre tout ça en vitesse rapide et de mettre le présent en perspective, avec cette intuition que ce que nous vivons vient de 1860. Dans Kampuchéa, je montre cette ligne droite monstrueuse entre Henri Mouhot et les Khmers rouges : au moment où Henri Mouhot découvre les temples d’Angkor, la France abandonne le Mexique suite à l'exécution de Maximilien Ier et se tourne alors vers l’Asie. Avec la colonisation, viennent l’apprentissage de la langue française, la découverte du marxisme… et finalement on se retrouve avec ces jeunes Khmers rouges dont on découvrira, quand on les aura désanonymisé, que frère n1 et frère n2 étaient en fait des étudiants parisiens !
L’histoire renvoie son boomerang.
Absolument.
Avec Abracadabra, vous racontez comment le monde avance ?
Ce qui est fascinant pour la littérature, c’est que l’action individualiste n’est pas vaine ! On peut être un héros ou un salaud… mais en même temps, qu’on le veuille ou non, on est pris dans des mouvements historiques, lents, terribles, qui avancent et contre lesquels on ne peut rien. Pierre Savorgnan de Brazza [Ndlr: explorateur naturalisé français dont Patrick Deville retrace l’histoire au Congo dans Equatoria] est un type extraordinaire, et en même temps, contre son gré, ses missions d’exploration vont mener à la colonisation.
Nous avions sorti notre réserve d’alcool et répétions les phrases de Beckett : "Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager que je sache, dit Camier. Nous sommes cons mais pas à ce point-là." - Patrick Deville

De l’Intime : La relation Père Fils
Parallèlement, dans Amazonia vous parlez aussi de votre propre histoire, de votre relation avec votre fils.
Si nous lisons de la littérature, c’est parce que nous avons ce sentiment d’être vivant. De n’avoir choisi ni le siècle ni le lieu, d’avoir été balancé là-dedans et de devoir mener sa vie… Et donc, il me semble aussi important d’avoir le courage de dire sa propre intimité, ses propres craintes, ses grandes interrogations sur la filiation, la paternité, l’amour.
Dans votre livre, au détour d’une conversation, un thérapeute vous annonce que selon lui, un bon père serait un père qui aurait 12/20 !
Oui, et je n’ai rien inventé ! C’est venu dans la conversation lors d’un dîner à Tanger, et depuis on en parle pas mal. Alors je ne sais pas si cela joue pour les mères. Je ne connais rien aux mères. J’ai eu un rapport déséquilibré avec mon père. Je pense en tout cas, que c’est difficile de tenir un 12…
Ce qui est beau c’est que vous regardez votre fils, que vous dites mystérieux, mais vous n’essayez pas de lever ce voile, vous faites exister la relation. En tout cas, vous en avez fait un personnage de roman.
Oui, l’avantage c’est que c’est un grand lecteur. Donc, même s’il n’y a pas du tout de fiction, il sait que c’est de la littérature. Il l’avait accepté avant. Je m’étais engagé à lui donner le manuscrit en même temps qu’à l’éditeur et à tenir compte de toutes ses remarques. Mais il n’en a fait aucune. Je sais qu’il y a des choses qu’il n’aime pas, mais comme il est un lecteur, il l’a laissé tel quel.
Que peut-on demander de plus à un fils que d’être un jour pardonné, ne serait-ce que de lui avoir infligé l’existence sans le consulter. - Patrick Deville
Vous évoquez beaucoup d’autres relations père-fils, toutes très différentes les unes des autres. Lesquelles vous ont le plus marqué ?
J’ai beaucoup de tendresse pour ce vieux Maufrais, qui cherche son fils perdu dans la jungle pendant 12 ans et devient fou. C’est lui le héros. Le fils, lui, c’est une tête brûlée. Bon, il se trouve qu’il était dans les maquis du Lot avec mon père, donc ça accroche … mais il n’a que ce qu’il mérite ! Mais son père lui est un vieux comptable de l’arsenal de Toulon absolument pas préparé à ça. Un vieux clopeur de plus, ce qui me le rend encore plus sympathique. Sa recherche est à la fois terrible et magnifique.
Du bonheur
A la fin de votre livre, vous évoquez une épiphanie, un instant où vous êtes submergé par le bonheur d’être en vie. Ce moment arrive à la fin du voyage, de l’évocation des génies ou des salauds que vous avez rameutés, des moments partagés avec votre fils. Qu’est ce qui vaut à la vie la peine d’être vécue ? Est-ce que c’est la collusion des trois ?
C’est bien la question. Ces moments de bonheur absolu sont assez rares, il n’arrive parfois pas même une fois dans l’année. Si nous n’étions pas terriblement malheureux, il n’y aurait pas ces moments immenses. En fait, on ne choisit pas trop. Est-il préférable d’avoir une espèce de ratio assez constant de satisfaction ? En tout cas, il ne peut pas y avoir ce type de moment s’il n’y a pas ces gouffres terribles. C’est universel.
Ce moment vient à la fin du livre, du voyage...Il y avait eu beaucoup de craintes d’aller ensemble de l’Atlantique au Pacifique. Il y a aussi ce paysage très étonnant, ce désert marin au sud des Galapagos. Tout cela combiné concourt à une exaltation.
Et est ce que c’est aussi le fait de l’écrire ?
Oui, bien sûr. C’est une déformation… Peut-être qu’un photographe dirait autre chose, mais moi je ne vois vraiment qu’une fois que j’écris. Le fait de tenir des carnets quotidiennement, ce n’est pas la réalité transformée par le langage, au contraire c’est le langage qui permet d’atteindre à la vraie réalité. Ce sont les mots qui saisissent. Tant qu’on n’a pas mis ça en mots, cela n’existe pas vraiment.
De l’Inde
Pour conclure, qu’est-ce que l’Inde pour vous ?
J’ai un projet indien, mais je ne veux pas que mes livres progressent en zigzag. Aujourd’hui, j’en ai écrit six qui font un tour du monde de l’Ouest vers l’Est avec au milieu le français Taba Taba qui est un demi-tour et le premier d’un tour du monde dans l’autre sens… Là, le dernier est en Amérique latine et je continue vers l’Ouest.

Par le passé, j’avais sauté par-dessus le projet indien pour des raisons de calendriers. Le procès des Khmers rouges s’ouvrait à Phnom Penh. Donc ce projet se fera dans l’autre sens et plus tard. Je veux que le temps passe.
De manière un peu curieuse c’est pour moi la dernière frontière, un des derniers endroits du monde où je n’ai pas mis les pieds. Ma première tentative, au début des années 90, a échoué à cause des bris d’un mat, alors que je pensais venir à la voile depuis la Péninsule arabique.
Hier soir, je suis donc arrivé en Inde pour la première fois. Je vais rentrer avec quelques images de Bombay et emmagasiner ça.
Sans la connaître directement, que vous évoque l’Inde ?
Une des images de l’Inde que j’ai est le très vieil Auguste Pavie, qui y est venu pour mieux comprendre les Khmers et les Lao, parce que cette civilisation vient d’ici. Une partie de l’Asie du Sud est indianisée, et l’autre est sinisée. L’influence indienne va jusqu’à Angkor, aux Khmers et au Laos. Le Mékong avait vocation à être la frontière naturelle entre ces deux mondes, mais dans Kampuchéa, j’explique que deux petites nations très éloignées, la France et l’Angleterre, ont perturbé la donne.
Et donc Pavie, le vieil explorateur du Laos, du Sud Vietnam, du Cambodge, qui a posé cette ligne télégraphique de Phnom Penh à Bangkok, n’avait jamais mis les pieds en Inde et y vient pour mieux comprendre ce qui a été la passion de sa vie. Il le raconte dans son dernier manuscrit : Note sur les éléphants (la façon dont son manuscrit commence).
Lepetitjournal.com Bombay remercie l’Institut Français en Inde et l’Alliance Française de Bombay qui ont organisé la rencontre avec Patrick Deville, et l’auteur lui-même pour le temps accordé.
Sur le même sujet















