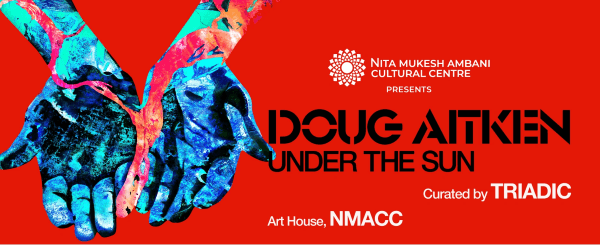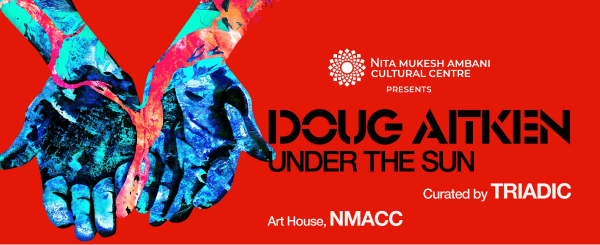Après un premier article sur les morts accidentelles (noyades, électrocutions...) qui emportent chaque année des milliers d'Indiens, Liliam se penche cette semaine sur les décès liés à la magie noire, aux sacrifices humains et au « dagna ». Car les croyances superstitieuses et la sorcellerie peuvent osciller entre le bizarre et le tragique. Voici quelques histoires venues d’Inde.


En juillet 2024, un groupe d’habitants d’un village du district de Samastipur, dans l’État du Bihar, était convaincu que le transformateur électrique, qui s’était déclenché et avait pris feu à plusieurs reprises en un mois, privant le village d’électricité à de nombreuses reprises, était en réalité hanté. Ils ont alors décidé de recourir à la sorcellerie comme remède.
Dans les vidéos qui circulent, le rituel dure près de trente minutes. Il est dirigé par un exorciste local qui, avec l’aide des villageois et au son des tambours, des prières et de quelques danses énergiques, tente d’exorciser le transformateur. À la fin de la cérémonie, il constate néanmoins que « le transformateur n’était pas hanté par des esprits maléfiques, mais plutôt par le fantôme de la corruption ».
Autre anecdote en juin 2024, à Chennai, un sous-inspecteur de police particulièrement diligent, affecté à la régulation du trafic, a dressé une liste des points noirs des accidents de la route, mortels et non mortels, sur l’autoroute reliant Chennai à Bangalore, sous sa supervision.
Ne parvenant pas à enrayer le flot incessant d’accidents, il a décidé de « conjurer le mal ». Mais comment ? Le policier a fait appel à une personne transgenre, à qui il a demandé de prier pour que la zone soit épargnée par les accidents. Pour conclure la cérémonie, une citrouille a été écrasée sur la route. La police elle-même avait pourtant mis en garde contre cette pratique, la chair de la citrouille sur le goudron étant susceptible de provoquer des accidents. Quelques semaines plus tard, l’officier a été démis de ses fonctions et transféré à la salle de contrôle.

Si toutes les histoires de superstition étaient comme celles-ci, elles resteraient des anecdotes pretant à sourire. Mais derrière ces croyances se cache une réalité bien plus tragique.
La magie noire comme motif de meurtre
Le 20 septembre 2024, Murugan, un habitant de Chennai, a été retrouvé mort près de chez lui. La police, qui pensait à un accident, a envoyé son corps à l’un des hôpitaux généraux de la ville pour une autopsie. Mais avant même l’arrivée du rapport, prévenue du décès, sa veuve a refusé d’accepter le corps, convaincue qu’il ne s’agissait pas d’un accident. Dès lors, ce cas tragique a pris une tournure inattendue.
Murugan n’était effectivement pas mort dans un accident, comme le pressentait sa femme. Il avait été assassiné. La raison du meurtre surprendra sans doute un esprit occidental, mais pas les autorités indiennes : le meurtrier était convaincu que son voisin, avec qui il entretenait une inimitié liée à une transaction foncière, avait jeté un sort à son jeune fils, récemment décédé. Bien que la mort de l’enfant soit due à des causes naturelles, le père en était persuadé : son voisin avait utilisé la « magie noire » pour ruiner sa santé et son bonheur. Il a alors prémédité son meurtre.
Cette même semaine, j'ai entendu dans le documentaire To Kill a Tiger, retraçant la quête de justice d’une famille du Jharkhand pour leur fille mineure, victime d’un viol en réunion, la mère évoquer avec pragmatisme le meurtre récent d’une femme dans leur village. Elle avait été assassinée par ses voisins, convaincus qu’elle pratiquait la « magie noire ».

Ces événements ont marqué le début de ma réflexion sur l’influence de la magie noire dans la société indienne.
En réalité, il n’est pas rare que des accusations de magie noire servent de prétexte à des meurtres ou à d’autres agressions contre des personnes, voire des animaux. Le phénomène est si répandu que sept États du pays ont adopté des lois visant à protéger la population contre les croyances pernicieuses liées à la superstition, à la magie noire, à la chasse aux sorcières et à d’autres pratiques connexes.
Beaucoup de gens croient-ils à la magie noire et à la sorcellerie ?
Malheureusement, la croyance en la sorcellerie et la magie noire ne se limite pas à l’Inde. Elle est répandue dans le monde entier. Un sondage Gallup réalisé aux États-Unis en 1996 révélait que 25 % des Américains adhéraient à des croyances superstitieuses. Et vous souvenez-vous du chiffre 13, considéré comme portant malchance et souvent absent des numéros d’étage dans de nombreux hôtels à travers le monde ?
Mais concentrons-nous sur les particularités indiennes et les conséquences tragiques que la croyance en la sorcellerie et à la magie noire peut avoir sur la société.
Le National Crime Records Bureau of India (NCRB), dans son rapport sur la criminalité publié en 2021, fournit des données détaillées. Cette année-là, six décès ont été liés à des sacrifices humains, et 68 meurtres ont été signalés comme ayant pour motif la sorcellerie. Et ce, en une seule année. L'année précédante, en 2020, ces chiffres étaient encore plus élevés : 11 décès liés aux sacrifices humains et 88 meurtres attribués à la sorcellerie.
L’État du Chhattisgarh, situé au centre du pays et peuplé d’environ 30 millions d’habitants, détient le triste record du plus grand nombre de décès liés à la sorcellerie. Mais le Telangana, l’un des États les plus riches du pays, dont la capitale est Hyderabad, arrive en troisième position parmi les régions les plus touchées par ces crimes.

Qu'est-ce que la magie noire et qu'est-ce que la superstition ?
Il n’est pas facile de définir précisément ces concepts, car ils restent ouverts à l’interprétation. À quel moment une croyance profonde devient-elle une superstition ?
Quoi qu’il en soit, la Constitution indienne est très claire : l’article 25 garantit le droit universel à la liberté religieuse, tandis que l’article 15 interdit toute discrimination fondée sur la religion. Ce principe du droit à la liberté religieuse a été réaffirmé par la Cour suprême dans son arrêt Bijoe Emmanuel contre l’État du Kerala en 1987.
Le mot superstition trouve son origine dans le latin superstitio, déjà utilisé par les Romains pour désigner des croyances extérieures à leurs pratiques religieuses officielles. Aujourd’hui encore, il renvoie à des croyances anciennes, dont l’origine se perd dans le temps. La superstition peut aussi être perçue comme un ensemble de croyances irrationnelles, en contradiction avec la connaissance scientifique du monde, mêlant vénération du surnaturel et crainte extrême de Dieu.
La magie noire, quant à elle, également appelée sorcellerie, repose sur la conviction que des forces surnaturelles peuvent nuire à une personne physiquement, financièrement ou socialement par l’utilisation de sorts.
Dans les deux cas, on ne trouve aucune preuve scientifique. Pourtant, en Inde, ce sujet demeure extrêmement controversé.
Les lois spécifiques
La loi sur les drogues et les remèdes magiques de 1954 a été l'une des premières mesures visant à lutter contre l’impact débilitant des pratiques superstitieuses répandues en Inde. Et le Bihar a été le premier État à adopter une loi interdisant la sorcellerie et empêchant l’identification d’une femme comme sorcière.
Mais en réalité, ces croyances sont si profondément ancrées que de nombreux experts plaident depuis des années auprès du gouvernement central pour l’adoption d’une loi nationale couvrant l’ensemble du pays, à l’image des législations déjà en vigueur dans plusieurs États. Actuellement, ces lois locales sont adaptées aux réalités et pratiques propres à chaque région, mais la nécessité d’un cadre national se fait toujours sentir.
À ce jour, seuls huit États disposent de lois spécifiques contre la chasse aux sorcières. Leur adoption a été le fruit d’une lutte aussi bien au niveau local qu’au niveau national.
Prenons le cas de la Loi de 2013 sur la prévention et l’éradication des sacrifices humains et autres pratiques inhumaines, maléfiques et aghori ainsi que de la magie noire au Maharashtra. Il a fallu attendre l’assassinat du militant anti-superstition Narendra Dabholkar pour qu’elle soit enfin adoptée.
Le docteur Dabholkar était reconnu pour son engagement contre la superstition et le système des castes. Son meurtre est aussi commémoré à l’occasion de la Journée nationale du tempérament scientifique, célébrée chaque année le 20 août. Cette journée vise à « développer et promouvoir le tempérament scientifique, l’humanisme ainsi que l’esprit d’enquête et de réforme », conformément à l’article 51A(h) de la Constitution.

D’autres États ont adopté des lois similaires, notamment la Loi de 2017 sur la prévention et l’éradication des pratiques inhumaines maléfiques et de la magie noire du Karnataka.
Plus récemment, le Gujarat a rejoint cette liste en adoptant le Projet de loi de 2024 sur la prévention et l’éradication des sacrifices humains et autres pratiques inhumaines, maléfiques et aghori ainsi que de la magie noire. Lors de l’approbation de la loi, le ministre de l’Intérieur a clairement affirmé la volonté du gouvernement de « protéger les citoyens contre les escrocs et imposteurs qui prétendent posséder des pouvoirs surnaturels, promettent d’exorciser le mal et les fantômes, ou prétendent guérir des maladies en escroquant leurs victimes de leur argent et de leurs terres, et qui conduisent dans de nombreux cas à la mort d’enfants qui sont soit offerts en sacrifice humain, soit privés de soins médicaux ».
Cela ne signifie pas que l’Inde ne dispose pas de lois pour lutter contre les crimes odieux. Le sacrifice humain est une forme de meurtre, autrefois sanctionnée par l’article 300 de l’ancien Code pénal indien et désormais punie par le nouveau BNS. Il va sans dire que des lois existent également pour réprimer les enlèvements, les lésions, les blessures et toutes les autres infractions pouvant découler de ces pratiques. Ces lois sont en vigueur et appliquées.
Ce qui fait défaut, c’est une législation nationale spécifique pour encadrer et réprimer l’ensemble des pratiques liées aux croyances non scientifiques et dangereuses enracinées dans la magie noire et la superstition. Comme tant d’autres pratiques injustifiées et injustes, celles-ci touchent principalement les femmes issues des milieux les plus défavorisés.
Le marquage des enfants avec des bracelets chauffés à blanc : la pratique du daagna
Au début de l'année 2025, en l’espace d’un mois, quatre bébés sont morts dans des districts de l’est du Madhya Pradesh après avoir été brûlés alors qu’ils étaient tombés malades.
Le Madhya Pradesh n’est pourtant pas un petit État. C’est le deuxième plus vaste de l’Inde et il compte une population supérieure à celle de la France. Il abrite des merveilles comme les temples de Khajuraho, classés parmi les premiers sites du patrimoine mondial en Inde, ainsi que des villes majeures comme Bhopal, Indore et Gwalior.

Une pratique dangereuse qui perdure
Dans un article détaillé publié dans The Hindu, le journaliste Mehul Malpani décrit comment, dans ce même Etat du Madhya Pradesh, une pratique aussi terrifiante que non scientifique persiste : des bracelets cassés chauffés à blanc ou des faucilles en fer sont utilisés pour infliger de petites brûlures sur le front, la poitrine ou l’abdomen des enfants. Cette méthode est censée guérir un large éventail de maladies.
Le fait de brûler les enfants renforcerait leur système immunitaire lorsqu’ils tombent malades. Certains bébés sont marqués au fer rouge selon ce rituel, parfois même une fois part mois après leur naissance. Ce traitement peut aussi être appliqué aux mères souffrant de problèmes d’allaitement.
L’un des nourrissons décédés avait été marqué au fer rouge en permanence. Il avait été brûlé à l'abdomen avec des bâtons incandescents, en espérant que ce "remède" guérirait sa pneumonie. Lorsque ses parents l'ont finalement amené à l’hôpital, il était déjà trop tard.
En 2018, cette pratique avait été presque éradiquée grâce aux campagnes continues des autorités. Mais dès que le programme de lutte contre le daagna a cessé, elle a ressurgi avec ses terribles conséquences. L’espoir repose désormais sur un redéploiement des efforts gouvernementaux pour sensibiliser la population.

Une superstition qui nuit à l’éducation
Moins tragique, mais tout aussi pernicieuse, la superstition peut également perturber le quotidien scolaire. À Hyderabad, dans une école primaire publique, un élève a changé d’établissement, persuadé qu’un fantôme hantait l’une des salles de classe.
La rumeur était si ancrée parmi les élèves qu’un professeur a eu l’idée audacieuse de dormir dans la salle pour prouver qu’aucun esprit ne s’y trouvait. Il n’a pas seulement passé une nuit dans l’école, il a aussi dû le faire à une date « propice » : Amavasya, le jour où l’on offre des prières et de la nourriture aux ancêtres, a été choisi pour cette soirée pyjama.
Cela pourrait prêter à sourire si la superstition ne faisait pas obstacle à l’éducation des jeunes générations, qui ont pourtant un besoin crucial de la science pour contrer l’influence envahissante de croyances dangereuses.
Sur le même sujet