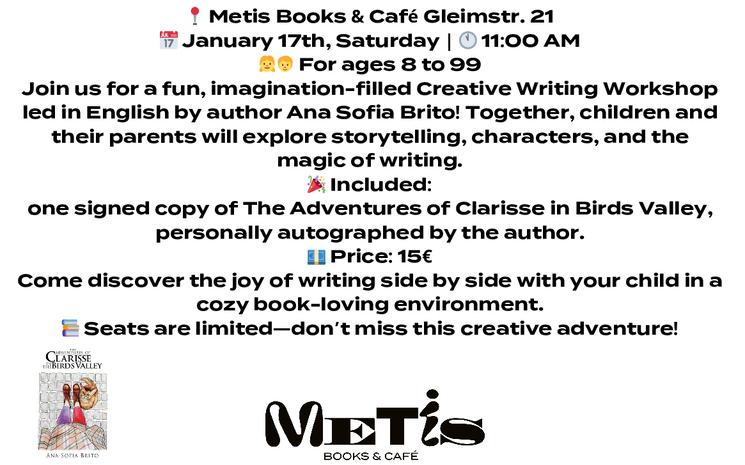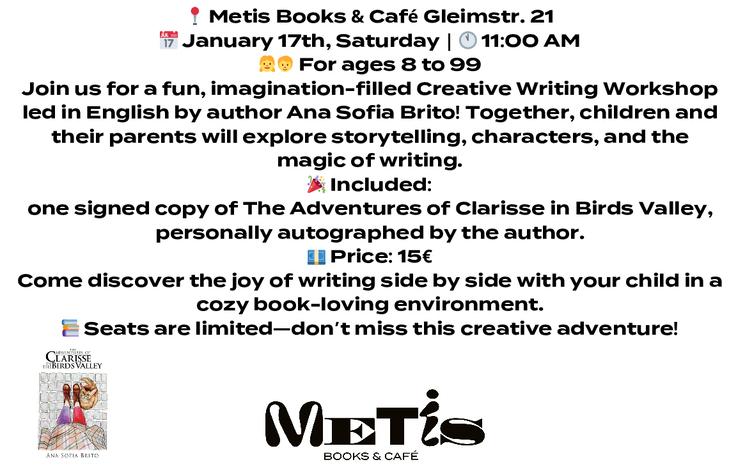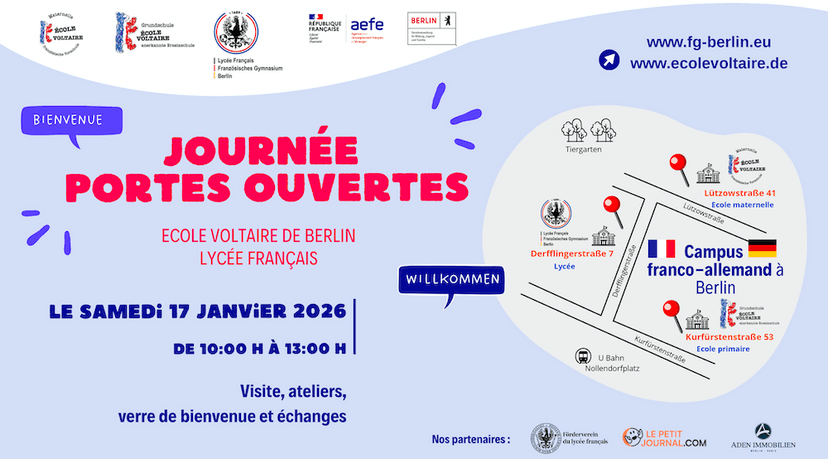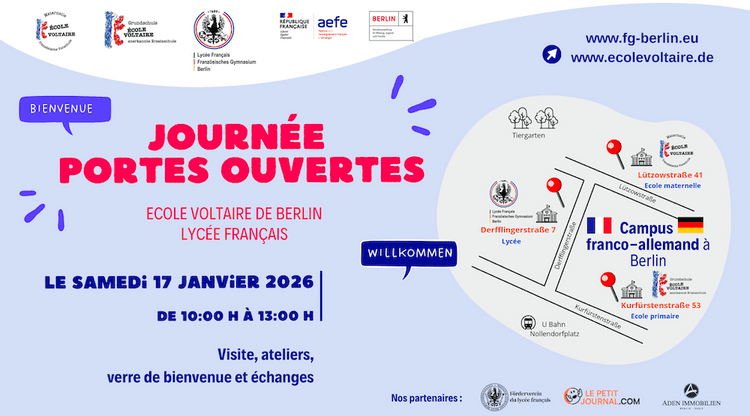Le Petit Journal de Berlin poursuit sa série sur les stations de métro de Berlin avec la désormais très fréquentée Schlesisches Tor. Située à la frontière entre l'Ouest et l'Est de la ville, cette tour a eu plusieurs vies dont voici leurs histoires.
En plus d'être une des stations du métro berlinois des plus difficiles à prononcer pour nombre d'étrangers (le mieux étant de découper le mot Schle-Si-Sches-Tor), elle fût aussi une des premières du réseau métropolitain de la capitale allemande.
Inaugurée en 1902, la Schlesisches Tor fait partie du premier tronçon de métro mis en service à Berlin. Un réseau qui s'étoffera au fur et à mesure du 20e siècle atteignant actuellement pas moins de 173 stations.
Mais avant de devenir une gare, la Schlesisches Tor avait une toute autre fonction comme son nom l'indique.
La place de Schlesisches Tor en 1880
Une station appartenant à l'ancien mur de douane et d'octroi de Berlin
La Schlesisches Tor (connue aussi sous le nom de Wendisches Tor) signifie littéralement la porte de Silésie. Ce nom lui a été octroyé en raison de sa fonction de porte ouvrant ou fermant les frontières du mur de protection fiscale d'une zone géographique formant une partie de l'actuel Berlin et au sein duquel était intégrée la forteresse de Berlin.
La porte silésienne, avec les dix-huit autres, formaient ainsi les entrées et sorties de la zone douanière construite sous le règne de Friedrich-Wilhelm 1er et dont les noms furent choisis en fonction de l'orientation géographique.
La Schlesisches Tor s'ouvrant vers la région de Silésie (Schlesien), située principalement au sud-ouest de la Pologne mais également sur une partie de l'Allemagne et de la République Tchèque, cela apparaît donc logique que la porte fût nommée ainsi.
Vers 1860, le mur de douane et d'octroi de Berlin (Berliner Zoo und Akzismauer) est détruit alors que la dernière porte a été érigée en 1848, il s'agit de la Wassertor (porte d'eau). De l'ensemble des portes, seule la Brandenburger Tor a maintenu sa forme d'époque, les autres ayant été partiellement ou complètement détruite.
Sur cette place située au croisement de la Skalitzer Strasse, Schlesische Strasse, Köpenicker Strasse et de l'Oberbaumstrasse, il sera ensuite décidé d'y construire une des plus anciennes stations de métro qui perpétuera le nom autrefois donné à la porte servant de frontière douanière, une fonction que la tour occupera à nouveau près d'un siècle après.

Carte postale de 1905
Une station de métro au c?ur de l'Histoire de Berlin
A la fin du 19e siècle, la dense circulation de Berlin oblige à réfléchir à une solution permettant de la fluidifier. Plusieurs projets de « petits-trains » sont alors proposés dont celui de la compagnie AEG, souhaitant réaliser un moyen de transport sous-terrain et celui de l'entreprise Siemens avec une ligne aérienne. Déjà pensée en 1880, ce n'est qu'au début du 20e siècle que l'idée d'un métro perché, sur le modèle de celui New-yorkais, fera son chemin.
La première station de la première ligne du réseau métropolitain berlinois, la Ubahnlinie 1, sera nommée Schlesisches Tor. Inaugurée le 15 février 1902, elle relie alors la station Warschauerstrasse à la Potsdamer Platz puis se modifie au fur et à mesure du siècle pour atteindre aujourd'hui 13 stations, soit la plus petite ligne de Berlin, de Waschauer Strasse à Uhlandstrasse, joignant ainsi l'est à l'ouest de Berlin.
Lors de l'établissement du mur de Berlin, en 1961, comme toutes les lignes étalées de part et d'autres de la frontière, la U1 sera également coupée à son extrémité est et Schlesisches Tor deviendra la dernière station de la ligne. Ce n'est qu'en 1995 que la circulation métropolitaine redémarrera sur le pont Oberbaum conduisant ainsi à nouveau les passagers jusqu'à la gare Waschauer Strasse.

Aujourd'hui l'arrêt Schlesisches Tor est une des stations les plus vivantes de jour mais surtout de nuit en raison de la transformation du quartier qui a vu fleurir bars, restaurants ou encore boîtes de nuit ces dernières années. Le club Bi Nuu a même installé ses quartiers au sous-sol de la tour !
Anaïs Gontier (www.lepetitjournal.com/Berlin) vendredi 12 février 2016