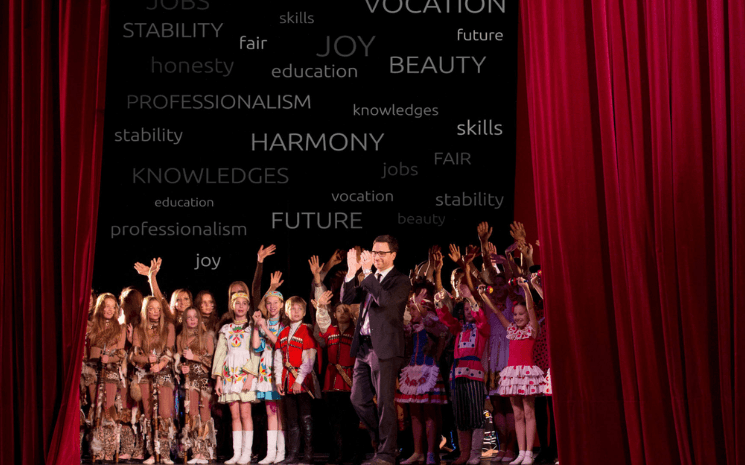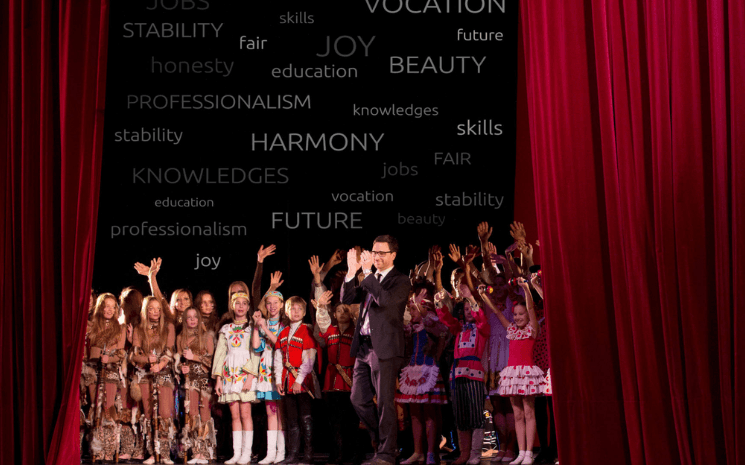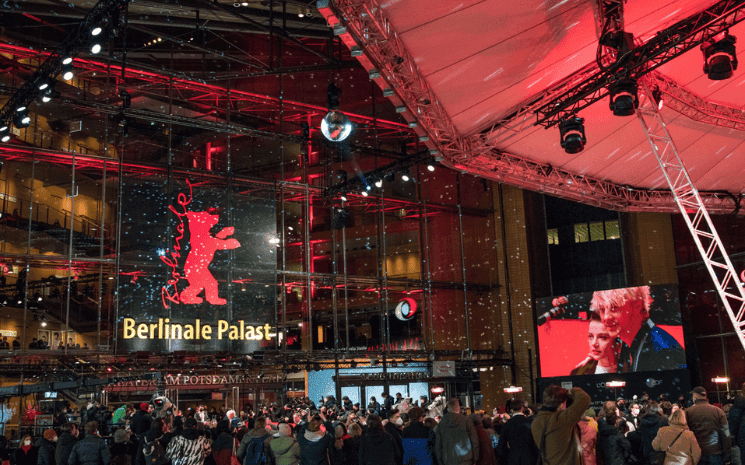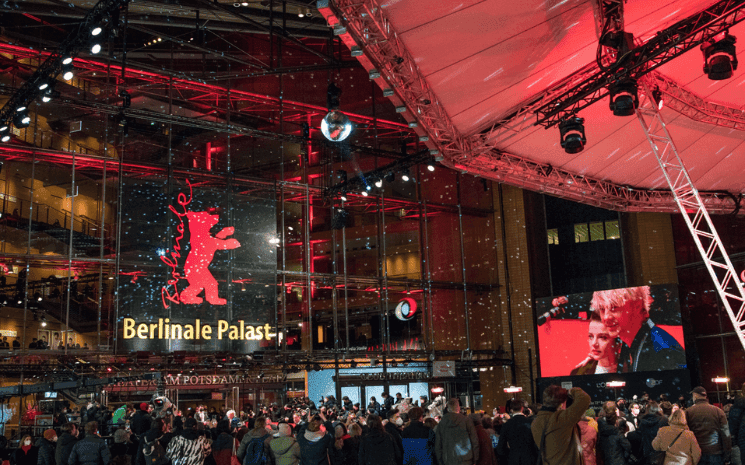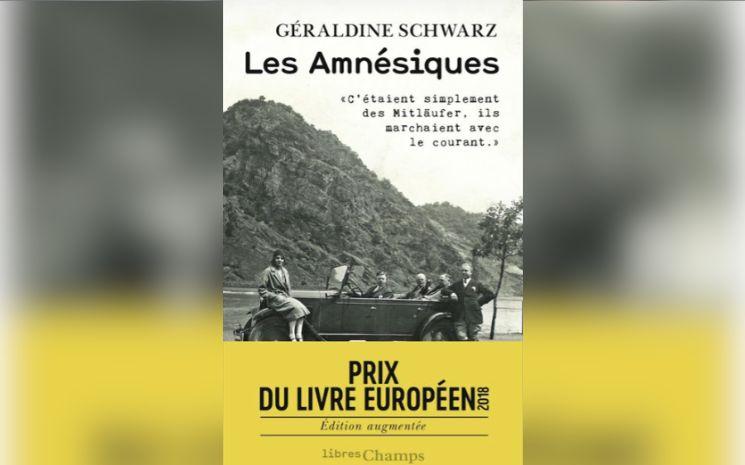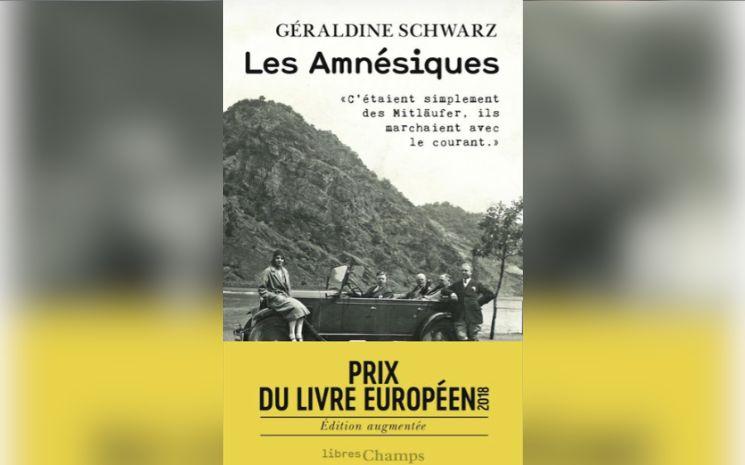Jusqu’au 10 juin 2026, le C/O Berlin présente une rétrospective de la photographe mexicaine Graciela Iturbide. En noir et blanc, elle nous livre un Mexique intime et vibrant, quelque part entre tradition et modernité. Elle y documente les rituels et les multiples facettes de son pays autant que sa propre identité, marquée par la mort et habitée d’oiseaux.


L’œil unique et intime d’une photographe en immersion
Née en 1942 à Mexico dans une famille catholique conservatrice, Graciela Iturbide ne se destinait pas à la photographie : elle voulait faire du cinéma. Mais sa rencontre avec le photographe Manuel Álvarez Bravo, dont elle devient l’élève dans les années 1970, change sa trajectoire.
Sa marque de fabrique : l’attention qu’elle porte à ses sujets, l’immersion totale, un travail qui n’est pas sociologique mais relationnel. On sent un attachement profond à chacune de ses images, une volonté d’en tirer le maximum, ainsi qu'un intérêt central pour les rencontres. On y lit les fusions et frictions entre tradition et modernité dans son pays, le Mexique.
Profondément respectueuse, Graciela porte son appareil en évidence, demande toujours la permission de photographier et privilégie l’immersion au témoignage distancié. C’est la pierre angulaire de son travail, intimiste et touchant. Et cela se ressent aussi dans la rétrospective, co-curatée par Sophia Greiff et Melissa Harris : elle ne donne pas l’impression d’un simple accrochage d’œuvres, la collaboration étroite avec l’artiste est évidente, jusque dans les textes muraux, authentiques et touchants, tirés de sa propre voix.

La mort et les oiseaux, les fils rouges de sa carrière
Si Graciela Iturbide n’a jamais détaillé le drame de la mort de sa fille, à six ans, au début des années 1970, on sait l’impact qu’il a eu sur son art. La photographie lui a permis de traverser le deuil en continuant d’être en lien avec le monde. Un rapport à la mort dénué de pathos, frontal et cru, mais apaisé, qui trouve un écho collectif : au Mexique, la mort est culturellement intégrée comme une dimension de la vie. Comme une transition, pas une fin.
Une des séries particulièrement poignantes est celle intitulée Death. Les « angelitos », ces enfants décédés habillés en anges lors de leur enterrement, apparaissent dans des images d’une douceur presque irréelle. Elle photographie une famille apportant un angelito au cimetière ; la famille accepte de poser pour elle. Sur le chemin, elle croise un cadavre en décomposition avancée sur la route, dévoré par des vautours. Elle raconte : « C’est comme si la mort me disait : tu veux me prendre en photo ? Me voici. »
Cette scène sera un déclencheur. Plutôt que de continuer à fixer la mort frontalement, elle commence à photographier les oiseaux. Entre terre et ciel, ils deviennent un fil discret entre les séries. Comme dans cet autoportrait où elle tient un oiseau vivant devant un œil et un oiseau mort devant l’autre – ¿Ojos para volar? – qui donne son nom à l’exposition. L’objectif photographique lui offre une vision d’oiseau, la possibilité de déplacer le regard, de prendre de la hauteur sans fuir.

Des communautés de Juchitán aux photos de mode
En 1979, elle reçoit sa première grande commande pour photographier la communauté Seri dans le désert de Sonora. Pendant un mois, en compagnie d’une anthropologue, elle documente la vie de cette communauté qui maintient traditions, rituels et mythes tout en adoptant des influences occidentales et américaines. Mujer ángel, également agrandie dans la salle, montre une femme en tenue traditionnelle traversant le désert, radio-cassette à la main. Une image simple et puissante, parfaite illustration de cette coexistence entre préservation culturelle et adaptation.
La série Juchitán documente une communauté aux rôles de genre distincts. On parle souvent d’une société matriarcale, même si les femmes elles-mêmes ne le formulent pas ainsi. À Juchitán, les femmes occupent le marché : elles vendent, négocient, travaillent, boivent, vivent. Les hommes n’y sont pas autorisés ; seules les femmes et les Muxes, troisième genre accepté socialement depuis des décennies, peuvent y entrer. Graciela Iturbide ne gomme pas les tensions : le rituel d’El Rapto, où le sang des draps est vérifié au matin, rappelle que des structures patriarcales persistent.
La série Mixteca documente le rituel de l’abattage des chèvres, à la croisée du colonialisme (le rituel a été importé par les Espagnols), de la mort et de la survie. Une seule chèvre est épargnée, recouverte de fleurs et célébrée. Une pratique jugée barbare par certains, mais qui contribue à l’économie de la région, car aucune partie de l’animal n’est gaspillée.
Et puis il y a la salle de bain de Frida Kahlo, restée fermée pendant près de cinquante ans. Graciela Iturbide y réarrange les corsets, les dispositifs orthopédiques, les bouteilles de Demerol, les objets personnels, comme des reliques d’une vie déchirée entre douleur et créativité. Elle s’y met aussi en scène, discrètement.

Même la photographie de mode, qu’elle évitait car trop éloignée de ses codes, trouve sa place. Elle accepte lorsqu’on lui donne carte blanche : Elle, Vogue, et surtout une collaboration avec la designer mexicaine Carla Fernández, qui travaille avec des groupes indigènes féminins. Une collaboration basée sur un vision partagée des femmes, de l’artisanat et... de la bienveillance.
Un regard qui traverse les frontières
Son regard dépasse le Mexique. Aux États-Unis, elle souhaite documenter les communautés d’origine mexicaine en Californie. Elle côtoie les cholos et cholas de East Los Angeles, membres du White Fence Gang, qu’elle photographie en 1986, en 1989, puis retrouve en 2007. Un projet au long cours qui explore les notions d’héritage et de continuité culturelle en milieu urbain, tout en soulignant l’importance de cette communauté dans la vie sociale et économique des États-Unis, même si cette reconnaissance leur est refusée.
En Inde, après un premier voyage centré sur les objets et les symboles (et déjà les oiseaux !), elle revient photographier des personnes transgenres, témoignant d’un respect similaire à celui accordé aux Muxes de Juchitán. Et au Bangladesh, guidée par une amie, elle pousse la porte d’une maison close, par curiosité, dans un pays où le travail du sexe est légal et encadré. Elle travaille aussi sur les jardins botaniques, où les arbres et plantes qui nécessitent des soins particuliers résonnent avec sa propre expérience. Des plantes mexicaines prêtées par le Jardin botanique de Berlin prolongent physiquement l’univers des photos.

Au fil des salles, on comprend que son noir et blanc n’est pas un effet esthétique. Dans un monde visuellement hyper stimulant qui se bat pour notre attention, ici, le noir et blanc détone. Un choix conscient, qui nous invite à focaliser notre regard et notre cerveau sur la structure et les sujets, l’essentiel plutôt que la surface.
Un choix qui va droit au cœur, pour documenter avec tendresse les multiples facettes de son pays, et les siennes, en mariant plutôt qu’en opposant tradition et modernité, vie et mort, ciel et terre.
Deux autres expos à découvrir
Comme toujours au C/O Berlin, on a en bonus de l’exposition principale deux expositions.

SHEUNG YIU - (Inter)faces of Predictions - C/O Berlin Talent Award 2025
Dans (Inter)faces of Predictions, Sheung Yiu prend son propre visage comme terrain d’enquête : celui qu’on “lit” pour deviner un caractère, et celui que les machines “analysent” pour classer, surveiller, prédire. La scénographie, pensée par la curatrice Veronika Epple, fait avancer dans un parcours circulaire, qui évoque aussi une chapelle contemporaine. Sur les murs, Sheung Yiu juxtapose photos, archives et schémas ; au sol et dans l’espace, des objets et des surfaces métalliques éclairées ; et surtout ces pierres gravées qui posent noir sur blanc deux définitions du visage — d’un côté le vocabulaire spirituel de la lecture faciale, de l’autre celui, froid, de l’informatique.
Le fil rouge, c’est l’Ouroboros (le serpent qui se mord la queue) : symbole ancien, mais aussi métaphore parfaite des feedback loops de l’IA — des données qui alimentent un modèle, qui produit des classements, qui finissent par influencer ce qu’on croit voir. Une installation vidéo pousse l’idée plus loin : l’artiste apparaît en avatar dans un paysage qui se révèle être… son propre visage, avec en voix off un récit qui va des croyances physiognomoniques aux deepfakes et aux visages synthétiques. Et en arrière-plan, l’essai de Megan Williams met le doigt là où ça fait mal : lire un visage, dit-elle en substance, c’est souvent une lecture “fatale” — parce qu’on confond signes et vérité, et qu’on finit par déléguer notre jugement, que ce soit à une croyance spirituelle, à une pseudo-science, ou à un algorithme.

Dörte Eißfeldt, Archipelago
Archipelago n’est pas un titre poétique plaqué pour faire joli. Il décrit vraiment la structure de l’exposition, qui n’a rien de linéaire. Comme dans un archipel, chaque “île” existe de manière autonome. Une série, un ensemble d’archives, un groupe de portraits : rien n’est central, rien n’est hiérarchisé. La curation de Boaz Levin ne déroule pas “50 ans de carrière” façon frise chronologique : elle fonctionne plutôt comme une constellation.
On passe d’un autoportrait dans son studio à des séries plus récentes, puis à des pièces des années 80–90, avec au milieu des carnets, des maquettes, des livres d’artiste, des fragments ressortis des archives. Ça donne l’impression d’entrer dans la tête de l’artiste, et dans son atelier.
Certaines œuvres sont accrochées sans cadre pour qu’on voie le papier, les bords, la surface. Une couche argentée capte la lumière et change l’image selon l’angle (par moments, ça reflète presque plus que ça ne montre). Dörte Eißfeldt joue avec des procédés et du coup, une boule de neige semble devenir un caillou cosmique, un couteau prend des airs de monolithe. Le dernier espace insiste sur le corps, celui des sujets, mais aussi celui des photos elles-mêmes.
➔ Retrouvez tous les détails des expositions et des évènements associés sur le site du C/O Berlin.
Pour recevoir gratuitement notre newsletter du lundi au vendredi, inscrivez-vous !
Pour nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
Sur le même sujet