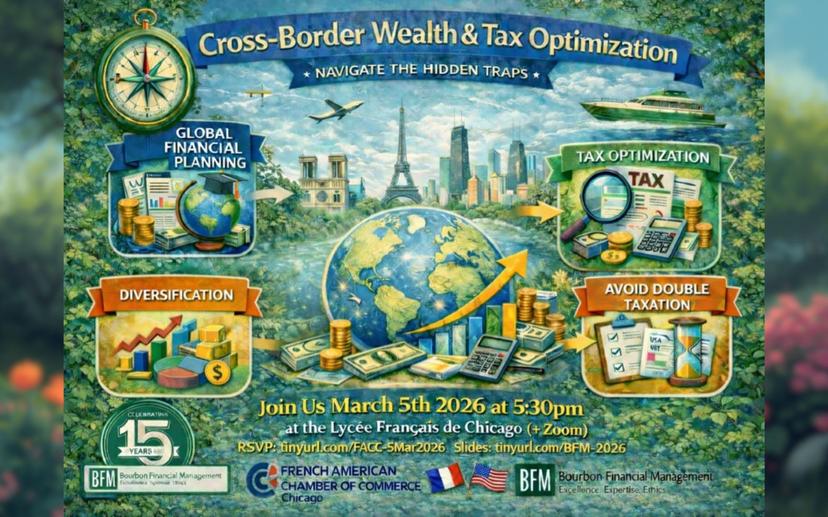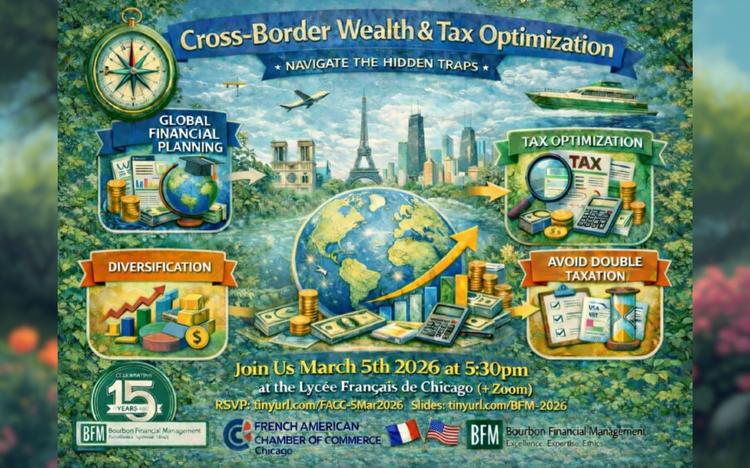« L’intérêt pour la langue française, la culture et les traditions francophones est manifeste aux États-Unis. », nous explique Corinne Cotereau, expatriée à San Diego depuis trois ans. La preuve en est avec la sortie de son premier roman, édité par Albin Michel, Providence Canyon. « Une diversion » créative pendant le Covid qui lui a permis de découvrir et de réinventer le désert d’Anza Borrego et son « impossible railway », comme son personnage principal, un expatrié français, plongé dans l’Amérique des laissés-pour-compte.


Comment êtes-vous arrivée aux États-Unis ?
J’ai habité trois ans à San Diego en famille. Cela m’a permis de changer de carrière en passant de juriste à artiste-peintre. Après un retour en France en 2009, je m’y suis réinstallée en février 2020. Cette fois sans enfants.

Comment vous est venue l'idée de ce roman Providence Canyon ?
J’ai écrit ce roman pour faire diversion. Je m’explique : au début du Covid, personne n’est en mesure de prévoir un retour à la normale. Les avions ne décollent plus, chacun se replie sur soi, chaque pays se referme. Et personne ne peut dire dans combien de mois ou d’années les frontières vont réouvrir. L’idée de savoir mes enfants de 18 et 20 ans seuls et sans famille, l’un à 10 000 km, et l’autre à 6000 km puisqu’il est à Montréal, m’angoisse terriblement. Je ressens un vide terrible, je ne suis pas loin de la dépression.
Un matin, je prends conscience que je vis dans un endroit extraordinaire dans le sens singulier. Je vais me promener sur Google Maps (on s’évade comme on peut en plein confinement). Je cherche des endroits que je n’ai pas encore exploré dans le désert d’Anza Borrego où j’aime aller camper. Des rails abandonnés et une photo de pont en bois attirent toute mon attention. Le pont de chemin de fer le plus long du monde est à deux heures de chez moi et je ne le connais pas ! C’est vraiment la providence qui le met sur mon chemin. Il enflamme mon imagination. À partir de cette photo, je fantasme. Je n’ai plus qu’une obsession : aller le découvrir, marcher au-dessus du vide et le traverser. Je me fais un film dans ma tête et peu à peu des personnages s’invitent dans l’histoire. Et si cette ligne de chemin de fer était réouverte ? Et si quelque chose ou quelqu’un était retrouvé dans un tunnel ? Et si… C’est en répondant à des « Et si » que l’on construit un roman. J’ai ressenti une espèce d’urgence à l’écrire. Il m’a permis de fuir la réalité du covid et d’arrêter de me lamenter sur mon sort (qui n’était pas si terrible comparé à beaucoup de gens). Et ça a été un bonheur de me perdre dans mon désert préféré en pensée.
S’expatrier c’est se déraciner et c’est loin d’être sans conséquence
Vous êtes expatriée aux États-Unis, comme votre personnage principal, est-ce que l'expatriation a été un moteur dans votre écriture ?
Bien sûr, oui. C’est toujours plus facile d’écrire sur ce que l’on connait. J’accorde beaucoup d’importance à la crédibilité dans une histoire. J’en avais assez des reportages télévisés qui font la part belle à la réussite par le travail. S’expatrier c’est se déraciner et c’est loin d’être sans conséquence. C’est emporter avec soi ses questionnements existentiels, ses fragilités et faire avec dans l’éloignement. J’avais envie de parler des perdants à travers mon héros, J-B. Ceux pour qui la route n’est pas facile et qui doivent faire preuve de beaucoup de résilience pour continuer à avancer. Concernant mon autre héroïne française, Stéphanie, je me suis inspirée de mon été dans l’Ouest quand j’avais 23 ans. Une expérience que j’ai fictionnalisé. Mes deux héros français cherchent leur place au monde. Ils quittent la France pour ne pas répéter les schémas familiaux, les injonctions sociales, mais ils transportent avec eux un sac à dos de blessures et même de traumas en ce qui concerne J-B. Écrire en français alors que je vivais dans un pays anglophone m’a permis une grande liberté. Ç’a été aussi un moyen de me rapprocher de mon propre pays grâce à ma langue maternelle.
Le nombre de personnes marginalisées par des problèmes de drogue ou des problèmes de santé mentale ne fait qu’augmenter
Quelle est votre vision de cette Amérique des laissés pour compte que vous décrivez dans votre roman ?
Difficile de rester insensible aux inégalités lorsque l’on vit en Californie. Il existe une telle disparité entre riches et pauvres. Je vis dans l’État dans lequel se concentre le plus grand nombre de sans domiciles fixes. Comme Los Angeles, San Diego voit son centre-ville envahi par des tentes. Le nombre de personnes marginalisées par des problèmes de drogue ou des problèmes de santé mentale ne fait qu’augmenter. L’accès au soin dans ce pays reste compliqué. La frontière avec le Mexique n’est qu’à 20 minutes du centre-ville. Je voulais parler de cette réalité actuelle à laquelle sont confrontés de nombreux immigrants et travailleurs précaires dans l'Amérique contemporaine. En matière de système de santé, j’ai une vision très française, je ne comprends pas qu’un établissement de santé puisse vous demander comment vous comptez payer votre traitement contre votre cancer avant de vous soigner par exemple. La société américaine me parait très résiliente. Et heureusement que certaines communautés religieuses et associations pallient au manque de budget.
Je trouve que c’est une vraie chance de pouvoir échanger et partager notre héritage culturel
En ce mois de la francophonie, quel est votre regard sur la francophilie des Américains ?
L’intérêt pour la langue française, la culture et les traditions francophones est manifeste aux États-Unis. Nous bénéficions d’un capital sympathie grâce aux liens historiques qui nous lient à l’Amérique. Je trouve que c’est une vraie chance de pouvoir échanger et partager notre héritage culturel. Qu'il s'agisse de la cuisine, de la musique, du cinéma, de la littérature, de l'histoire ou même du mode de vie. Le réseau des alliances françaises est très actif et je vais d’ailleurs prendre beaucoup de plaisir à présenter mon roman devant des francophiles avertis à l’automne.
Sur le même sujet