

L’art minimaliste est un courant d’art moderne apparu dans les années 50 à New York, et dont l’idée est de supprimer toute interprétation possible. Dénué de référence, de valeur symbolique et sans lien avec le monde qui l’entoure, le mouvement ne laisse pas indifférent. Au total, ce sont plus de 150 œuvres de 70 artistes qui sont présentées simultanément à la National Gallery et à l’ArtScience Museum.
Les origines de l’art minimaliste sont probablement à chercher, au début du 20ème siècle, du côté de Marcel Duchamp et de ses œuvres qui ont donné naissance à son mouvement, le Ready-made. L’artiste a pris autour de lui des objets « tout faits » du quotidien, tel qu’un urinoir qu’il a renversé et auquel il a attribué le nom de Fontaine. Le cynisme de l’artiste, poussé à son paroxysme, arrive après une période impressionniste et cubiste, au cours de laquelle les artistes devaient inventer et créer. « L’artiste créé, mais au final ce sont les regardeurs qui font les tableaux » s’amusera-t-il à dire. D’autres artistes ont suivi son idée, tel que Kazimir Malevitch, probablement considéré comme le premier artiste minimaliste, avec son œuvre Black Square, un carré noir sur fond blanc. Viendra ensuite Ad Reinhardt, l’autre grande figure qui, voulant tourner le dos à la figuration, se mit à peindre des monochromes, ces toiles recouvertes intégralement d’une seule teinte de couleur.

Less is more
Le minimalisme est un écho majeur des philosophies asiatiques, du mouvement zen ou du bouddhisme. La position de l’œuvre dans l’espace est aussi importante que l’œuvre elle-même, de même que l’espace entre les œuvres. Celles-ci se caractérisent par l’utilisation de structures simples, par des formes géométriques de base, et une palette de couleurs restreintes… Les matériaux choisis ont leur importance, et on retrouve parfois des œuvres environnementales limitées dans le temps. Cette caractéristique éphémère s’inscrivant parfaitement dans l’esthétique minimaliste. L’idée consiste, par conséquent, à donner du sens à partir du strict minimum. Le vide aussi est central au mouvement. Par son existence intangible représentant l’espace, lorsqu’il se trouve au-dessus de nos têtes, lorsqu’il nous entoure ou lorsqu’il est entre les atomes, le vide a une forte influence sur les artistes.
2 musées pour 2 approches différentes

L’ArtScience Museum de son coté, propose une exposition thématique centrée 
Retour à l’essentiel
Courant majeur du 20ème siècle, le minimalisme a eu un impact extraordinaire dans tous les arts, de la peinture à la sculpture, en passant par la musique, la danse, le design, la mode, la photographie ou encore le théâtre. On y retrouve des artistes comme Dan Flavin, Ai Weiwei, Tatsuo Miyajima, mais aussi Olafur Eliasson, Anish Kapoor et, bien entendu, Donald Judd. Le mouvement a ensuite évolué vers le post-minimalisme qui, tout en gardant les caractéristiques principales, a apporté plus de souplesse par rapport à la rigueur originelle des formes géométriques, des matériaux et au processus de fabrication. Le minimalisme, c’est donc aller à l’essentiel et rejeter le superflu. Dans notre société de consommation, dans laquelle le bonheur est d’avoir, le mouvement minimaliste trouve écho auprès de personnes qui pensent que le fait de ne pas posséder un objet permet d’apprendre à se satisfaire de ce que nous avons, au lieu de continuer à accumuler. Un retour à l’essentiel en quelque sorte.






















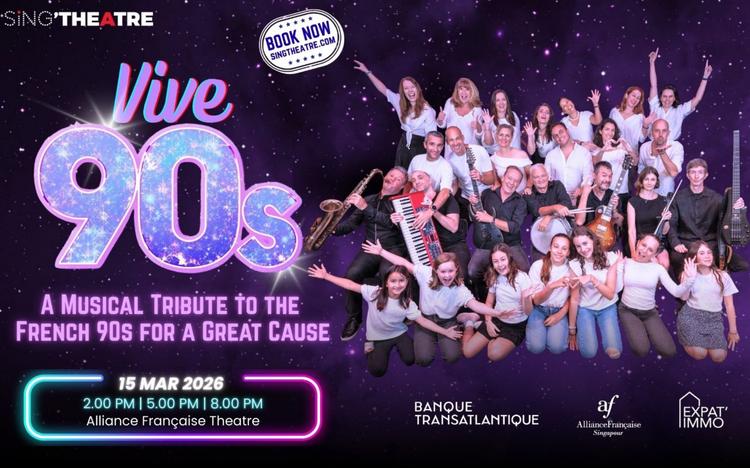
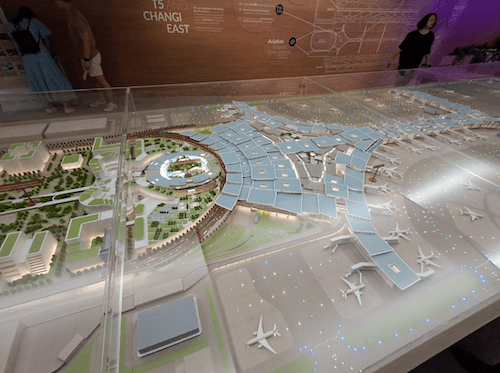
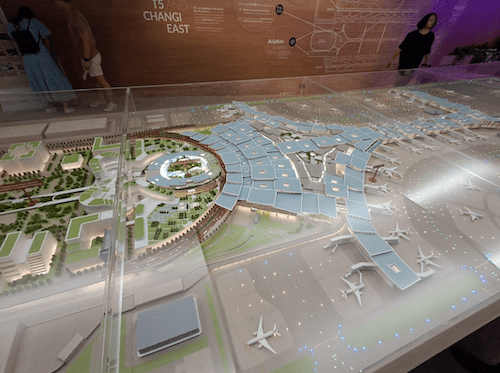


![Quatre comédiens de la comédie [title of show] sur un fond jaune semblent chanter.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbackoffice.lepetitjournal.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2025-12%2F%255Btitle%2520of%2520show%255D.jpeg&w=828&q=75)
![Quatre comédiens de la comédie [title of show] sur un fond jaune semblent chanter.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbackoffice.lepetitjournal.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2025-12%2F%255Btitle%2520of%2520show%255D.jpeg&w=750&q=75)

