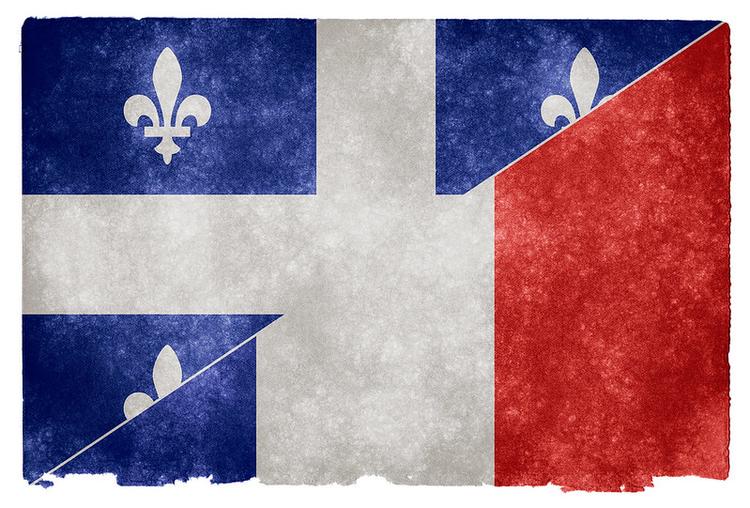Dans Lettre à Matys sur la littérature et autres choses humaines (Éditions project’île, 2025), Lyonel Trouillot s’adresse à un enfant comme on parle à l’avenir, avec lucidité, tendresse et inquiétude. Il y interroge la place des mots dans un monde abîmé.


Grande figure de la littérature francophone, l’écrivain et essayiste Lyonel Trouillot ne cherche pas à répondre à la fameuse question « pourquoi écrire ? ». Il s’en explique sans détour :
« Je ne me pose pas la question pourquoi j’écris. Écrire m’est devenu une nécessité intérieure. Le jour où ce ne sera plus le cas, je n’écrirai plus. La question que je me pose en vrai est celle d’avec quoi j’écris. Et pourquoi je publie ce que je publie. Parce qu’il y a là un enjeu social. Cela ne se joue pas qu’entre moi et moi. À quelle conversation sur les choses de ce monde le texte invite-t-il dans sa réussite ou sa maladresse ? C’est la question que je pose en tant que lecteur, et je me la pose en tant qu’écrivain. »
Il ne croit pas que la littérature doive se plier à des injonctions, pas même à celles d’une posture militante. Ce serait une contradiction, voire une dérive :
« Je refuse de poser une problématique du devoir dans le positionnement de l’écrivain ou de la littérature. C’est affaire de choix. Le plus étrange, c’est qu’aujourd’hui les idéologues sont ceux qui clament que la littérature “ne peut pas”, que l’écrivain “ne doit pas”. L’idéologie de l’incompatibilité de la littérature avec la mise en œuvre de discours revendicatifs est triomphante en Occident. Surtout quand il s’agit de racisme et de lutte des classes. L’Occident n’a rien contre une littérature qui défend les droits des animaux ou des fleurs, mais disqualifie une littérature qui traite de la lutte des classes. Ressentir le besoin de dire est une affaire de choix politique, idéologique, individuel. Je ne peux pas imposer un ressenti à quelqu’un, fût-il écrivain, maçon ou gynécologue… Ce contre quoi je m’insurge, c’est l’idée que, dans son principe même, dans son rapport au langage, la littérature doit ignorer Gaza, la traite, les rapports de domination et d’exploitation qui organisent le monde. »
S’il fallait introduire un lecteur à la littérature haïtienne, l’auteur de Bicentenaire et de La belle amour humaine hésite. La tâche lui semble délicate.
« Difficile. Imprudent. Je dirais Ces îles qui marchent de René Philoctète et l’inimitable Gouverneurs de la rosée. Mais là encore, de quel lieu dire cela, choisir, évaluer ! »
Évoquer Haïti avec Lyonel Trouillot, c’est convoquer une lucidité sans compromis sur la situation politique et sociale du pays. Il dit :
« Haïti va comme un pays qui n’a jamais établi une sphère commune de citoyenneté, avec une classe dominante dont le seul signe de distinction est l’éloignement ; un État qui n’a jamais fait que laisser les riches s’enrichir sans proposer d’éthique transversale ni fournir un minimum de services à la population, un État embourbé dans des parodies de démocratie formelle imposées par l’Occident. Haïti, c’est un pays qu’on enferre et enterre dans des logiques de continuité qui n’assureront que la permanence du pire. C’est aussi un pays, heureusement, dans lequel il y a une résistance à cela, portée par des voix que le monde refuse d’écouter. »
Et de rappeler que cette clairvoyance n’est pas nouvelle :
« Pour revenir à la littérature, les écrivains l’ont dit depuis longtemps que ce pays allait à sa perte en produisant et reproduisant trop d’inégalités. Oswald Durand, Carl Brouard, Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis, Anthony Lespès, René Philoctète, Georges Castera, Frankétienne… »
Né à Port-au-Prince, Lyonel Trouillot écrit en créole et en français. Traduit dans de nombreuses langues et salué internationalement, il est l’un des auteurs haïtiens les plus influents de sa génération. Il est l’auteur de romans remarqués comme Bicentenaire, La belle amour humaine, Kannjawou et Veilleuse de calvaire, publiés chez Actes Sud.

Sur le même sujet