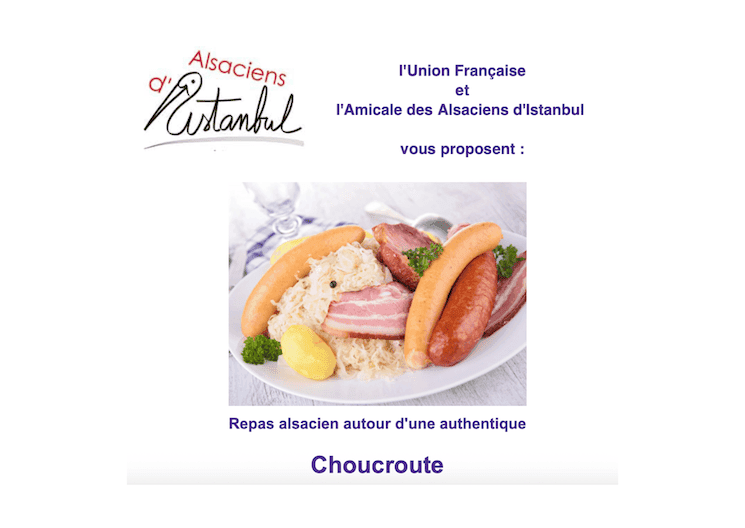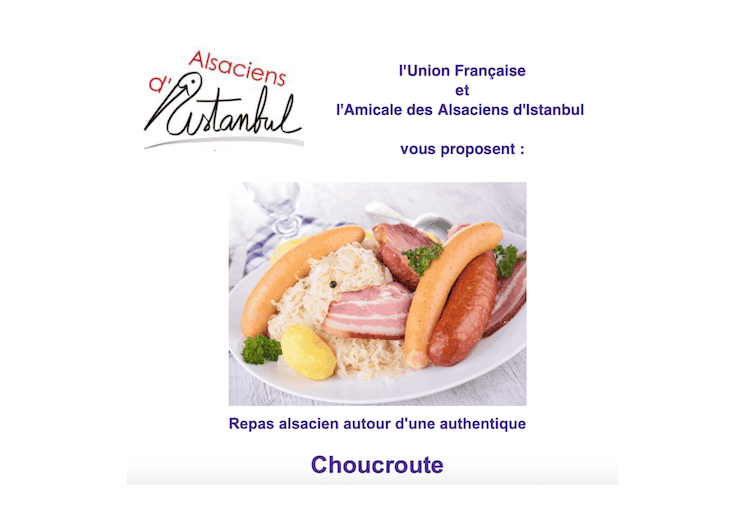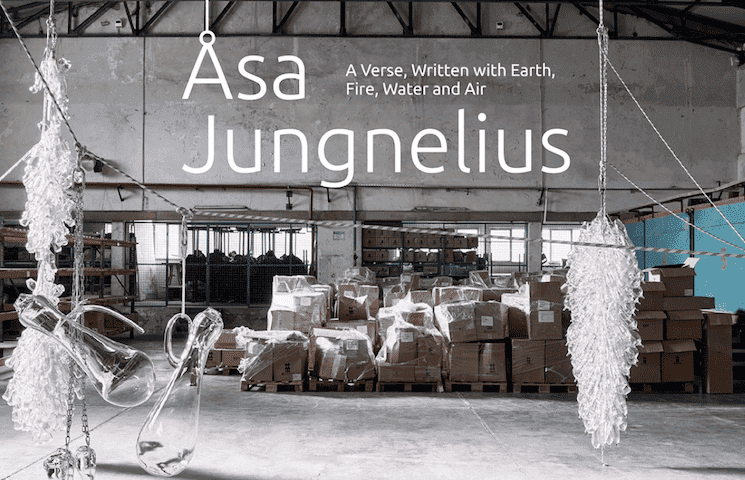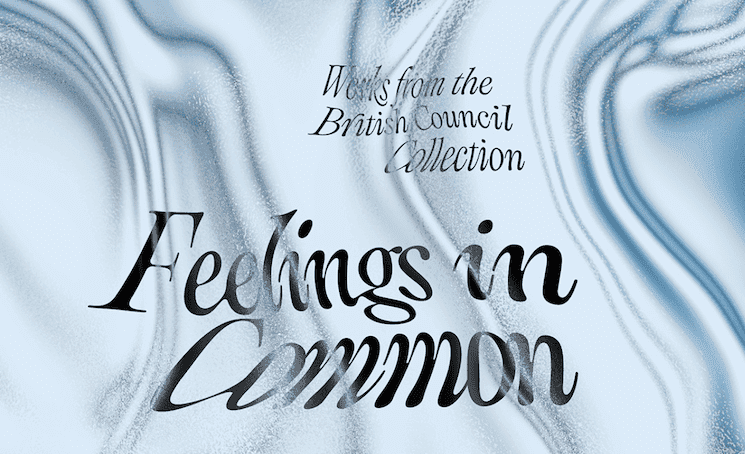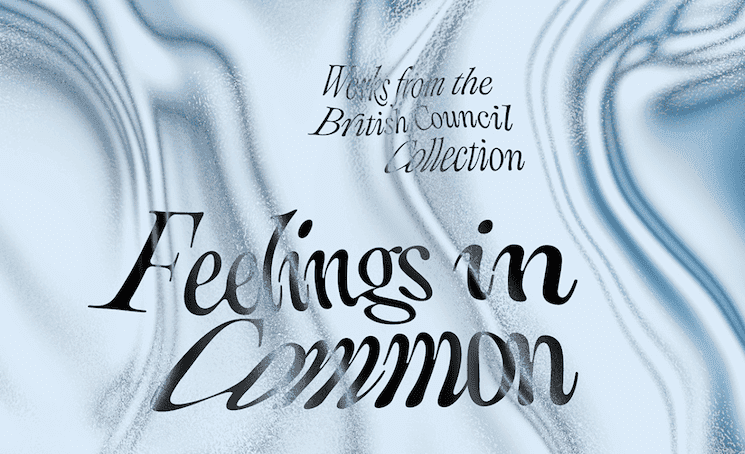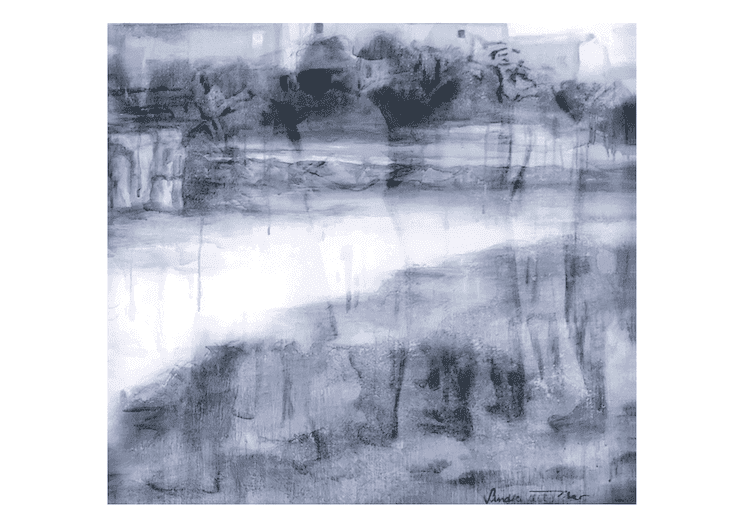Depuis l’opération "Déluge d’Al-Aqsa" initiée par le Hamas le 7 Octobre 2023 et la réponse militaire israélienne conséquente, le conflit israélo-palestinien est de nouveau la première préoccupation de la communauté internationale. La classe politique turque n’y fait pas exception.


Un positionnement diplomatique délicat
Alors que le gouvernement turc se rapprochait de plus en plus d’Israël ces dernières années, l’irruption du conflit a placé la Turquie dans une position délicate. La première réaction du président Recep Tayyip Erdoğan fût d’appeler à la paix avant de se proposer en médiateur, puis de franchement réaffirmer son soutien à la Palestine à la suite du bombardement de l’hôpital gazaoui al-Ahli Arabi le 17 octobre - s’associant ainsi au reste de l’Assemblée de Turquie dans la condamnation des actions d’Israël.
La doctrine diplomatique de son parti l’AKP avait toujours mis un point d’honneur à promouvoir une solidarité panislamique, la Palestine relevant à ce titre d’une importance symbolique. Le président Erdoğan s’était distingué par sa réaction à de précédents bombardements sur Gaza en 2008, qualifiant Israël de "tueur d’enfants" et coupant même les liens diplomatiques avec le pays en 2010 et en 2018, suite à l’incident du Mavi Marmara. Il aurait donc pu être attendu de la Turquie un soutien direct et inconditionnel de la Palestine, peut-être même accompagné de décisions ou déclarations à l’encontre de Tel-Aviv.
Les choses sont cependant beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît, les deux pays s’étant graduellement rapprochés avec le temps. Engagée dans la guerre de Syrie, la Turquie a trouvé en Bashar el-Assad un ennemi commun avec Israël, ce qui a entraîné un accroissement de la coopération militaire et un premier rétablissement des relations diplomatiques en 2016. Ensuite, le conflit au Nagorno-Karabakh a de nouveau fait des deux États des alliés indirects par l’intermédiaire de Bakou. Enfin, sur le dossier des gisements gaziers en Méditerranée orientale, le président Erdoğan tente aujourd’hui de faire valoir les revendications de la Turquie par la diplomatie, et compte beaucoup sur le soutien d’Israël pour y parvenir. C’est dans ce contexte qu’en 2022, les liens diplomatiques avaient été rétablis.
De l’autre côté, l’Autorité Palestinienne tout comme le Hamas ont adopté des positions opposées à la Turquie sur les mêmes dossiers : condamnant sa présence en Syrie, soutenant l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, soutenant l’indépendantisme kurde et voyant d’un œil suspect les ambitions maritimes turques. Alors, un revirement stratégique aurait-il été plus logique pour la Turquie ? Non plus, car il est certain que le gouvernement et ses soutiens ont gardé une attitude pro-palestinienne pour des raisons de proximité religieuse et civilisationnelle, qui résiste à la conjoncture géostratégique. Le président Erdoğan entretient par ailleurs toujours des relations cordiales avec Mahmoud Abbas, le président palestinien comme avec Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas.
Le choix du soutien palestinien
De fait, l’AKP comme son allié le MHP (parti ultranationaliste) ont plutôt opté pour la voie pro-palestinienne. Les soutiens du gouvernement ont également démontré leur appui à la Palestine par des manifestations de grande ampleur à Istanbul et à Ankara, allant même jusqu’à menacer l’ambassade et le consulat israéliens en réaction au bombardement de l’hôpital al-Ahli Arabi. En retour, Israël a rappelé son ambassadeur et a demandé à tous ses ressortissants de quitter le territoire turc. Enfin, dernièrement, Devlet Bahçeli, le leader du MHP, a même lancé un ultimatum à Israël, menaçant d’une intervention turque si les bombardements ne cessaient pas.
Le soutien à la Palestine n’est cependant pas pour autant le monopole de la majorité gouvernementale. Le CHP, principal parti d’opposition, a affirmé se placer "aux côtés du peuple palestinien" et a qualifié les actes d’Israël de terrorisme, tout comme l’a fait la présidente du IYI Parti, Meral Aksener. Ainsi, il semblerait qu’à l’heure actuelle la classe politique turque fasse front commun en soutien au camp palestinien contre les agissements d’Israël, à l’exception notable du Zafer partisi.
İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir.
— Meral Akşener (@meral_aksener) October 17, 2023
Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir.
Başta Birleşmiş Milletler olmak…
Le Zafer et la montée de la voie anti-arabe
Le Zafer partisi considère que la cause palestinienne n’est simplement pas l’affaire de la Turquie. Son président Ümit Özdag, tout en condamnant les crimes de guerre israéliens, a simplement déclaré que la Turquie n’avait pas à s’impliquer dans une "cause arabe", du moins tant que les Arabes ne s’impliqueraient pas aux côtés des Turcs dans leurs disputes géopolitiques. Il a par ailleurs déclaré que ceux qui disaient vouloir défendre Gaza devraient partir y combattre et laisser la Turquie en dehors de cette affaire, et s’est directement prononcé contre le fait d’arborer le drapeau palestinien où que ce soit sur le territoire turc.
Filistin davası bütün İslam dünyasının değil Filistinli Arapların ve daha sonra diğer Arap uluslarının çıkarları ölçüsünde davasıdır. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Bu açıklanmam üzerine malum Arapperest çevrelerden strateji ve jeopolitik anlamında salakça…
— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 17, 2023
Cette attitude vis à vis de la Palestine correspond à celle d’un nombre croissant de citoyens turcs, poussé par une hostilité générale envers les Arabes avivée par la situation migratoire. Allant plus loin que le Zafer, certains vont jusqu’à supporter Israël et afficher son drapeau sur les réseaux sociaux. Également, beaucoup considèrent que les Arabes seraient "ennemis héréditaires des Turcs", citant notamment la révolution arabe de 1917 qui a correspondu à l’éclatement de l’Empire ottoman comme exemple de cette inimité. Il est courant en Turquie de dire que le rouge présent sur les drapeaux du monde arabe représente le sang des Turcs tués par les Arabes lors de la guerre d’indépendance. Il serait donc impensable à ce titre de défendre les couleurs de la Palestine.
Ainsi, malgré une opinion générale convergeant depuis le 17 octobre vers un soutien à la Palestine et une condamnation des actions d’Israël, les raisons sous-jacentes restent multiples, allant de la solidarité islamique à l’anti-impérialisme en passant par les préoccupations humanitaires. De l’autre côté, la population fait état de profondes divisions entre soutiens indéfectibles à la Palestine, opposants farouches à toute cause arabe et à ceux ne voulant avoir à faire avec aucun des deux partis. Alors que le centenaire de la République approche, il revient au gouvernement de décider si la Turquie doit s’impliquer davantage dans ce conflit et de quelle manière, ou s’il vaut mieux pour elle qu’elle se concentre sur ses problématiques internes. Son choix, quel qu’il soit, pourrait être lourd en conséquences.
Pour recevoir gratuitement notre newsletter du lundi au vendredi, inscrivez-vous en cliquant ICI
Sur le même sujet