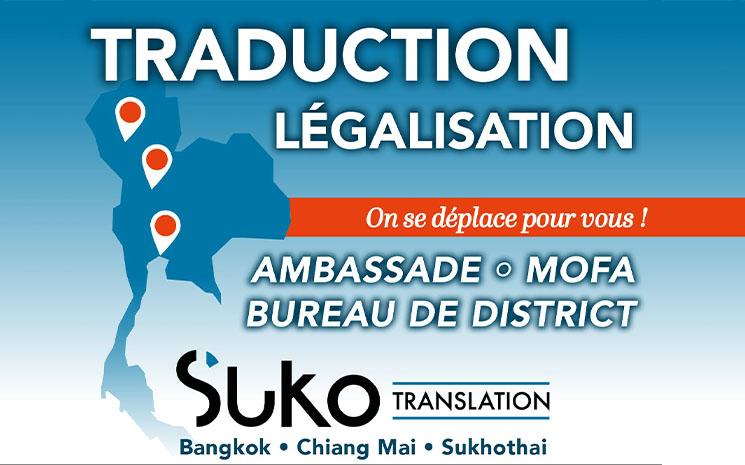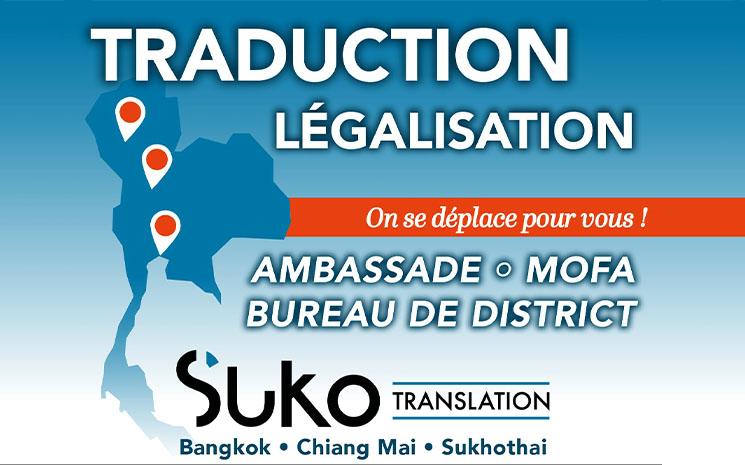Voilà plus de vingt ans qu’Alliance Anti Trafic lutte contre l’exploitation sexuelle et se bat avec ses faibles moyens pour créer un avenir meilleur pour les victimes. Autour de Jürgen Thomas, directeur général d’AAT Thaïlande, salariés et bénévoles sont une centaines à pouvoir être satisfaits d’avoir sauvé plus de 3.000 femmes de leur enfer. Hélas, le combat continue et les réseaux sociaux n’arrangent rien.


Le Petit Journal : Quand et comment les choses ont-elles commencé pour AAT ?
Jürgen Thomas : Tout a commencé avec Agir pour les femmes en situation précaire (Afecip), une association créée au Cambodge, en 1998, par Pierre Legros et Somaly Mam. Leur objectif était de protéger les femmes de la prostitution. Georges Blanchard avait un projet similaire à Ho Chi Minh ville. En 2001, ils ont décidé de s’unir pour sauver les femmes vietnamiennes prostituées au Cambodge et les ramener dans leur pays d’origine. J’ai été embauché en 2003 pour ouvrir une branche en Thaïlande.
LPJ : Qu’est-ce qui vous a amené, un jour, à venir ici sauver les femmes d’Asie du Sud-Est de la prostitution ?
La situation du tourisme sexuel en Thaïlande m'a révolté et j’ai eu envie de m’impliquer.
J.T. : Je n’y étais clairement pas prédestiné. Enfant, j’étais fasciné par les forêts et les animaux sauvages de la région. Hélas, lorsque je m’informais sur la vie en Asie du Sud-Est, j’entendais également parler de la prostitution et du tourisme sexuel en Thaïlande. La situation m’a révolté et j’ai eu envie de m’impliquer. Après un BTS d’électrotechnique, je me suis inscrit à Bioforce, une école lyonnaise de logistique de la solidarité, seule école du genre à l’époque. J’y ai rencontré ma femme thaïlandaise. J’ai consulté des ONG pour pouvoir me concentrer sur l’Asie du Sud-Est mais on m’a expliqué que je ne pouvais pas choisir ma destination. J’ai alors économisé et pris mon billet d’avion en 2000. J’ai d’abord fait du bénévolat dans des associations qui travaillaient contre la prostitution.

LPJ : Qu’est-ce qui fait de la Thaïlande une plaque tournante ?
J.T. : La Thaïlande se trouve géographiquement au centre de l’Asie du Sud-Est, donc au centre dans la traite des humains en vue de prostitution. Les filles viennent de tous les pays alentours, soit pour être trafiquées ici, soit pour traverser le pays vers la Malaisie ou Singapour. La Thaïlande est un pays clé parce qu’à la fois envoyeur, receveur et pays de transit.
On nous a d’abord demandé de rapatrier vers leur pays les Cambodgiennes et les Vietnamiennes.
LPJ : Comment a débuté votre action avec l’association ?
J.T. : Nous avons ouvert l’association en Thaïlande avec ma collègue thaïlandaise Chaleerat Seangsuwan. Je n’avais que vingt sept-ans et elle huit de plus. J’étais les bras, elle était la tête. On nous a demandé, à l’époque, de rapatrier vers leurs pays d’origine les Cambodgiennes et Vietnamiennes que nous trouvions. Les Thaïlandais s’occupaient alors des Thaïlandaises mais pas des étrangères. L’Organisation Internationale pour les Migrations nous a alertés sur le fait que cinq Vietnamiennes se trouvaient dans une prison du sud de la Thaïlande. Nous avons pris un interprète et nous sommes allés discuter avec elles. C’est ainsi que nous avons réalisé l’ampleur du trafic. Elles avaient été arrêtées pour un passage de frontière illégal au retour de Malaisie, avec de faux papiers. Les trafiquants les renvoyaient parce qu’elles avaient fait leur temps. Elles étaient physiquement et psychiquement épuisées. Nous avons organisé leur rapatriement parce qu’elles arrivaient à la fin de leur peine. Elles étaient considérées comme coupables et non victimes. Nous avons monté des procédures pour les faire reconnaître comme victimes.

LPJ : Après ces premières actions, les choses ont évolué…
J.T. : Fin 2006, Afecip a décidé de se concentrer sur le Cambodge. Nous avons alors créé Alliance Anti Trafic avec Georges Blanchard, dans le but de sauver nos programmes. Nous avons mis en place des équipes d’enquêteurs et d’avocates pour trouver les femmes victimes d’exploitation sexuelle en Thaïlande et les prendre en charge. Nous les amenons ensuite à la cour de justice pour qu’elles obtiennent réparation et reconstruction. Nous travaillons en lien étroit avec la police et les services sociaux. On identifie, on sauve. Nos enquêteurs amènent des preuves aux autorités et nous menons des raids pour sortir les filles des bordels où elles se trouvent et arrêter les criminels. Plus de 3.000 filles ont ainsi été exfiltrées des bordels depuis vingt ans. Au départ, il s’agissait surtout de Birmanes et de Laotiennes. On s’est hélas aperçu qu’elles n’étaient pas suivies dans leur pays d’origine et qu’elles se retrouvaient trafiquées à nouveau en Thaïlande. Nous avons donc élargi le programme pour aider à leur réinsertion chez elles. Nous avons aujourd’hui des employés de ces deux pays pour nous aider dans cette tâche.

LPJ : Il y a une dizaine d’années, les réseaux sociaux ont changé la donne.
J.T. : Comme ailleurs, la prostitution en Thaïlande s’est en effet adaptée aux réseaux sociaux. Les filles sont désormais recrutées dès 12-13 ans en ligne. Nous avons commencé, à cette époque, à nous occuper beaucoup plus des Thaïlandaises. Nous avons toujours des enquêteurs de terrain mais aussi des enquêteurs en ligne qui traquent les trafiquants. L’opération du salon de massage Victoria secret de Bangkok a été la dernière opération physique de grande envergure. Nous enquêtions sur une victime de Birmanie, trafiquée en Malaisie. Elle nous a expliqué qu’elle était passée par ce salon et nous avons sorti 113 filles de là, dont 12 ont été reconnues victimes de traite des êtres humains. Il s’agit surtout de mineures car il est plus difficile de faire reconnaître ce statut pour des jeunes femmes majeures. Depuis, il n’y a quasiment plus de mineures dans ce genre d’établissement. Nous avons également trouvé beaucoup moins d’étrangères ensuite. La prostitution s’est développée dans les pays d’origine, notamment au Laos et en Birmanie. Quant aux Thaïlandaises, elles sont de plus en plus envoyées à l’étranger, à Dubaï, dans les Émirats, à Abu Dhabi, en Corée du Sud, au Japon et même au Bénin ! La situation a également évolué vers un trafic de filles qui sont envoyées en Chine pour y être mariées de force. Il y manquerait trente millions de femmes à cause de la politique de l’enfant unique qui privilégiait les garçons. Nous avons adapté nos projets pour nous occuper de cela aussi et nous nous mettons à explorer l’Europe, notamment l’Allemagne.

LPJ : Avec quels moyens faites-vous tout cela ?
J.T. : Nous sommes vingt-sept salariés dans l’équipe, en Thaïlande, au Laos, en Birmanie et une personne en France. Il s’agit surtout de Thaïlandais. Je dois ajouter et remercier les bénévoles. Nous vivons d’aides de grosses ONG qui ne sont pas des ONG de terrain et nous déléguent ce travail. Nous ne recevons pratiquement pas de dons directs. Signalons tout de même que nous avons récemment reçu des dons de L’Oréal, de la Fondation groupe EDF, de la Fondation RAJA Danièle-Marcovici, des donateurs que je tiens à remercier également. Si ceux qui nous lisent veulent nous aider, je leur serai reconnaissant. Nos besoins sont de plus en plus importants et les fonds nous manquent. Nous voudrions pouvoir nous occuper de la situation au Bénin et de toutes les victimes qui nous contactent directement mais nous sommes malheureusement obligés de sélectionner les cas que nous prenons en charge. C’est terrible. Ma priorité numéro un serait de parvenir à sauver toutes celles qui le demandent. La deuxième, d’augmenter les employés, ce qui n’a pas été fait depuis 5 ans. Ils restent par fidélité alors qu’ils pourraient gagner plus ailleurs. Cette équipe est extraordinaire.
Alliance Anti Trafic a besoin de vous
Si vous rencontrez ou entendez parler d’une potentielle victime, si vous avez vent des agissements d’un potentiel criminel, connectez-vous sur le site d’Alliance Anti Trafic et faites des signalements. Vous pouvez, vous aussi, contribuer à sauver des vies.
Si vous souhaitez aider Alliance Anti Trafic, rendez-vous sur www.aatthai.org pour donner directement en Thaïlande.
Pour un don défiscalisé, vous pouvez aussi donner en France, via La Voix de l’Enfant…
Sur le même sujet