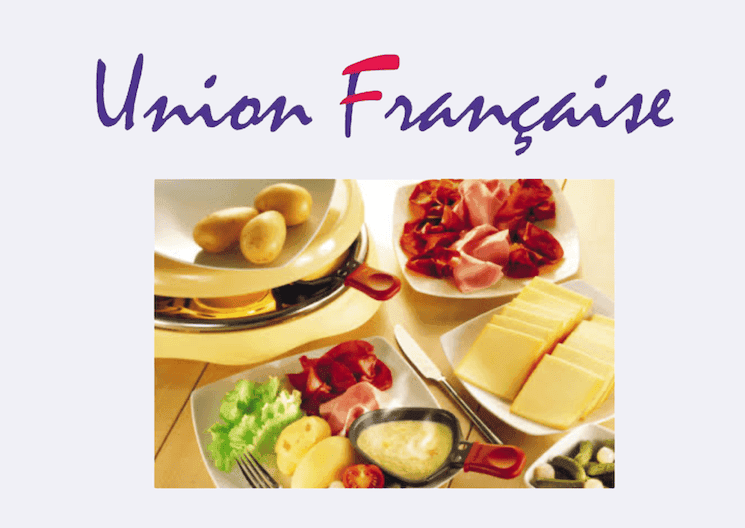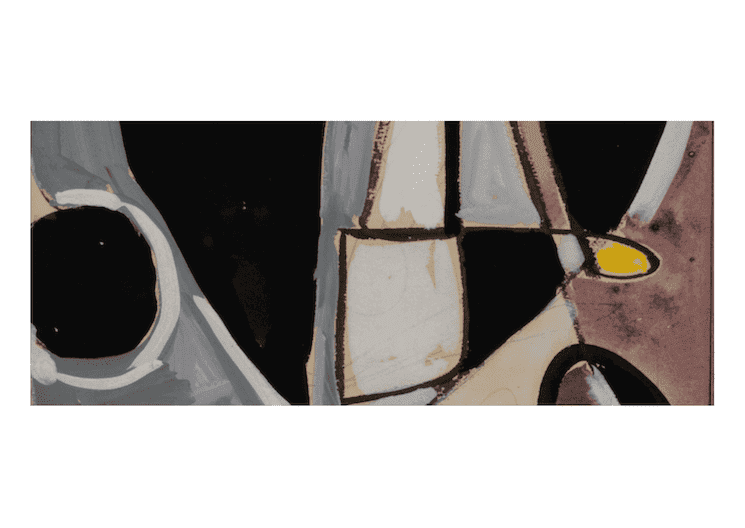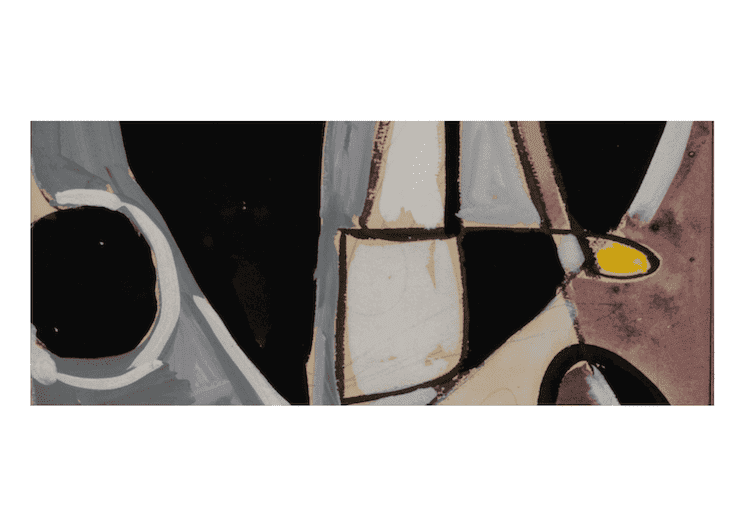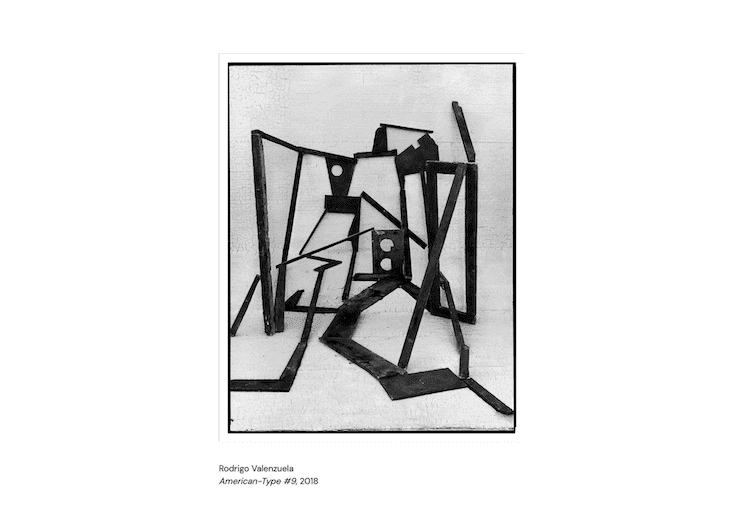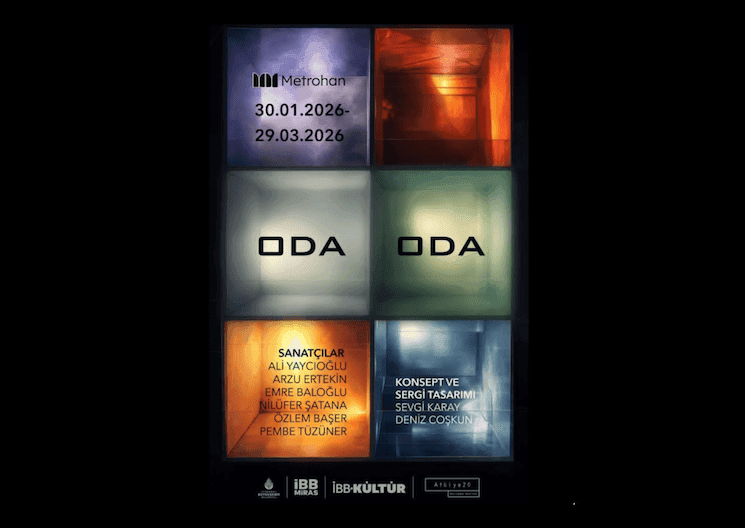Venu au monde le 27 avril 1876 à Lyon, Claude Farrère est, avec Pierre Loti, passé à la postérité comme un écrivain turcophile. C’est, en effet, le 13 août 1902, que l’enseigne de vaisseau Charles Bargone, futur Claude Farrère, âgé de vingt-six ans, est muté à Istanbul, sur le Vautour, l’aviso-stationnaire de l’ambassade de France à Tarabya.


Une année plus tard, l’arrivée du nouveau commandant du vaisseau, Julien Viaud, alias Pierre Loti, écrivain déjà célèbre pour une multitude de romans, dont ses œuvres "turques" comme Aziyadé, Fantôme d’Orient ou Constantinople, place le séjour stambouliote de Farrère sous le signe de la littérature. Effectivement, ce premier voyage de Farrère en Turquie sera fertile en création littéraire. Mais aussi en événements personnels, dont certains sont marqués par le sceau du secret. Alors, que cache Claude Farrère à Istanbul ?


Tout d’abord, il dissimule à presque tout le monde qu’il nourrit l’ambition de faire carrière dans la littérature, et en particulier à Pierre Loti, son supérieur hiérarchique. Les relations entre les deux hommes sont conventionnelles. Pierre Loti ne peut ignorer les projets littéraires de Farrère, qui a déjà publié des articles dans des revues sous le nom de Pierre Toulven et a même remporté le prix littéraire d’un journal pour l’une de ses nouvelles. Mais il ne lui en parle jamais et Claude Farrère se tait, habité par le sentiment que Loti ne l’apprécie pas. "Loti ne m’a jamais parlé de littérature, sauf une unique conversation…", confie-t-il dans ses Souvenirs. Pourtant, chaque soir, dans l’isolement de sa cabine, Claude Farrère écrit. Il écrit même beaucoup puisque Fumées d’Opium paraîtra l’année suivante et qu’il travaille à son roman Les Civilisés, qui lui vaudra le prix Goncourt en 1906.
Qu’occulte-t-il d’autre ? Sa vie nocturne à Péra ? Pas seulement ! Certes, habitué du salon d’une Levantine, Madame Duz, Rue de Brousse, il passe beaucoup de soirées à flirter avec de jeunes Pérotes, caricaturées, en 1906, dans L’Homme qui assassina. Mais son secret, ce sont ses nuits passées à fumer l’opium ; non pas le narguilé, dont il n’aime pas l’odeur mais la pipe ottomane : "Je préfère le tchibouk avec son long tube de jasmin, dont le fourneau minuscule repose sur un plateau d’argent qu’une esclave, circassienne autant que possible, surveille pour vous, tandis que vous rêvez..." écrit-il.

C’est que Farrère, comme beaucoup de marins français de cette époque ayant vécu en Asie, est opiomane ; il le demeurera toute sa vie et fera même l’apologie de la "bonne drogue". Dans une lettre à son ami Pierre Louÿs, il avoue qu’il est capable de fumer cent-seize pipes dans une nuit ! Son addiction transparaît dans les nouvelles de Fumées d’opium, dont plusieurs se déroulent à Istanbul. La plus impressionnante est "Le Palais rouge", qui se passe à l’ambassade de France de Tarabya ; Claude Farrère décrit la demeure comme un "admirable yali, rouge d’un ton de sang séché, et qui s’adosse contre un parc en gradins planté de tilleuls, de hêtres, de marronniers et de cèdres, les plus beaux que j’aie jamais rêvés".

Là, Farrère se souvient de l’histoire du prince Ypsilanti, qui, accusé de trahison, a été privé de ses biens ; en 1807, le palais Ypsilanti et son parc ont été offerts à la France par Selim III pour en faire la résidence d’été des ambassadeurs de France à Thérapia. Sous l’emprise de l’opium, l’écrivain imagine le "yali" métamorphosé en palais rouge, fourmillant de "blêmes fantômes pleurards" et il croit même voir le spectre sans tête du prince Ypsilanti, suivi d’un squelette de chien, en train de gravir l’escalier conduisant à la terrasse supérieure !
Il y a cependant un autre secret encore mieux caché, que Farrère ne révèle qu’à Pierre Louÿs, c’est celui de son histoire d’amour ! Sa passion pour Jeanne Lorendo, comtesse Ostrorog, qu’il surnomme "Stratonice", épouse de Léon Ostrorog, un Français d’origine polonaise, conseiller financier pour la Dette ottomane. Claude Farrère est si épris d’elle qu’il parcourt le Bosphore en caïque, de nuit, pour tenter d’apercevoir sa silhouette dans la lumière des fenêtres !

S’il a, dans sa vie publique, choisi le mutisme sur cette liaison, Claude Farrère l’a en partie révélée dans son roman L’Homme qui assassina, où le narrateur, Renaud de Sévigné, éperdument amoureux de Lady Falkland, arpente avec elle les rues du vieux Stamboul, jusqu’à ne plus pouvoir dominer ses sentiments : "Disposez de moi ! lui dit-il. Voici ma fortune, mon nom, ma force d’homme et de soldat, tout ce que je suis"… Et finit par assassiner l’encombrant mari ! Ce roman à clés causa un tel scandale, les lecteurs n’ayant pas tardé à deviner l’identité des personnages ayant inspiré l’histoire, que le comte Ostrorog aurait même envisagé, dit-on, de venir en France tuer Claude Farrère ! D’autant plus que la comtesse Ostrorog n’aurait renoncé à s’enfuir avec l’écrivain que pour épargner le scandale à ses deux fils ! Lorsqu’une lettre du Ministère de la Marine annonce à Charles Bargone que sa mission à Istanbul est terminée, c’est le désespoir : "Mon départ de là-bas a été un déchirement !" écrira-t-il.

Mais son attachement à Istanbul et à la Turquie ne se démentira jamais, il reviendra maintes fois. Après la guerre, il fait partie de ceux qui s’opposent au démembrement de l’Empire ottoman. Son voyage mémorable sera le troisième, en 1922. Il est d’abord reçu par le 36e et dernier sultan, Vahdettin, appelé Mehmet VI, qui sera destitué la même année. Mais, s’il rencontre le gouvernement officiel, le souhait de Farrère est surtout d’aller discrètement faire connaissance avec les "Turcs libres", pour rencontrer Mustafa Kemal, chef de la Guerre d’Indépendance, qui n’est pas encore devenu Atatürk, et que beaucoup de Français considèrent alors comme un vulgaire insurgé. Farrère ne se s’y trompe pas. Lorsqu’il rencontre le "Gazi" (le "Victorieux") à Izmit, le 18 juin, il comprend tout de suite que l’avenir de la Turquie est entre les mains de cet homme dont la personnalité le fascine. Mustafa Kemal le remercie d’ailleurs en louant dans son discours ce "véritable et sincère ami de la Turquie" et lui offre sa cravache de la victoire de Sakarya. Au retour, Farrère, enthousiaste, écrira La Turquie ressuscitée.

La même année, le 23 janvier 1922, le préfet de Constantinople avait inauguré, à Sultanahmet, les rues "Piyer Loti" et "Klod Farer", en témoignage de gratitude envers ces deux écrivains amis inconditionnels de la Turquie en des temps difficiles…


> Source essentielle sur Claude Farrère : Alain Quella-Villéger, Le cas Farrère, du Goncourt à la disgrâce, Presses de la Renaissance, 1989