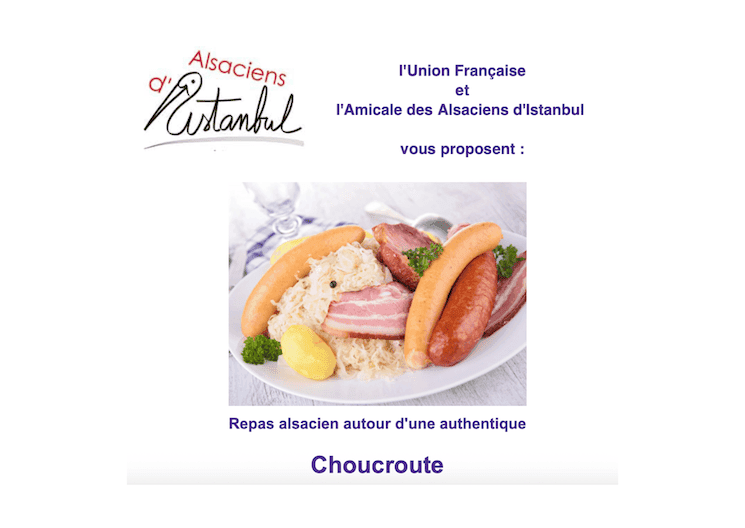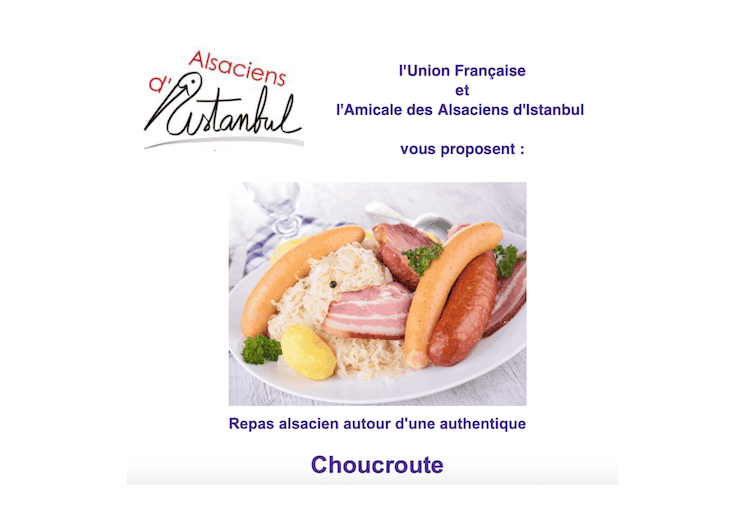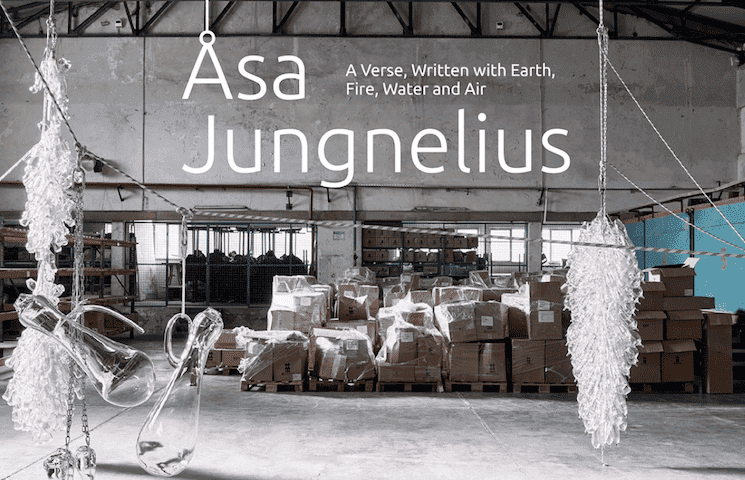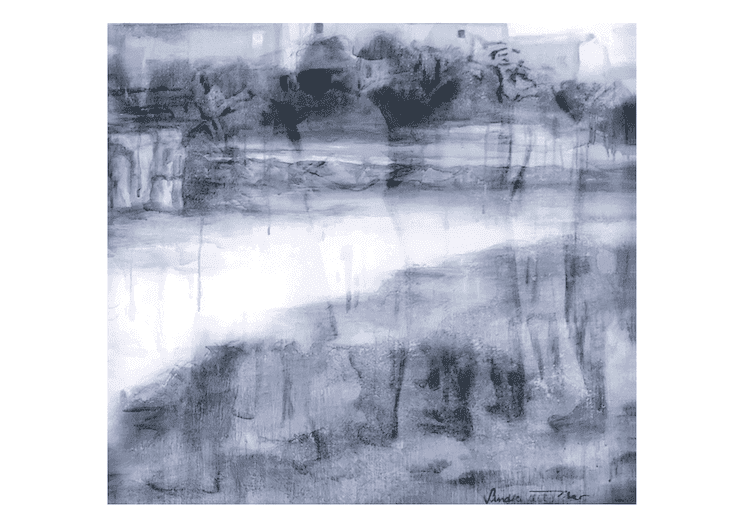C’est actuellement le sujet de discorde le plus important entre Ankara et Washington : le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé cette semaine la livraison des missiles russes S-400 en juillet. Lepetitjournal d’Istanbul revient sur cette affaire.
Si on a tendance à opposer OTAN et Russie, la Turquie n’est pas du même avis. La deuxième armée de l’Alliance atlantique va recevoir dès juillet des batteries des missiles russes S-400. Commandées en 2017, ces armes sont depuis lors un sujet de tension entre Ankara et la Maison Blanche. La Turquie a d’ailleurs exprimé le souhait de se doter plus tard de l’arme S-500.
Du point de vue de la Turquie : une décision réfléchie ?
Le projet de la Turquie de s’armer des missiles S-400 s’inscrit dans une volonté de développer son système de défense aérienne et antimissile. En 2013, Ankara a fait de ce principe une priorité, pointant du doigt sa situation de faiblesse dans une région « où tout le monde a des missiles. » Dans ce but, la Turquie avait signé en 2017 une lettre d’intention de coopération avec la France et l’Italie pour un projet de défense. Elle coopérait avant tout avec les Etats-Unis, notamment auprès des sociétés de défense Raytheon et Lockheed Martin. Le pays devait lui livrer des F-35 cette année.
Or, selon Ankara, les systèmes antimissiles de l’OTAN ne suffisent pas au pays de se défendre. « L'Otan n'est pas suffisamment capable de couvrir notre espace aérien à ce stade » avait déclaré Erdoğan en 2017. Dans ce contexte, les missiles S-400 ne pouvaient que le séduire. Considérée comme « le poids lourd » du monde de la défense antiaérienne depuis 2007, l’arme a été créé dans le but de protéger les cieux contre toute cible aérienne moderne, y compris les armes de haute technologie. Elle est recherchée pour sa précision. Contrairement à son concurrent américain, le MIM-104 Patriot, elle peut déterminer les cibles aériennes dans un rayon de 600 km et les abattre à une distance de 400 km.
Avec cet achat, la Turquie semble montrer sa volonté de s’émanciper de l’OTAN en diversifiant ses fournisseurs.
En Occident, une réaction sur la défensive
En signant un contrat avec la Russie en 2017, la Turquie s’est attiré les foudres des Etats-Unis. Rappelons que le Congrès américain avait adopté une loi imposant des sanctions aux pays et entreprises qui achetaient du matériel à la Russie. Du côté de la Maison Blanche, l’inquiétude porte surtout sur l’impact de cet achat sur leurs propres armes. Celui-ci pourrait en effet constituer une menace sur les secrets de fabrications du F-35, l’avion militaire américain destiné à échapper aux armes russes. Par crainte que les S-400 puissent donner accès aux données technologiques de leurs avions, les Américains refusent que ces derniers volent avec un système anti-missile.
De plus, Washington s’inquiète de l’assurance que prend la Russie dans la région. La puissance du missile S-400 n’étant plus un secret pour personne, la Turquie est loin d’être la première à s’y intéresser. Moscou en a notamment implanté en Pologne, en Crimée, en Algérie, mais aussi en Syrie, en Inde, en Arabie Saoudite et en Chine. Un succès diplomatique qui ne manque pas d’exaspérer le Pentagone.
Enfin, selon les Etats-Unis, le système russe serait incompatible avec les équipements de l’OTAN et Washington ne manque pas de fustiger le détournement turc de ses alliés atlantiques. Cependant, à l’instar d’Erdoğan qui a affirmé que la Turquie était libre de prendre des décisions seule, l’OTAN a affirmé à plusieurs reprises que l’accord russo-turc était une « décision nationale » dans laquelle elle n’avait pas à intervenir. La Turquie ne serait d’ailleurs pas seule dissidente, la Grèce utilisant elle aussi des systèmes de défense antiaériens malgré son statut d’alliée de l’OTAN.
Ankara dans l’impasse ?
La position de la Turquie est loin d’être facile. Quel que soit le scénario choisi, le pays doit s’attendre à s’exposer à des conséquences.
Sa détermination à se fournir à Moscou pourrait ainsi entraîner des sanctions économiques et politiques de la part du Pentagone. Si Erdoğan avait affirmé vouloir continuer à négocier avec les occidentaux, notamment au sujet de l’achat du missile américain Patriot et des chasseurs F-35, Donald Trump ne l’entend pas de cette oreille. Considérant que la Turquie a franchi la ligne rouge en choisissant de traiter avec « l’ennemi » de l’OTAN, Washington a suspendu la livraison des pièces du F-35. Charles Summers, porte-parole du Pentagone, avait déclaré en 2017 que la Turquie risquait de « graves conséquences » si elle persistait à s’orienter vers le Kremlin. Le 7 juin dernier, il a été décidé que la Turquie avait jusqu’au 31 juillet pour renoncer à son achat en Russie. Dans le cas contraire, les contrats de sous-traitance attribués à des entreprises turques pour la fabrication du F-35 seront rendus caducs.
La situation déjà tendue entre Ankara et Washington, attisée par le soutien américain aux milices kurdes syriennes, pourrait ainsi se corser. Spécialiste de la Turquie à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Didier Billion nuance cette situation. Pointant notamment du doigt l’importance du dollar en Turquie et la coopération nécessaire pour le contrôle du nord de la Syrie, il compare ces différends à « la relation d’un vieux couple qui se dispute fréquemment, mais ne veut pas divorcer. »
Le dilemme Idlib
Cependant, tourner le dos à Moscou ne semble pas être la solution optimale pour la Turquie. Le Kremlin reste en effet le principal partenaire d’Ankara dans le conflit syrien. Une rupture de contrat pourrait réduire à néant les pourparlers actuels sur la province d’Idlib où la Turquie souhaite le maintien d’une zone démilitarisée sous son propre contrôle. Un retrait de la part du d’Ankara pourrait ainsi remettre en question la stabilité des alliés en Syrie.
Préserver Idlib ou garder les F-35 ? Assurer sa sécurité ou préserver une relation stable avec Washington ? La Turquie semble tiraillée entre les deux puissances. Prise entre l’enclume et le marteau, sa décision risque de lui en coûter, quelle qu’elle soit.