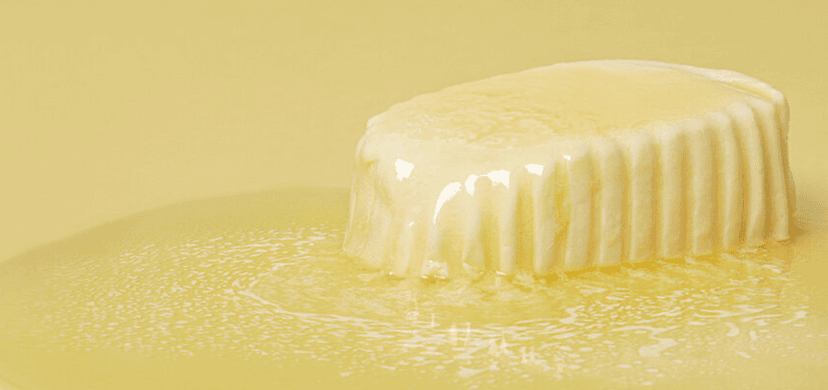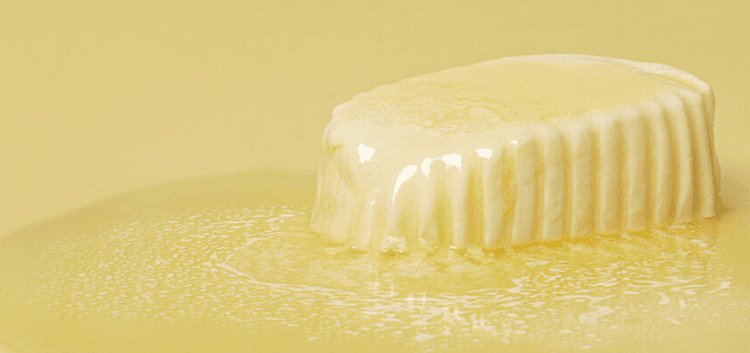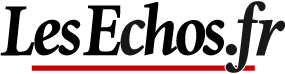
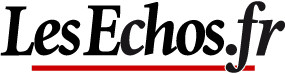
Cette rubrique est présentée avec notre partenaire
Les premiers pas... de la présidence Obama, la crise et la relance de l'économie, la fin du PC, l'avenir de l'informatique : Sam Palmisano se confie. Avare d'interview, cet "IBMer "dirige un empire de près de 400.000 employés et présent dans 170 pays. A la tête d'IBM depuis six ans, il a poursuivi la stratégie de transformation initiée par Louis Gerstner au début des années 1990 pour faire de "Big Blue "un géant des services qui ne tire plus, aujourd'hui, qu'un cinquième de son activité de la vente de matériel informatique
Les Echos : Vous avez dit que Barack Obama devrait être le meilleur "salesman "du monde. Est-il à la hauteur ?
Sam Palmisano : Ce que j'ai voulu dire c'est que, vu l'énormité des problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin d'un leadership très fort pour convaincre le peuple américain que des changements profonds sont nécessaires. Le président Obama le fait avec beaucoup d'énergie et de talent. L'économie américaine va se redresser car elle a toujours eu de très fortes capacités de rebond. Avec ou sans l'aide de l'Etat, il ne fait pas de doute qu'elle va repartir. Il y a d'ailleurs quelques signes encourageants d'amélioration, nous le constatons en ce moment, mais franchement, nous ne passons pas beaucoup de temps chez IBM à nous interroger sur l'état de l'économie en général. Je dis cela parce que ce que nous faisons crée de la valeur même dans une économie qui décline. Nos clients les gouvernements, les entreprises veulent toujours améliorer leur productivité a fortiori dans les périodes de récession.
Que pensez-vous du plan de relance américain ?
Nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe de transition (NDLR : avant la prise de fonction du nouveau président des Etats-Unis), à leur demande, pour leur proposer des idées en matière de relance. Parmi ces mesures, certaines visent à doper l'activité économique à court terme, mais d'autres ont pour but la création d'activités et d'emplois à plus long terme. La nouvelle administration voulait un équilibre. Nous avons travaillé sur le volet long terme en étudiant trois domaines : la santé, le haut-débit et les réseaux (électricité, eau, etc.). L'objectif de la Maison-Blanche était de créer environ 1 million d'emplois dans ces trois domaines. Nous avons étudié la question et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était possible de créer 1,5 million d'emplois pour un investissement de seulement 30 milliards de dollars. A comparer à un plan de relance, je le rappelle, de plus de 800 milliards de dollars.
Où en sont ces projets de relance ?
L'argent arrive. Quatorze Etats travaillent dans ces domaines, les deux plus gros étant la Californie et New York. Des projets avancent notamment dans le domaine de la santé : le but est de connecter tous les acteurs du système les payeurs, qui sont les Etats et les entreprises, les patients, dont il faut informatiser les dossiers, les médecins, les établissements de soins, les compagnies d'assurances, etc. , ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent.
Nous avançons également dans le domaine des réseaux électriques qui n'ont pas beaucoup changé dans leur conception depuis Thomas Edison. Le but est, à l'image de ce qui a été fait dans les télécommunications, de passer de l'analogique au numérique pour mieux équilibrer l'offre et la demande, donner plus d'informations aux clients et permettre à de nouvelles sources d'énergie de se développer en se branchant sur le réseau.
L'économie est-elle devenue trop "court-termiste "?
Quand la conjoncture se dégrade, le plus tentant pour un chef d'entreprise est d'arrêter d'investir. Nous faisons le contraire. Mais regardez nos concurrents : ils réduisent les salaires, ils arrêtent de verser des bonus. Nous continuons à investir 6 milliards de dollars par an dans la R&D car nous visons le long terme. On pourrait dire la même chose des hommes politiques : il est plus facile de gérer le court terme, de fermer les frontières, de devenir protectionniste... Tout le monde doit admettre que nous avons accepté un système comportant trop de risques. Que les effets de levier ont été poussés trop loin. Qu'on a trop privilégié le court terme au détriment de l'avenir. Nous, nous avons toujours refusé cela. On ne donne pas d'indications sur nos performances trimestrielles à venir ("guidance "). On ne gère pas une entreprise comme IBM à quatre-vingt-dix jours.
Qu'aura appris le monde de la finance dans cette crise ?
Le monde de la finance est devenu numérique et interconnecté, mais les outils de contrôle ne l'étaient pas assez. Aujourd'hui, plus que d'une meilleure régulation, c'est d'ailleurs peut-être avant tout de meilleurs outils de mesure dont nous avons besoin. Alan Greenspan l'a dit : "Je ne croyais pas que la finance puisse s'infliger ça. "Mais les financiers avaient-ils l'information ? La technologie peut aujourd'hui apporter des réponses à des coûts abordables. Le monde financier est demandeur. Nous l'avons vu car, bien qu'en crise, il n'a pas réduit ses investissements technologiques en 2008 et seulement très faiblement depuis début 2009.
Quant aux Etats et aux banques centrales, ils nous demandent aussi de travailler pour eux. IBM travaille ainsi avec la Réserve fédérale, qui cherche à modéliser le contrôle du risque systémique comme on a utilisé après le 11 septembre l'outil informatique pour lutter contre le terrorisme. Nous nous sommes donné six mois pour apporter des solutions.
Vous parlez de la fin de l'ère du PC. Que voyez-vous après ?
Après l'explosion de la bulle Internet en 2000, nous nous sommes dit que, même une fois la crise passée, l'industrie informatique allait changer d'époque. Nous avions anticipé la fin de la domination de la micro-informatique et la banalisation du PC. Ce métier de volume dans lequel il n'y a plus guère de différenciation possible par l'innovation n'est pas pour nous.
Nous nous sommes donc réinventés pour faire face à la fin de l'ère du PC. On a ainsi vendu toutes nos activités liées à la micro-informatique depuis 2002. Les ordinateurs comme les composants. Et en parallèle nous avons dépensé 20 milliards de dollars dans une centaine d'acquisitions, qui nous ont aidées à dessiner le nouveau visage d'IBM.
Une compagnie qui, sur le plan financier, a rendu 86 milliards de dollars sous forme de cash ou de rachat d'actions à ses actionnaires. Une entreprise qui réalise désormais 43 % de ses profits dans les logiciels, contre plus de 30 % au début du siècle, et dont les ventes de matériel ne génèrent plus que 9 % des bénéfices, contre encore environ 20 % en 2000-2002. L'IBM d'hier vendait avant tout des machines. Aujourd'hui, nous apportons des solutions via des hommes. C'est une révolution culturelle.
Ne faut-il pas pousser la logique plus loin et donc vous désengager des serveurs ?
Etre moins dépendant des ventes de matériel est un plus, c'est vrai. Mais, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de tirer 91 % de nos profits des logiciels et services. L'activité "serveurs ", qui comporte de nombreux segments, reste un marché d'infrastructure en croissance potentiellement profitable. Certes, le segment des machines banalisées à moins de 50.000 dollars, équipées de puces Intel, souffre. Mais, au-dessus, les segments Unix, qui sont des ordinateurs de haute performance basés sur la technologie Power d'IBM, marchent bien. Cette technologie est d'ailleurs adoptée par des marchés en croissance tels que les télécommunications, les sociétés d'énergie ou l'univers de la santé. L'investissement en R&D pendant des années est maintenant en train de payer avec cette technologie qui est meilleure que les serveurs construits sur des éléments banalisés.
Vos concurrents bougent aussi. Le rachat de Sun par Oracle ne vous oblige-t-il pas ainsi à bouger à votre tour ?
A première vue, cette opération change-t-elle véritablement quelque chose pour nous ? Scott McNealy et Larry Ellison se connaissent et travaillent ensemble depuis vingt ans. Là, ils ont décidé de transformer leur union commerciale en mariage financier. C'est tout.
La vraie question à terme est plutôt : Oracle va-t-il rester un acteur dans l'équipement informatique ? Ce métier industriel n'est pas celui du logiciel. Là, il faut une R&D spécifique, un savoir-faire dans la fabrication, un service après-vente, des techniciens, des stocks, des semi-conducteurs... C'est un tout autre monde avec ses règles, ses cycles et ses coûts. Oracle a prouvé qu'il savait gérer des acquisitions dans le logiciel, là, il va devoir prouver qu'il peut tailler dans les coûts dans un univers du matériel. C'est plus dur. Comment atteindre le 1,5 milliard de dollars d'économies qu'ils recherchent sur la première année ? Pour cela, il faudrait qu'ils réduisent les effectifs de Sun de 40 à 50 % et qu'ils augmentent les prix de 20-25 %. C'est peut-être faisable, mais s'ils ne peuvent réduire le nombre de commerciaux ou de personnel de support, c'est dans la R&D et donc la préparation de l'avenir qu'ils devront couper.
Dans un monde en crise, certains coupent leurs budgets publicitaires. Est-ce votre cas ?
Au contraire. Cette année, nous l'avons augmenté à trois reprises. D'abord parce que les autres dépensent moins et que, du coup, il est plus facile de se faire entendre. Et ensuite parce que cela fonctionne. Nous avons réussi à faire évoluer très positivement et de façon significative l'image d'IBM l'entreprise qui résout des problèmes et des "IBMers " des gens intelligents pour un monde plus complexe à la recherche de solutions.
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BARRÉ, DAVID BARROUX ET HENRI GIBIER. De notre partenaire www.LesEchos.fr (www.lepetitjournal.com) lundi 8 juin 2009