Alors que la France s’apprête à encadrer l’ultra fast fashion via une proposition de loi inédite, les plateformes comme Shein ou Temu se mobilisent pour défendre leur modèle. Entre bataille parlementaire et guerre médiatique, la mode bon marché est devenue un sujet hautement politique.
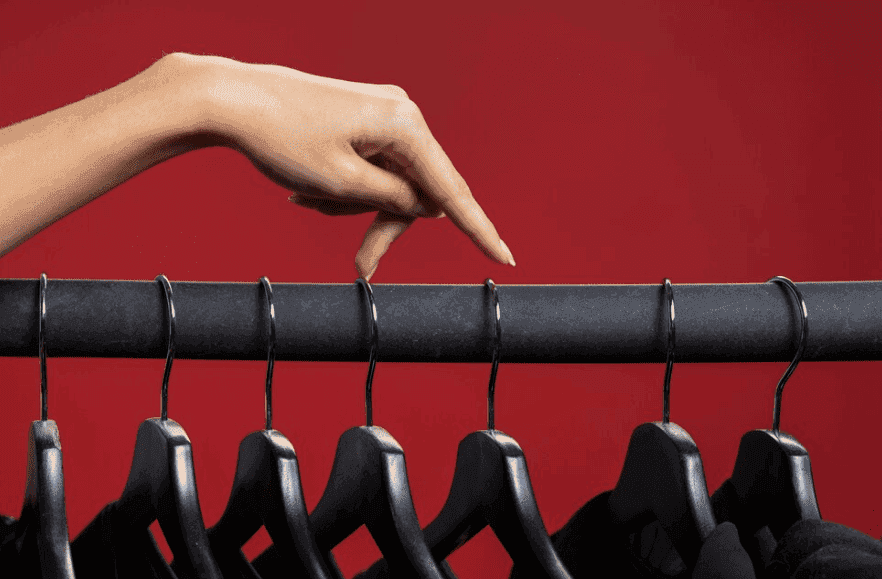

Une loi française qui inquiète les Chinois
Adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2024, la proposition de loi « anti-fast fashion » revient au Sénat pour examen le 2 juin prochain, avec un vote solennel prévu le 10 juin. Entre-temps, la version du texte a été profondément modifiée en commission, suscitant la colère de ses initiateurs. Sa rapporteure à l’Assemblée, Anne-Cécile Violland, dénonce une loi « totalement détricotée » : la définition de la fast fashion a été revue, l’interdiction de la publicité restreinte aux influenceurs, et le mécanisme de malus écologique affaibli.
Les plateformes asiatiques, notamment Shein et Temu, sont particulièrement concernées : leurs produits représenteraient déjà 22 % des colis traités par La Poste en France. À l’échelle européenne, près de 4,6 milliards de colis à faible valeur — à 91 % en provenance de Chine — ont été livrés en 2024. En réponse, Bruxelles envisage de supprimer l’exonération douanière pour les colis de moins de 150 euros, mais pas avant 2028. En attendant, la loi française pourrait faire figure de pionnière… si elle parvient à conserver son ambition initiale.
Shein déroule sa contre-offensive
Dans ce contexte législatif tendu, Shein a lancé une vaste offensive de communication. Entretiens dans la presse française, rendez-vous institutionnels à Paris, campagne publicitaire agressive : le géant chinois tente de faire entendre une autre version de son modèle. Son PDG Donald Tang a affirmé à plusieurs reprises que Shein ne relevait pas de la fast fashion, en raison de son modèle de production « à la demande », qu’il qualifie de durable. En parallèle, du 28 avril au 4 mai 2025, une campagne choc orchestrée par l’agence Havas a occupé l’espace public, martelant des slogans comme « La mode est un droit, pas un privilège ».
Un site dédié, pour-une-mode-accessible.fr, a été lancé pour valoriser les engagements supposés de la marque en matière de responsabilité sociale, de sécurité textile et d’inclusivité. Une étude commandée par Shein à l’Ifop souligne que 60 % des Français renoncent à acheter des vêtements pour des raisons économiques, un chiffre utilisé pour légitimer son positionnement. Pour Shein, limiter la fast fashion revient à restreindre l’accès des classes populaires à la consommation vestimentaire, une posture qui cherche à déplacer le débat du terrain écologique vers celui du pouvoir d’achat.
Entre accessibilité et durabilité, un débat de société
La stratégie de Shein touche une corde sensible : en 2024, 35 % des Français ont commandé au moins un article sur la plateforme, qui devance désormais des enseignes historiques comme Zara ou H&M en volume de ventes. La marque s’impose ainsi comme un acteur central du paysage textile français, malgré les controverses sur ses pratiques. Le directeur de l’IFM note que cette croissance reflète une consommation de plus en plus « décomplexée » de produits fabriqués en Chine.
Pour les parlementaires à l’origine de la loi, ce succès populaire ne doit pas masquer les enjeux écologiques, sociaux et économiques sous-jacents. La députée Anne-Cécile Violland rappelle que « encadrer, c’est aussi prévenir le consommateur qu’en achetant sur Shein, il pollue et affaiblit notre économie ». Alors que les géants asiatiques s’opposent à toute restriction, la question se pose : comment concilier accessibilité de la mode et durabilité du modèle textile ? La réponse ne pourra sans doute venir que d’une coordination à l’échelle européenne.
Sur le même sujet













