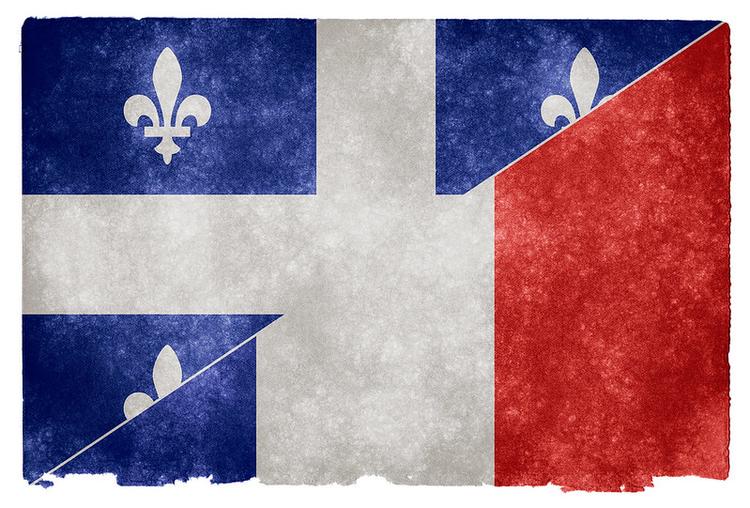Au croisement du sacré et du politique, entre la tradition bouddhiste cambodgienne et le requiem occidental, Bangsokol bouleverse. Cette œuvre poignante, dirigée par le chef d’orchestre Andrew Cyr et produite par Phloeun Prim, allie les musiques d’Him Sophy, les images de Rithy Panh et les textes sacrés compilés par Trent Walker. Un spectacle bouleversant, présenté en présence d’un public ému, de la ministre cambodgienne de la Culture et de l’ambassadeur du Cambodge à l’UNESCO.


Montréal, terre d’accueil, scène de mémoire
La salle du Théâtre Maisonneuve, pleine à craquer, baignait dans une lumière tamisée. Des familles entières, souvent marquées par l’exil, s’étaient déplacées. Beaucoup portaient des écharpes blanches, en signe de deuil et de respect. C’est à Montréal — ville d’enfance de Phloeun Prim, producteur du spectacle et directeur de Cambodian Living Arts — qu’a été rendue cette offrande artistique et spirituelle. Et ce n’est pas un hasard.
« Je voulais que Montréal accueille Bangsokol. J’y ai grandi, mes parents s’y sont installés après avoir fui la guerre, et aujourd’hui mes enfants, nés au Cambodge, y étudient. C’est ici que ma boucle personnelle se referme », nous a confié Phloeun lors de l’entretien qu’il nous a accordé quelques heures avant la représentation.

Un requiem à la croisée des traditions
Bangsokol, c’est l’histoire d’un deuil transfiguré par l’art. À l’origine, un questionnement : comment créer un requiem pour le Cambodge ? Comment adapter cette forme musicale chrétienne — née en Occident pour accompagner les morts — à une culture profondément bouddhiste et marquée par l’oralité rituelle ?
La réponse est venue d’un dialogue entre trois créateurs d’exception : Him Sophy, compositeur cambodgien formé à Moscou ; Rithy Panh, cinéaste mondialement reconnu pour ses œuvres sur la mémoire du génocide ; et Trent Walker, spécialiste du pali, moine et chercheur, qui a sélectionné les textes rituels bouddhistes formant le livret.



Contrairement à l’usage, les images ont été créées après la musique. Rithy Panh, habitué à concevoir d’abord les images de ses films avant d’y ajouter la bande-son, a dû ici s’adapter à l’inverse. Il a composé une fresque visuelle à partir de la partition musicale, un geste rare qui donne à la scénographie une profondeur presque méditative. Sur trois écrans géants, des images de paysages, de foules silencieuses, de couchers de soleil ou d’ombres furtives font écho à l’invisible — ce qui ne se dit pas, ce qui se tait depuis trop longtemps.

Andrew Cyr, un chef au service de l’équilibre
À la tête de cette œuvre multiforme, le chef d’orchestre américain Andrew Cyr, connu pour son écoute fine et son humilité artistique, a joué un rôle central. Face à lui, un double monde : l’orchestre de chambre, au langage classique et rigoureux, et les instrumentistes cambodgiens, assis à même le sol, dans la tradition du pinpeat, avec gongs, flûtes, percussions et cithares.
Le pinpeat est un ensemble musical traditionnel cambodgien, composé de gongs, tambours, flûtes et xylophones. Utilisé lors des cérémonies religieuses, royales ou théâtrales, il accompagne les danses sacrées et les rituels bouddhistes depuis des siècles. Dans Bangsokol, il apporte une résonance spirituelle profonde à la partition contemporaine.
Sous ses gestes sobres mais assurés, ces univers se sont liés sans se heurter. Il ne s’agissait pas de juxtaposition mais de véritable cohabitation. À travers sa direction, la fusion musicale est devenue fusion spirituelle : les lamentations baroques rejoignaient les invocations bouddhistes, et les timbres khmers répondaient aux dissonances contemporaines.
Une mémoire incarnée, des retrouvailles inespérées
Dans le silence de la salle, un murmure est né. Celui des souvenirs qui remontent, des douleurs partagées, des absents que l’on retrouve par la pensée. Mais aussi, parfois, littéralement.
Dans le foyer du théâtre, deux femmes se sont reconnues après plus de cinquante ans de séparation. Enfants, elles jouaient ensemble à Paris. Leurs familles ont été déchirées par la guerre. Et c’est Bangsokol qui les a réunies. Par le plus grand des hasards, elles étaient assises l’une derrière l’autre. Une histoire parmi d’autres, mais qui résume toute la portée du spectacle : faire de l’émotion un lieu de rencontre.
Une scène transformée en autel
Le décor, lui aussi, parlait. Côté jardin, une statue de Bouddha trônait parmi des offrandes, des fleurs, des instruments sacrés. Pour le tableau final, surplombant l’orchestre, cinq hautes tours de soie chamarrée — semblables à celles érigées lors des cérémonies funéraires au Cambodge — captaient les jeux de lumière et encadraient la scène comme une cathédrale païenne. Tout ici évoquait le passage, le rituel, la prière.
Et lorsque les premières notes ont surgi, ce n’est pas une musique que le public a reçu, mais un souffle. Un souffle porté par la voix des chanteurs, par la pulsation des percussions, par les images d’enfants disparus, de champs abandonnés, de visages effacés.
Une première marquée par le sceau royal
Depuis sa création en 2017, Bangsokol a été présenté à Melbourne, à New York, à Boston, à Paris. Mais c’est à Phnom Penh, en 2019, qu’il a connu son moment le plus symbolique : Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni y assistait en personne, et qualifia l’œuvre de « chef-d’œuvre ». L’organisation Cambodian Living Arts, qui porte le projet, bénéficie du haut patronage royal, reconnaissance rare qui souligne l’importance culturelle et mémorielle de sa mission.

Une soirée rendue possible par un engagement collectif
À Montréal, cette première canadienne a pu voir le jour grâce à l’implication déterminante de la Place des Arts, qui a soutenu le projet dès le début, et de l’association Connexion Champa, qui a mobilisé artistes, partenaires et communautés autour de cet événement exceptionnel. Leur travail a permis de transformer un rêve en réalité : celui d’une salle de 1400 places, remplie, debout, unie dans un même recueillement.

Phloeun Prim ne cache pas son émotion : « Ce soir, nous faisons partie de l’histoire de cette salle. Ce théâtre a vu passer les plus grands artistes du monde, et ce soir, c’est notre histoire que nous racontons ici. »

Le geste artistique comme réponse politique
« J’ai été déçu de voir certaines institutions canadiennes refuser de soutenir ce projet. Comme si le mot “génocide” faisait encore peur, » nous a confié Phloeun Prim. « Et pourtant, c’est au Canada, terre d’accueil, que ce travail de mémoire doit être possible. »
Avec Bangsokol, il ne s’agit pas seulement de se souvenir. Il s’agit de faire lien. L’œuvre a déjà été jouée à New York, Paris, Boston, Melbourne, Phnom Penh… Mais Montréal avait une résonance particulière. C’est ici qu’est née une part de l’engagement de Phloeun. C’est ici que ses enfants ont décidé d’étudier. C’est ici que l’histoire se boucle, et se prolonge.

Une œuvre rare, un acte de paix
Dans un monde saturé de bruits et d’images, Bangsokol fait le pari du recueillement. Il n’explique pas. Il n’accuse pas. Il convoque. Il laisse parler les silences, les gestes, les regards.
C’est une œuvre qui transcende les mots, qui ne cherche ni la pitié ni l’oubli, mais la transmission. À travers les voix qui chantent, les mains qui jouent, les enfants qui regardent, Bangsokol fait renaître non pas les morts, mais le lien entre les vivants.
Quand l’art ouvre la voie du souvenir
Et si l’art n’était pas là pour consoler, mais pour réveiller ? Pour ouvrir un espace où les douleurs enfouies peuvent enfin se dire, se partager, se transformer en beauté ? Bangsokol est ce lieu rare où les peuples blessés peuvent poser leurs linceuls et reprendre souffle. Montréal s’en souviendra. Mais qui, demain, portera cette lumière plus loin encore ?
Sur le même sujet