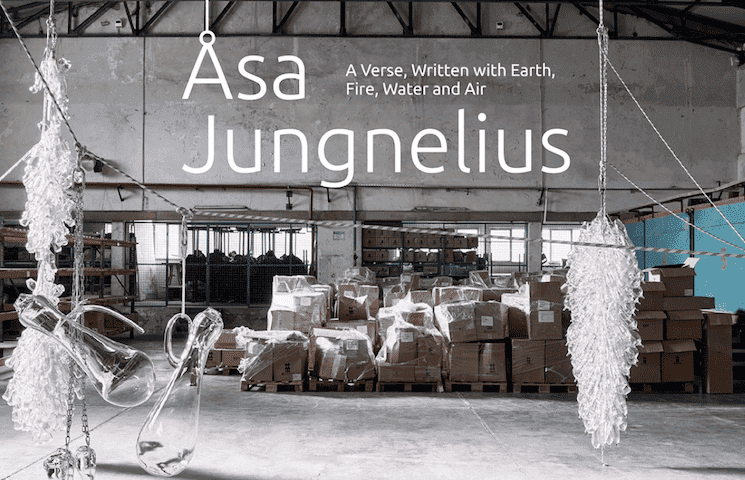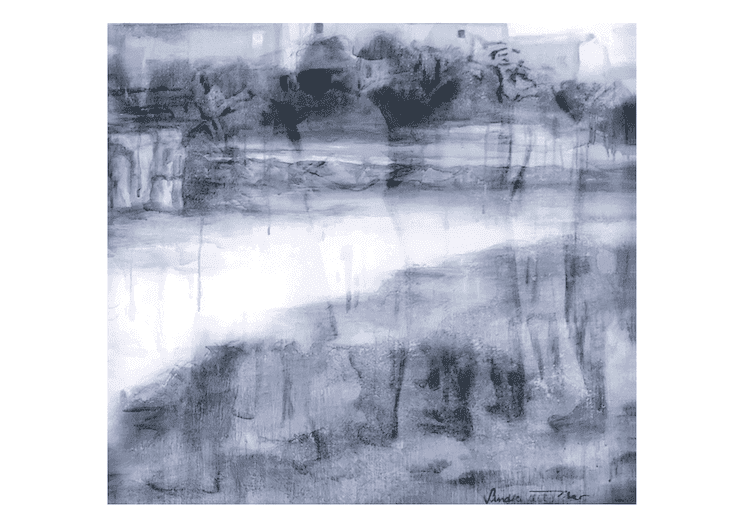Après Genève le mois dernier, les discussions sur le programme nucléaire iranien reprennent ce vendredi à Istanbul. La Turquie n’appartient pas aux "5+1", groupe de pays chargés des négociations. Mais elle se pose depuis quelques mois en acteur incontournable du dossier

Istanbul, lieu de rencontre, est un choix iranien. En décembre dernier, pour la reprise du dialogue après quatorze mois d’arrêt, Téhéran avait déjà demandé la Turquie. Les grandes puissances avaient proposé Vienne, siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La rencontre a finalement eu lieu à Genève et se poursuit donc, cette semaine, à Istanbul.
Officiellement, la Turquie n’est que le pays hôte. Mais ces deux jours lui offrent l’occasion d’éprouver – et de prouver – son influence diplomatique.
Le "dossier nucléaire" iranien
L’Iran fait valoir son droit à un programme nucléaire civil et nie chercher à fabriquer une arme atomique. Les grandes puissances n’y croient pas et veulent conclure avec Téhéran un échange de combustible. Autrement dit (et simplifié) : l’Iran fournirait dans un lieu déterminé son stock d’uranium faiblement enrichi aux 5+1, que ces derniers (notamment la Russie et la France) se chargeraient d’enrichir et de livrer au réacteur de recherche de Téhéran, qui opère sous surveillance de l’AIEA.
Les négociations achoppent sur la quantité d’uranium faiblement enrichi que Téhéran veut bien échanger et sur le lieu de l’échange. Entre octobre 2009 et décembre 2010, elles sont restées bloquées. C’est dans cet intervalle que la Turquie a déployé sa diplomatie sur le dossier.
La Turquie, alliée de l’Ouest et de l’Iran

L’initiative serait venue de Mohamed El Baradei, l’ancien directeur de l’AIEA. Pour sortir de l’impasse, il aurait suggéré la Turquie comme lieu d’échange de l’uranium. La Turquie, membre de l’OTAN depuis 60 ans, candidate à l’Union européenne, fermement ancrée à l’Ouest. Mais aussi la Turquie, voisine de la République islamique, avec laquelle elle entretient de bonnes relations et qui lui fournit près du tiers de ses besoins en gaz naturel.
Le pouvoir à Téhéran considère la Turquie comme un allié, il s’y sent en "terrain ami". Les dirigeants turcs, eux, ont soif de stabilité dans la région et d’échanges commerciaux avec leurs voisins. Ils pensent que les menaces et sanctions, non seulement ne servent à rien (sauf à braquer un peu plus l’Iran), mais nuisent de surcroît à leurs intérêts économiques. Sans parler des conséquences désastreuses d’une nouvelle guerre à leurs frontières…
La Turquie affirme sa politique étrangère
Depuis son entrée en scène, la Turquie joue donc la carte "diplomatie d’abord", qui l’a conduite :
• En mai 2010, à concocter avec le Brésil et l’Iran un accord d’échange d’uranium en Turquie, immédiatement refusé par les Etats-Unis
• En juin 2010, à voter "non" à de nouvelles sanctions des Nations Unies contre l’Iran (bien qu’elle accepte de les appliquer)
• Dans la foulée, à refuser d’appliquer d’autres sanctions imposées unilatéralement par les Etats-Unis et l'Union européenne
• En novembre 2010, à conditionner sa participation au bouclier antimissile de l’OTAN au fait qu’aucun pays ne soit nommément désigné comme "menace". Il était bien sûr question de l’Iran.
• A rappeler, dès que l’occasion se présente, son souhait d’une région sans armes nucléaires, règle qui s’applique autant aux candidats supposés à l’obtention d’une bombe (Iran) qu’à ceux qui en possèdent déjà (Israël).
Quoiqu’il advienne du dossier nucléaire iranien dans les prochains jours et les prochains mois, il a fourni à la Turquie l’occasion d’afficher une politique étrangère de plus en plus indépendante, sûre d’elle-même, engagée sur des dossiers régionaux mais aussi internationaux.
Anne Andlauer (www.lepetitjournal.com Istanbul) mardi 18 janvier 2010