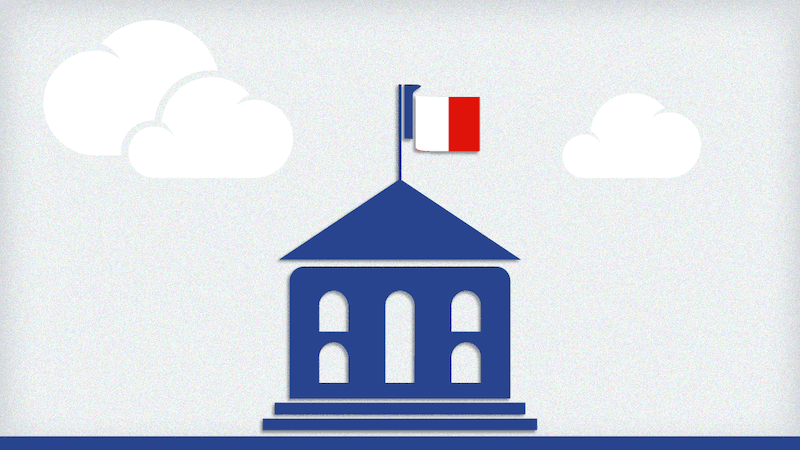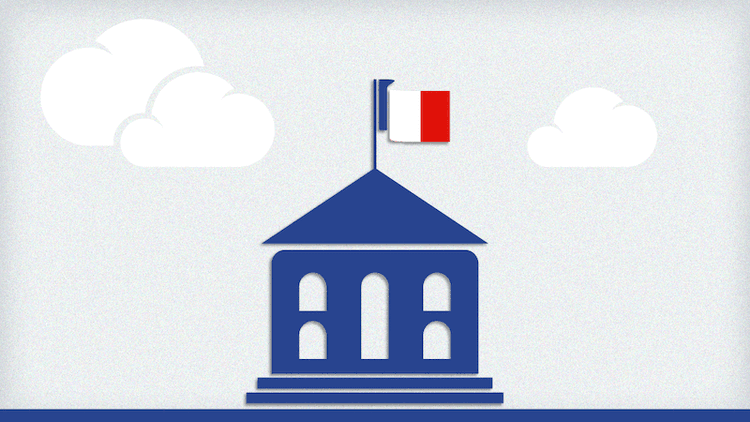Depuis le 8 mars dernier, l’Institut français de Valence propose l’exposition « Filles d’Atlas » de Béatrice K-Sim. Cette professeure de Lettres qui a fait de la photographie bien plus qu’une passion, dévoile des portraits de femmes africaines qu’elle a rencontrées au gré de ses nombreux voyages mais également de son vécu sur ce continent pendant plusieurs années. Installée à Valencia avec son mari depuis quatre ans, elle nous raconte la genèse de cette exposition qui véhicule un message fort.
Lepetitjournal.com/Valence : Béatrice, pouvez-vous nous en dire plus sur vous, quel sont vos origines, votre parcours ?
Béatrice K-Sim : Je suis née en région parisienne. Mes deux parents n’en étant pas originaires, le problème des racines s’est posé depuis toujours. Ma mère était du Midi, et je me souviens qu’enfant, lorsque nous allions en vacances là-bas, on me disait « Parigot, tête de veau ! » Pourtant, je n’habitais pas Paris même, mais en région parisienne. Quand plus grande je suis allée à Paris, là les parisiens me disaient que je n’étais qu’une banlieusarde ! Ce qui fait que je ne me sens pas vraiment enracinée quelque part. Je me sens plus comme un oiseau sur la branche prêt à s’envoler dès que le vent souffle dans un sens ou dans l’autre. Je crois que je peux m’adapter partout, je suis un peu caméléon. Finalement je ne me sens vraiment française qu’à l’étranger. C’est là où l’on se rend compte que sur certaines choses, on a des comportements, des réactions, des valeurs différentes.
Je ne me sens vraiment française qu’à l’étranger.
Quelle fût votre première découverte, le premier pays que vous avez visité ?
Difficile à dire. Ce ne sont pas tellement les pays car pour moi tout est matière à découverte. Au bout de ma rue, il y avait une forêt, donc j’ai passé mon enfance à faire des cabanes dans les arbres et à traverser la rivière pour voir de l’autre côté. Après quand, j’ai eu plus de moyens, à l’adolescence on va dire, j’ai commencé à voyager un peu, par le biais d’abord d’échanges ou de séjours linguistiques en Allemagne ou en Angleterre. Mais dès que je le pouvais, je prenais mon vélo avec deux ou trois copines pour se balader, regarder le monde autour de soi et s’émerveiller de tout.
Est-ce à ce moment que vous avez commencé la photographie ?
Oui et non. Mon père était photographe amateur. Il avait un laboratoire à la maison. Donc j’ai grandi en voyant toujours mon père avec, soit un appareil photo, soit une caméra. Quand j'ai eu 9 ou 10 ans, on m'a offert un stage d'été, un truc plus ou moins culturel avec plusieurs activités dont la photo. Là, pour la première fois en dehors de ma famille, j'ai découvert le labo photo. Les produits, la magie du révélateur, des papiers où l’on a le nez plongé à voir ce qui va sortir ... Et puis quand je suis rentrée chez moi, j’ai montré à mon père ce que j'avais fait et la porte du labo paternel s’est ouverte. J'ai passé mon adolescence dans le labo avec lui le dimanche à tirer mes photos. Quand je revenais de colonies de vacances, je tirais mes photos avec lui. Je trouve que la photo, surtout à l’époque où c’était en noir et blanc, sublime la nature.
Le noir et blanc, pour moi, parle beaucoup plus que la couleur. Je trouve que cela révèle autre chose de la réalité, ce qui m’intéresse.
Vous avez vécu douze ans en Afrique mais aussi ailleurs. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ?
L'Afrique pour moi, quand j'étais petite, c’était la série Daktari. J'avais sept ou huit ans et j'étais fan de cette série. Je me suis dit qu’un jour j'irai voir ce qu’est l'Afrique. Après il y a eu des lectures comme Le Lion de Joseph Kessel et plus tard Amadou Hampâté Bâ, enfin les grands écrivains africains. J’y suis rentrée par la petite porte, une première fois en Tunisie, puis au Maroc. Ce qui n’était pas trop loin et pas trop cher car je n’avais pas beaucoup de moyens … Petit à petit j’ai travaillé, j’ai mis des sous de côté et j'ai pu aller un peu plus loin. L'Afrique noire, le Congo, le Gabon, le Mali ont été un enchantement. Mais je n'ai pas vécu qu'en Afrique puisqu’avant de partir là-bas, j’ai passé trois ans à Budapest, en Hongrie. C’était le hasard, j’étais professeur et j’ai eu l'occasion de partir à l'étranger sur un poste de résidente.

Revenons à l’exposition qui a lieu en ce moment à l’Institut français de Valence, « Filles d’Atlas », et qui est une série de portraits de femmes africaines. Comment avez-vous commencé à les photographier ?
J'ai toujours adoré faire des portraits pour essayer de révéler la richesse intérieure des gens et ne pas se contenter de les regarder comme ça, de l'extérieur. Ce qui est important pour moi c'est de passer un peu de temps avec les gens. Ce n’est pas toujours possible en Afrique. C'est très compliqué mais cela n’a rien à voir avec le mythe du “on me vole mon image”. C'est plutôt que maintenant, ils savent qu’à l'étranger, les gens peuvent exploiter les photos, pas toujours à bon escient. Ils veulent donc contrôler leur image et c'est normal.
Comme c’était compliqué de prendre les gens en photo, je suis passée par le dessin à un moment. Je crayonnais pour créer un contact. Ce que j'essaye de faire également quand j'ai le temps, c'est laisser l'appareil dans le sac et commencer à échanger avec les gens, boire un verre, discuter, partager leur vie … Quand une femme est avec un enfant, j’essaye de l’aider, d’échanger quelque chose et après seulement, je pose la question de l'appareil photo : « est-ce que tu acceptes ? » Il arrive qu’elles refusent et là je n’insiste pas. Mais souvent elles acceptent.
Je pense que le fait d'être une femme créé un rapport différent. Si un homme vient, c’est forcément plus difficile. S’il s’assoit à côté d’une femme en train de cuisiner, elle va se demander ce qu’il fait. Entre femmes, cela passe mieux ainsi qu’avec les enfants, c’est plus naturel. Du coup, c’est vraiment très rare qu’elles refusent d’être photographiées.
J’essaie de leur expliquer ce que je fais aussi. Une fois, j'étais en République démocratique du Congo et il y avait des casseuses de cailloux sur le bord d’un fleuve. Elles ont vu l'appareil photo. Evidemment, ce n’était pas une vision très positive de la femme. Elles étaient donc un peu en retrait. Il y en a une qui m’a un peu agressée et qui me demandait ce que je faisais alors que je n’avais pas encore fait de photos. Je lui ai expliqué que je voulais prendre des photos, témoigner de la difficulté de leur vie car ce sont les femmes qui cassent les cailloux, pas les hommes qui, eux, conduisent le camion. Et là elles ont accepté.
Comment est née cette exposition ? Est-ce la première fois que vous la proposez ?
Celle-ci, c’est la première fois oui, mais cela faisait longtemps que j'y pensais. Ce que je voulais montrer, c’est qu’en Afrique, les femmes ne s'arrêtent jamais : on ne voit jamais une femme assise à ne rien faire, c’est quasiment impossible. Au centre des villages en Afrique rurale, il y a ce que l’on appelle l'arbre à palabres. Le soir, les hommes sont assis sous l’arbre à discuter où ils se racontent leur journée et refont le monde autour d'un verre ou d'une tasse de thé. Les femmes s’assoient très rarement, avec des enfants dans les bras ou avec un vêtement en train de faire quelque chose. Elles n’ont jamais les mains inoccupées. Si l’Afrique s’en sort, car il y a quand même des raisons d’espérer que les choses s’améliorent, c’est vraiment grâce aux femmes. D’où le titre de l’expo, « Les Filles d’Atlas ».
Atlas, dans la mythologie grecque, c’est un titan, une des premières divinités. Après un combat entre Zeus, les olympiens et les titans, Zeus a puni les titans en leur donnant à chacun une malédiction. La punition d’Atlas était de porter la voûte céleste sur ses épaules. Dans une autre histoire, Persée qui revenait de tuer la Méduse, se venge d’Atlas, qui ne voulait pas le laisser passer, et le transforme en montagne. Cette montagne c’est la chaine de l’Atlas, qui porte son nom, qui est dans le nord de l’Afrique et qui couvre le Maroc et l’Algérie. J’adore ce mythe et je le trouve très adapté à ces femmes qui portent le continent Africain sur leurs épaules. D’abord parce qu’elles portent toujours des choses dans les mains et puis, tout repose sur elles : l’économie de la famille, l'éducation des enfants, l’agriculture.
Je suis très heureuse de faire cette exposition à l’Institut français. Cela s’est fait entre femmes et c’était assez amusant. J’ai vraiment été très bien accueillie par Marie-Cécile Le Luec, la nouvelle Directrice de l’établissement et par son équipe, notamment Laurence et Julia.
Quelle est la nature de vos photos ? Ce n’est pas vraiment du noir et blanc …
Oui c’est difficile à définir en deux mots. Au départ, ce sont des photos couleurs que je retravaille avec Photoshop® pour mettre en valeur. Je laisse en couleur ce qu’elles portent dans les mains pour le faire ressortir et pour que les gens soient frappés par ces femmes. Et puis montrer leur dignité, leur courage. Elles sont toutes très dignes, très droites, très belles.
Ces femmes-là ne baissent jamais les bras, ne se plaignent jamais
Est-ce qu’il y a une photo qui vous touche plus que les autres ?
Il y en a plein qui me touchent ! (rires) Il a celle de la femme Aka. Le peuple Aka, c’est ce que nous appelons pygmée. Pygmée, cela veut dire petit homme, c’est péjoratif. Mais Aka c’est le nom de leur peuple. J’aime beaucoup celle de la femme Aka qui fait sa vaisselle sur le bord du fleuve. Elle est dans une tâche toute simple, toute bête et en même temps, elle garde un regard très fier, très sûre d’elle. Ces femmes-là ne baissent jamais les bras, ne se plaignent jamais.
Quels sont les autres thèmes en photographie qui vous passionnent ?
Je suis fascinée par tout le travail artisanal, le travail des mains. J'ai déjà fait plusieurs expositions sur ce thème et je vais en proposer une au mois de juin dans le cadre de Russafart sur les bronziers au Congo. J’ai également pour projet une exposition autour des vêtements des falleros et des falleras. Je trouve ça très esthétique.

Mais ce qui m'intéresse en photo, c'est la couleur et la lumière. Je pense que tout peut être beau si la lumière est belle, tout peut- être intéressant.
En parlant de la lumière, que pensez-vous de celle de Valence ? On dit que la lumière est incroyable.
Ah mais moi j’adore ! Il y a des ciels d’un bleu intense alors qu’en Afrique Equatoriale, le ciel est toujours bleu pâle, presque blanc et cela nous manquait. A Valence, il y a des jours où l’on croirait que le ciel sort d’un atelier de peinture. Il y a vraiment une très belle lumière, aussi bien le matin que le soir, c’est un vrai plaisir. La Cité des Sciences est une merveille tant sur le plan esthétique que sur le plan des lumières, des reflets.
Et justement comment êtes-vous arrivée à Valence ?
J'ai passé 12 ans en Afrique parce que j'ai rencontré là-bas mon mari qui était déjà pas mal installé. Nous avions envie de revenir vers le nord sans pour autant nous installer en France. Lui n’étant pas français, je tenais à ce que nous soyons dans un dans un pays tiers. Nous avons hésité entre le Maroc et le Portugal. Un été où justement nous étions allés visiter le Portugal, nous sommes passés par l'Espagne à notre retour. Je lui ai fait visiter l'Andalousie qu'il ne connaissait pas et nous nous sommes arrêtés à Valence que nous avons découvert tous les deux. J'ai eu le coup de foudre un soir d’été, à 22h place de la Mairie … J’ai dit : « C’est là. Je pose ma valise. » Un an après nous achetions un appartement à Ruzafa.
L’Afrique vous manque-t-elle ou avez-vous trouvé un équilibre ?
Si, la vie en Afrique nous manque. On y retournera. Peut-être pas y vivre parce que cela devient compliqué sur le plan politique. Je rêve d'aller à Zanzibar ou au Sénégal que nous ne connaissons pas encore. Je ne connais que 18 pays d'Afrique ! Mais Valence c’est une bonne transition. D’ailleurs, des Valenciens, m’ont dit : « Ah mais l’Europe, c’est loin, c’est au-delà des Pyrénées. Ici on est plus près de l'Afrique ». Je trouve qu’ici il y a une douceur de vivre, une chaleur humaine qui ressemble à l'Afrique.
Le choix de Ruzafa est peut-être lié ?
C'était sûrement inconscient mais c'est le quartier de Valence où je me suis le mieux sentie en arrivant à Valence. Il y a 4 ans, lorsque nous sommes arrivés, le quartier était en plein travaux, les rues étaient en train d’être refaites et cela ne ressemblait pas à grand-chose. Pourtant, il y avait une atmosphère dans ce quartier, un côté multiculturel. Ici, nous avons des amis de toutes origines, on croise des chinois, notre marchand de légumes est pakistanais, le boucher, marocain et tout le monde se mélange très bien. C’est un quartier populaire familial avec des gens qui viennent de partout et cela se passe bien et moi je suis comme un poisson dans l'eau, c’est tout à fait ce qui me fallait.
La photographie est-elle votre seule passion ?
D’une part je suis photographe mais d'autre part, même si je suis en disponibilité de l'Education Nationale, je continue à enseigner par petits groupes pendant les vacances scolaires. J’encadre des lycéens pour les préparer au bac sur le plan méthodologique. C'est important pour moi de garder les deux. Je crois que je suis prof dans l’âme et que je ne pourrais pas arrêter complètement.
Si vous aviez des conseils à prodiguer à des jeunes qui souhaiteraient faire comme vous, prendre un sac-à-dos et partir, quels seraient-ils ?
Peut-être de d'abord prendre le temps, ne pas vouloir tout faire tout de suite et vite. Prendre le temps de s'asseoir à des terrasses de café, de s'asseoir avec les gens pour parler avec eux. Je déteste les gens qui traversent tout à fond ou qui découvrent un pays en avion. Au Kenya cela se fait beaucoup par exemple : aller d’un parc naturel à un autre dans de tous petits avions. Pour moi, ce n'est pas voyager. Moi j'aime prendre le temps, quitte à passer trois jours où l’on ne voit rien d'exceptionnel. On voit simplement la vie normale avec des gens normaux, les villages et j'adore ça !
Si vous souhaitez découvrir l’exposition de Béatrice à l’Institut Français, vous avez jusqu’au 20 avril 2018 ! Et si l’une des photos vous plait, sachez qu’elles sont également à vendre.
Sur le même sujet