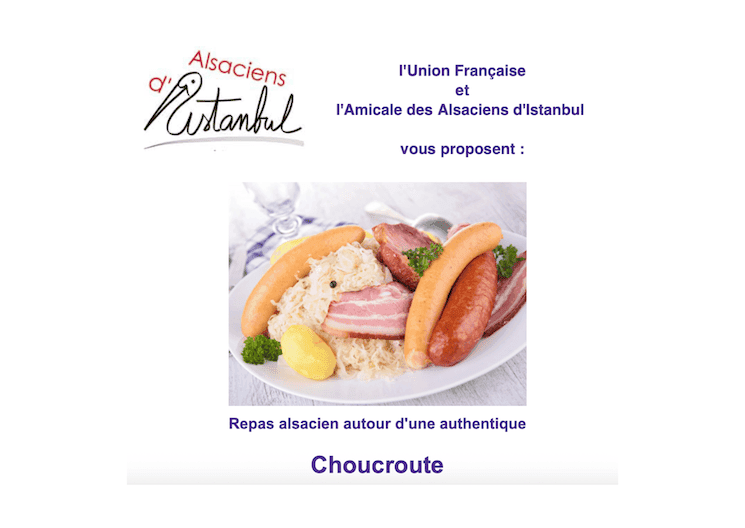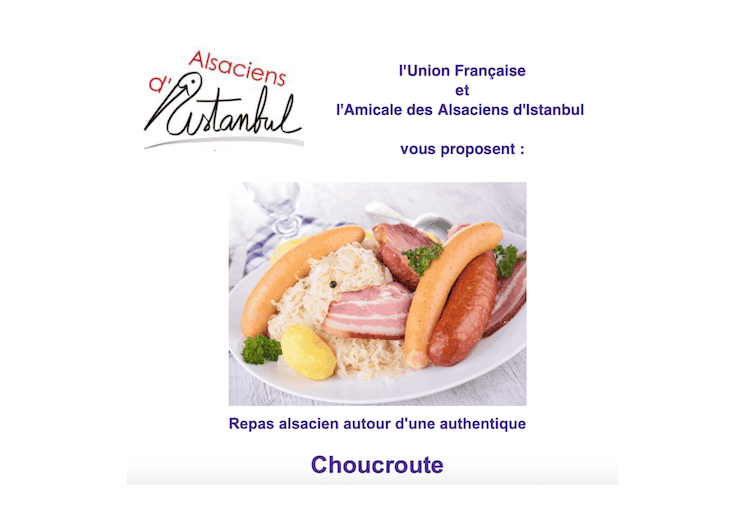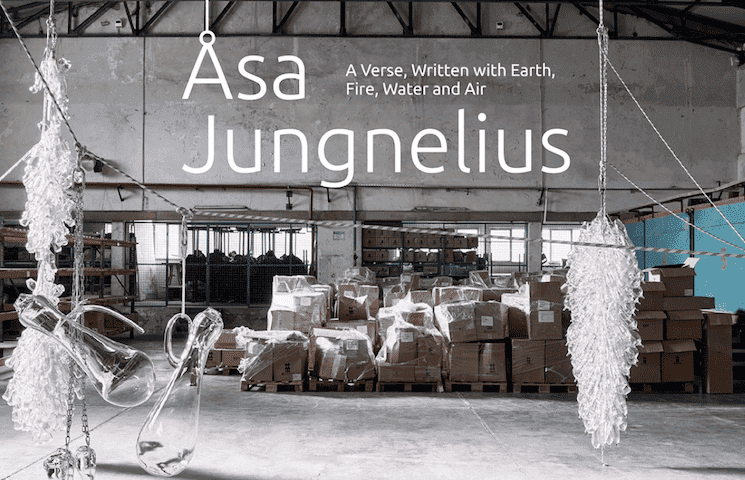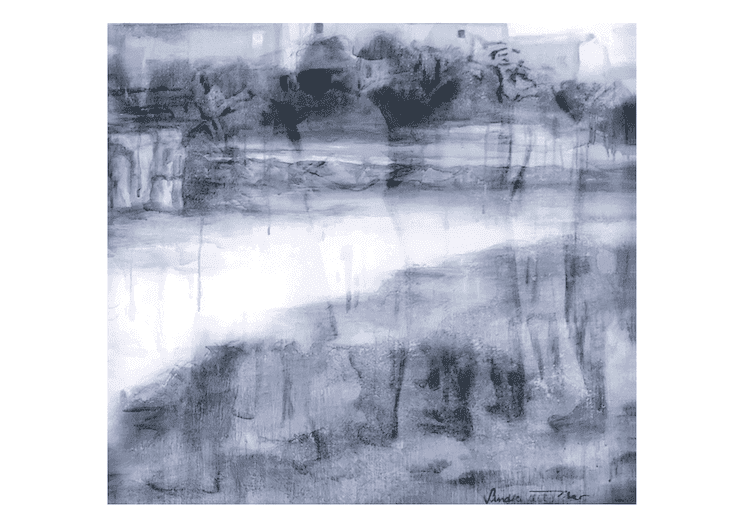Il y a cent ans, au crépuscule de l'Empire ottoman, la famille maternelle de Joséphine Lama est déracinée de Mara?, en Cilicie, dans le sud de l'actuelle Turquie. Exilée parce qu'arménienne. La mère de Joséphine n'a alors que deux ans et cette épreuve n'est que la première d'une vie qui sera marquée par d'autres exils et traversée par une autre histoire : l'histoire palestinienne. Joséphine Lama ? arménienne par sa mère et palestinienne par son père ? entreprend aujourd'hui un voyage dont elle rêve depuis longtemps : le voyage vers Mara?, sur les traces de sa grand-mère. Lepetitjournal.com/Istanbul l'a rencontrée à Istanbul, à quelques heures du départ.
Lepetitjournal.com d'Istanbul : Parlez-nous de votre famille?
Joséphine Lama (photo AA): Je suis arménienne du côté de ma mère, de la famille Avakian de Mara?. Mon grand-père s'appelait Niazi Avedik Avakian et ma grand-mère, Haïgouhi Avakian. Les Avakian ont quitté Mara?, avec beaucoup d'autres Arméniens, soit en 1915, soit un peu plus tard. Je ne connais pas l'année exacte. Ma grand-mère, mon grand-père, ma mère qui avait deux ans à l'époque et son petit frère ont été envoyés en Syrie.
Là-bas, très vite, ma grand-mère devient veuve car son mari meurt de tuberculose. Elle a alors 25 ans. J'imagine la vie difficile de cette mère, de cette jeune femme, qui ne parle pas un mot d'arabe et qui va pourtant vivre et travailler en tant qu'infirmière à Damas pendant 30 ans, avant de venir s'installer en Palestine pour rejoindre ma mère ? sa fille ? qui s'est mariée entre-temps à un Palestinien.
Quand j'étais enfant, le soir, ma grand-mère me racontait ce qui était arrivé à sa famille. Elle me parlait de viols, de massacres. Elle me racontait ça un peu comme une histoire parmi les légendes et les contes. J'écoutais sans trop y croire.
A neuf ans, j'ai commencé à poser des questions à mon père, qui était un grand musicien et qui lisait beaucoup (son père Augustin Lama, Palestinien chrétien, fut organiste de la Basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem pendant des décennies, ndlr). Je me disais : ?lui me dira la vérité?, parce que mon père ne me racontait pas d'histoires de fées ou de magie. Et mon père m'a dit : ?l'histoire de ta grand-mère est vraie?.
Que vous racontait votre grand-mère arménienne ?
Quand elle me racontait son histoire, elle disait : ?nous, les Avakian, nous étions une grande famille?. Elle était très fière. Mon oncle aussi nous disait toujours : ?lorsqu'on vous demande qui vous êtes, répondez : ?je suis arménien?. Ma grand-mère disait aussi : ?nous, les Avakian, nous vivions dans une grande maison au centre de Mara??. Elle racontait que nous avions des terres, de nombreux ouvriers, et que nous nous occupions aussi du cuir. Que nous avions plein de pièces d'or que nous mettions dans des boites métalliques, et que ces boîtes ont été cachées sous terre lorsqu'ils ont dû partir. Tout cela sonnait comme une légende pour la petite fille que j'étais.
Votre mère parlait-elle de ce passé ?
Elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne se rappelait de rien et surtout, elle portait une autre souffrance, celle de la question palestinienne puisque ma mère a subi l'exil palestinien. Elle a été expulsée de Jérusalem avec mes frères et moi-même en 1948. Mais c'est une autre histoire... Une histoire qui se répète.
Car à 18 ans, je dois encore quitter Jérusalem à cause de la guerre de juin 1967, un nouveau traumatisme. A nouveau, nous connaissons l'exil avec mes frères et nous sommes séparés de ma grand-mère, de mes oncles arméniens... Je suis comme éjectée de ma vie. Je commence une autre vie d'étudiante à Paris, où je fais des traductions en quatre langues : français, arabe, anglais et italien. Je me marie avec un médecin jordanien, qui était venu se former en France, et je pars vivre en Jordanie, où je vis toujours aujourd'hui, du moins une partie de l'année.
À quel moment faites-vous le lien entre votre histoire familiale ? les ?légendes? de votre grand-mère ? et ce qui est arrivé à un peuple, au peuple arménien de l'Empire ottoman, auquel appartenait votre famille maternelle ?
En France, pendant mes études. Là, nous n'apprenons pas seulement à traduire les langues, nous avons aussi des cours magistraux de droit international, d'économie etc. C'est là que je découvre l'importance de la justice et des droits. C'est là que je découvre l'histoire, mon histoire. Le devoir de vérité, de lire, de se documenter. C'est un besoin profond, celui de ?mettre de l'ordre? en moi, mais aussi de savoir de quoi je parle, lorsque j'en parle. Je suis en quête de justice et de vérité.
Quand venez-vous pour la première fois en Turquie ?
A l'été 1966. J'ai alors deux frères jumeaux qui se destinent à des études d'ingénieur. A l'époque, il n'y a pas d'université en Palestine ni en Jordanie. Or il se trouve qu'il existe une très bonne université américaine à Istanbul, le Robert College. Ma mère voulait quelque chose de prestigieux. On envoie donc les jumeaux, Ferdinand et François, à Istanbul. De mon côté, je deviens boursière du gouvernement français et je suis envoyée à Paris, à la Sorbonne. Lorsqu'on se retrouve, mes frères me racontent combien Istanbul est une belle ville. Les bateaux, le Bosphore, la mer Noire, les Dardanelles etc. Je suis fascinée. Et c'est en 1966 que je fais pour la première fois le grand voyage : depuis Paris, nous traversons la Turquie d'ouest en est en voiture avec mon mari. Mais à l'époque, je n'ose pas passer par Mara?, la ville de ma famille. Psychologiquement, je ne suis pas prête, je n'ai alors que 22 ans.
Envoyer deux garçons à Istanbul, en Turquie, cela n'a pas créé de débats ou de problèmes dans la famille arménienne ?
Aucun. Le seul problème est survenu lorsque mon frère nous a annoncé qu'il aimait une Turque ! Ma grand-mère avait quitté la Turquie dans les conditions que nous savons et elle apprend que son petit-fils est amoureux d'une Turque? C'était ouvrir une plaie, elle ne voulait pas. Mon frère était encore jeune, il n'a pas eu le courage de se battre pour cette relation. Par respect pour la souffrance de ma grand-mère, il s'est sacrifié.
En 1966, vous n'étiez pas prête à vous rendre à Mara?. Mais cette année, pour la première fois, vous vous apprêtez à le faire. Pourquoi maintenant?
Vous savez, quand on avance dans l'âge, on met de l'ordre, à tous les niveaux. Je dois cela à ma grand-mère, même si elle est décédée. Je ressens aussi ce besoin de revenir sur les lieux, de voir l'endroit où est née ma mère, où ma grand-mère a vécu. Par fidélité à ma grand-mère et à sa famille, même s'il ne reste rien, aucune trace arménienne, pas même une pierre... Je transmettrai des images, des impressions, des écrits, des textes à mes cousins arméniens aux Etats-Unis et en Palestine. Je voudrais aussi transmettre cela aux enfants, aux jeunes générations de la famille. Comme on dit, ?si on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir?. Il faut connaître son passé pour avancer vers l'avenir de façon forte.
Ce qui m'intéresse également, c'est de rechercher des membres de la famille de Niazi Avedik Avakian, mon grand-père. Il faut aussi dire que j'avais un oncle du côté maternel qui était conseiller juridique du dernier sultan ottoman à Istanbul et qui a été accompagné par un cortège spécial jusqu'à sa famille à Mara? avant d'être déporté avec eux. Ce grand-oncle, beaucoup le connaissent car en Palestine, sous le mandat britannique, il a été le directeur des télégraphes, il a vécu longtemps à Jérusalem. Je ressens donc la curiosité d'en savoir plus à propos de cette famille.
Vous accomplissez ce voyage en 2015, c'est-à-dire l'année du centenaire du génocide des Arméniens. Ce n'est pas un hasard ?
C'est un chapitre de mon histoire que je viens tourner. J'aime beaucoup la Turquie, c'est le pays de ma mère, après tout. Ma mère et ma grand-mère aimaient les chants turcs, tristes et nostalgiques. Elles avaient gardé les coutumes, la nourriture, la langue... Elles parlaient de la Turquie comme de leur pays? et c'était leur pays aussi !
Les Turcs d'aujourd'hui, bien sûr, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en 1915. Je compare ça à la question palestinienne, en imaginant qu'on pourra un jour exister, coexister avec les Israéliens, en paix. Et je vous dis cela alors que moi-même j'ai beaucoup souffert : j'ai été expulsée de ma maison. Mais demain, je serai prête à vivre en paix avec les Israéliens. Je suis prête à tourner la page. Il n'y a aucune autre option, aucune autre solution. C'est la même chose avec les Turcs : je dis que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui est arrivé il y a 100 ans. La vie doit continuer.
Sauf qu'ici, en Turquie, beaucoup ne reconnaissent pas ce qu'ont vécu votre famille et le peuple arménien?
Ils ne savent pas. Cela suppose de réexaminer ce dossier, ce passé, mettre un peu d'ordre et de justice. Reconnaître. Il y a eu de toute façon des fautes des deux côtés. Il faut avoir le courage d'y faire face.
Le gouvernement turc, ces dernières années, a présenté des condoléances et reconnaît des ?souffrances partagées?. Cela vous satisfait-il ?
Oui mais il faut aller plus loin et regarder les faits historiques. Qui a commandité les massacres, les déportations vers la Syrie ? Qui a donné les ordres ? C'était très organisé. Ma grand-mère ? je me souviens de cette histoire pénible ? racontait que des Arméniens s'étaient réfugiés dans une église qu'on a ensuite fermé et brûlé. Qui a fait ça ? Tout a été soudain, massif?
Depuis quelques années, et cette année en particulier, de nombreux Arméniens de la diaspora font comme vous le voyage en Turquie sur les traces de leurs ancêtres (*voir encadré ci-dessous)?
Je comprends ceux qui veulent visiter les lieux de souffrance. C'est un besoin profondément humain. On ne raisonne pas, ça ne se passe pas dans la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Cela n'a rien de politique. C'est profondément en moi, pour moi, pour mon équilibre, j'ai besoin d'aller plus loin. Pourquoi étudierais-je l'Histoire de la France et du Proche-Orient, ou du monde arabe si je ne connais pas mon histoire ? C'est se rendre justice à soi-même. Et, comme je l'ai dit, si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas construire.
Avez-vous proposé à des membres de votre famille de vous accompagner ?
Je ne leur ai pas proposé mais je leur avais dit qu'un jour, j'irai à Mara?. Chacun a sa propre expérience et sa propre souffrance. Plus tard, peut-être feront-ils ce voyage. Pour l'instant, ils sont pris par d'autres choses. On enfouit ça pendant longtemps et un beau jour, ce qui est dans la tête et dans l'âme est obligé de sortir, de s'exprimer. Je suis sûre que beaucoup de mes amis arméniens vont dire de moi que j'ai beaucoup de chance d'être allée à Mara?. Je sais qu'ils vont m'envier et qu'ils vont songer à faire de même. Ce besoin en moi, je suis sûre que beaucoup le ressentent aussi.
Propos recueillis par Anne Andlauer (www.lepetitjournal.com/Istanbul) mardi 12 mai 2015
|
Roupen Alexandrian est venu à Istanbul avec sa cousine habitant Londres et quelques amis de Paris, du Liban, en tout sept personnes. Il demeure en Birmanie, où il travaille dans l'humanitaire pour les Nations Unies mais a pris une année sabbatique actuellement en cours. La quarantaine seyante et souriante, c'est avec une philosophie bien particulière qu'il raconte son histoire : ?Ma mère est née en France et mes grands-parents maternels étaient des déportés ayant débarqué à Marseille. Mon père est un Arménien né dans le Kurdistan irakien et qui a fait ses études en Angleterre. Après leur rencontre, ils ont décidé d'aller s'installer au Liban, où ils avaient une opportunité. Moi, j'ai grandi là-bas et suis allé après en France. Ma carrière professionnelle a commencé ensuite avec des voyages dans le monde entier. La transmission de l'arménité était importante dans ma famille, je crois que c'est une responsabilité transmise par nos grands-parents ; il y avait une sorte de complexe identitaire, de peur de perdre cette identité. Je dirais même que parfois, je ressens du fondamentalisme. J'imagine qu'un Français veut garder sa culture française tout comme un Argentin la sienne mais je crois que les Arméniens et les peuples qui ont eu une histoire un peu difficile ont tendance à être beaucoup plus attachés à leurs origines, que ce soit au niveau de la langue, de la musique, de la poésie, tout ce qui est en train de disparaître actuellement. Si je me compare à mes parents, j'ai beaucoup moins de savoir sur la culture arménienne et j'imagine que ce sera pire pour mes enfants si j'en ai un jour. C'est une sorte d'instinct de survie de l'identité qui a été transmis de génération en génération.? C'est le second voyage de Roupen en Turquie. Il a voyagé en 2014 dans l'Est du pays, pour découvrir un peu ce qu'il a appris durant toute sa vie, ce qu'on a essayé de lui transmettre: ?C'est vrai qu'on ressent que quelque chose a existé et a disparu.? Le jeune Arménien poursuit : ?La raison pour laquelle j'ai pris cette année sabbatique, c'est pour retourner un peu à mes sources. Après avoir vu la misère dans le monde entier, je me suis dit ?pourquoi aider tout le monde et ne pas me connaître moi-même ?? La raison pour laquelle je suis venu ici à Istanbul, et sur laquelle j'insiste, c'est que je n'ai pas de haine, de ras-le-bol. Je crois à cet effort de tendre la main, de dire qu'on se ressemble énormément, il faut l'avouer, culturellement, socialement, musicalement... Il y a quelque chose qui nous a séparés, un incident très important, qu'on appelle ?génocide?. Je pense que l'opinion publique en Turquie reconnaît ou bien manque de savoir, doit connaître la réalité, et nous aussi de notre côté, nous devons essayer aussi de nous assouplir un peu, de mettre un peu d'eau dans le vin.? Roupen se dit ?très athée et très pratiquant. Il y a des gens qui font du yoga, de la méditation transcendentale pour se déconnecter ; moi le dimanche, si je suis à Paris ou quelque part où il y a une église arménienne, j'y vais pour me reposer, pour prendre l'odeur, pour écouter la musique qui me parle. Au quotidien, je suis très loin de l'arménité. Quand je suis au Tchad, en Iran, en Syrie, au Darfour ou en Birmanie, il y a une sorte de manque d'arménité. Ce n'est pas pour prier que je vais en Arménie, je ne crois pas en Dieu mais l'identité arménienne est très liée à l'Eglise. Je vois rarement la spiritualité chez nos prêtres, je vois plutôt le côté identité. (?) Le réveil de l'identité a lieu quand on est loin de son identité, de son appartenance. Parfois je me demande si je suis nationaliste mais non. Je travaille aux Nations Unies et je vois toutes les races, toutes les couleurs, ce sont mes interlocuteurs quotidiens et je les respecte énormément, sans aucune différence. Mais l'identité, c'est autre chose. C'est une météorite qui est train de tomber sur notre terre, on est tous ensemble mais s'il y a une part d'identité, je suis d'abord arménien, un peu libanais vu que j'ai grandi là-bas, un peu français car ma mère m'a transmis cette culture et après le cercle grandit jusqu'à devenir un être humain comme tous les autres.? A propos de son premier voyage en Turquie: ?Je suis en train de faire un pèlerinage, du tourisme avec une intention de découvrir qui sont les Arméniens qui ont vécu ici, essayer de sortir de mes émotions, de ne pas être aigri, être objectif autant que possible mais très souvent, l'émotion a pris le dessus. (?) Mon frère habite Abou Dabi, ma s?ur à Dubaï, mes parents au Liban, et tous sont partis en Arménie pour la commémoration du centenaire. Moi, je n'ai pas voulu parce que je ne suis pas là pour pleurer, mais pour résoudre un problème entre deux civilisations, deux cultures ou deux frères ennemis. Je ne fais pas partie de la majorité mais je crois qu'il faut tendre la main à la Turquie à condition de ne pas être naïf, mais ça c'est l'Histoire qui le dira.? Propos recueillis par Nathalie Ritzmann |