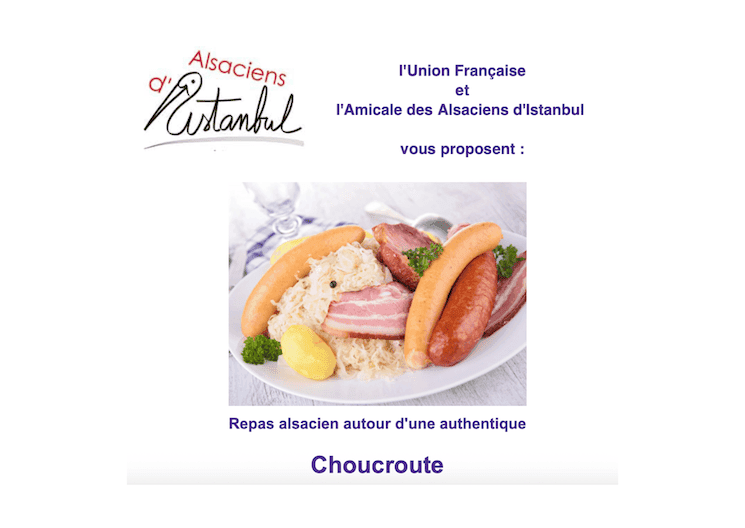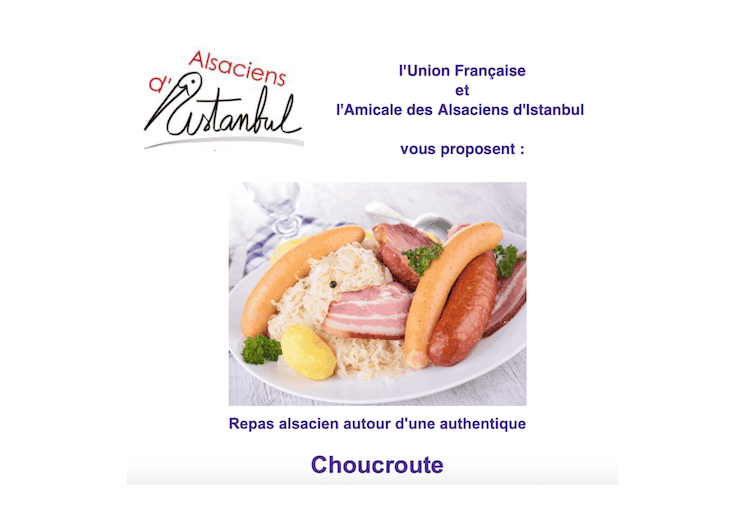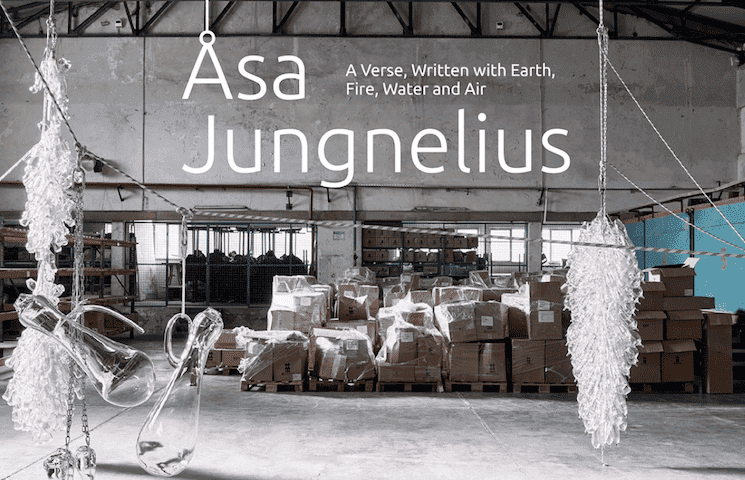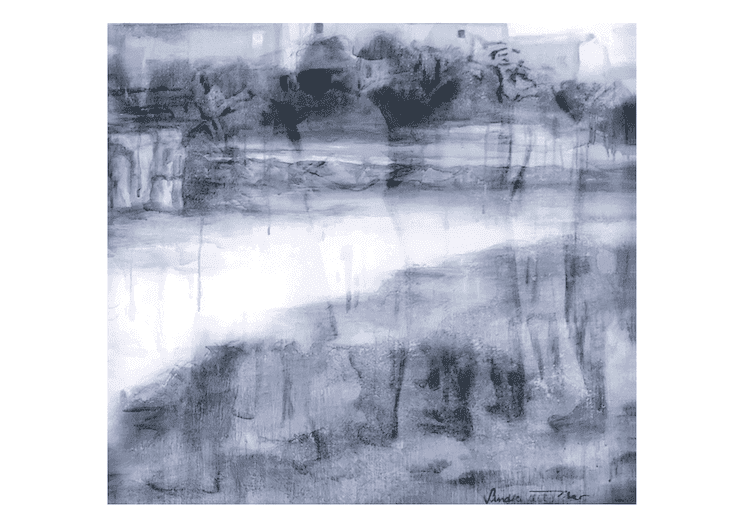Relations franco-turques, Union européenne, Syrie... A quelques semaines de la visite du président de la République, François Hollande, en Turquie, l'ambassadeur de France, Laurent Bili, répond aux questions du petitjournal.com d'Istanbul.
lepetitjournal.com d'Istanbul : Vous êtes en poste en Turquie depuis deux ans et demi. Beaucoup de diplomates considèrent ces deux ans comme une durée idéale pour se sentir “chez soi” dans son pays d'accueil, en connaître tous les rouages politiques et diplomatiques, tisser des liens forts avec ses interlocuteurs... Mais vous connaissiez déjà la Turquie, vous y aviez déjà vécu, vous parliez déjà turc. A votre arrivée en juillet 2011, vous êtes-vous senti “chez vous” tout de suite ou avez-vous aussi connu une période d'adaptation à un pays qui, en réalité, avait changé depuis votre dernière visite ?

Être turcophone, est-ce indispensable à votre niveau de responsabilités ?
C'est fondamental pour avoir accès en direct aux informations, pour bien faire son métier. On gagne en empathie. Cela m'a aidé dans les périodes un peu tendues au début de ma mission (ndlr : au moment du projet de loi portant sur la pénalisation de la négation du génocide arménien, dite “loi Boyer”, finalement invalidé par la Cour constitutionnelle). Quand je vais dans les universités pour discuter des relations bilatérales, notamment quand on m'interroge sur des questions sensibles, je pense qu'il y a des choses qu'on dit en turc qui passent mieux que si elles étaient dites par l'intermédiaire d'une traduction. Même les maladresses, d'une certaine façon, témoignent d'une certaine sincérité dans le propos. Cela donne une chaleur de contact. Et quand l'autre essaye de vous faire passer un message, vous le comprenez mieux avec les mots que lui-même utilise. Cela change beaucoup de choses pour moi, cela me permet d'avoir accès à des biographies non traduites en français... Autre effet positif : plusieurs jeunes diplomates à mes côtés commencent à se débrouiller en turc, car ils sentent une amicale pression. Dans la mesure où je conduis une partie de mes entretiens en turc, ils ont envie d'en faire autant et, pourquoi pas, de revenir à Ankara comme chef de poste...
Nucléaire, transports, armement... On a l'impression que, ces derniers mois, le ciel se dégage pour les grandes entreprises françaises en quête de marchés en Turquie. Dans quelle mesure faut-il y voir un signe que les relations franco-turques vont effectivement mieux ?
Quand vous êtes sur des contrats régaliens, qui impliquent une décision de l'Etat, vous ne pouvez pas espérer une chance de remporter ces contrats en l'absence d'une relation bilatérale apaisée. A défaut d'une lune de miel, il vous faut au moins une relation “normale”. Depuis début 2012, la relation bilatérale s'est normalisée. La décision du Conseil constitutionnel a un peu apaisé les tensions liées à la loi Boyer. L'élection du président Hollande et un nouveau regard sur le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont également contribué à dégager l'horizon. Ne manque que la “cerise sur le gâteau” de la normalisation, c'est-à-dire la visite du président de la République en Turquie, sur laquelle nous travaillons pour le début de l'année prochaine. Il me semble que ce sera l'étape ultime pour montrer que les crises de ces dernières années sont derrière nous.
La date de la visite du président de la République en Turquie a-t-elle été confirmée ? Peut-on déjà dévoiler une partie du programme ?
La règle veut que les visites présidentielles soient annoncées officiellement par les deux présidences en même temps. Certes, nous travaillons sur des dates et des programmes, mais tout cela ne sera rendu public qu'une semaine avant.
Avez-vous beaucoup oeuvré pour que cette visite ait effectivement lieu ?
Le président de la République a été invité à venir en Turquie par le président Abdullah Gül dès le sommet de l'OTAN de Chicago, c'est-à-dire quelques jours après son élection en mai 2012. Il y avait donc une volonté très nette, au lendemain d'une période un peu tendue, de reconstruire les relations et la présidence de la République française a très vite donné son accord de principe pour la visite. Après, tout est affaire d'agenda. Entre la Syrie, le Mali... nous avons quand même traversé quelques périodes de crise.
N'est-il pas délicat d'organiser une visite présidentielle alors que la Turquie entre dans une période de campagne électorale, puisque des élections municipales auront lieu le 30 mars ? Cela ne risque-t-il pas de donner l'image d'un soutien au parti au pouvoir ? Des rencontres avec des leaders d'opposition sont-elles par exemple prévues ?
En théorie, nous sommes encore un peu loin du temps des élections. Il est vrai que l'agenda interne en Turquie s'est un peu accéléré ces derniers jours. Toutefois, le principe d'une visite présidentielle, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une relation d'Etat à Etat.
Les ministres des Affaires étrangères français et turc sont en contact régulier sur diverses questions internationales – la Syrie pour n'en citer qu'une. Deux ministres “économiques”, Nicole Bricq et Arnaud Montebourg, sont venus en Turquie en 2013. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s’est aussi rendu à Ankara en mars 2013. Dans ce contexte d'échanges déjà nombreux, que peut apporter de plus une visite présidentielle ? Est-ce avant tout affaire de symboles? Est-ce pour effacer le malaise de la “visite éclair” du président Nicolas Sarkozy début 2011 ?
Le symbole, en politique, est assez important. Cela fait plus de 21 ans qu'il n'y a pas eu de visite présidentielle française d'Etat en Turquie. Cette visite marque donc la volonté de retrouver le temps long des relations bilatérales, de dépasser les petites tensions que nous avons pu avoir sur tel ou tel sujet. Il faut aussi savoir que, dans les mécanismes des deux Etats, préparer une visite présidentielle veut dire mobiliser les administrations. Une visite ministérielle peut mobiliser un ministère pour travailler sur tel ou tel sujet précis. Une visite présidentielle permet de travailler à la fois sur le politique, l'économique, le culturel, de mobiliser toutes les administrations des deux côtés pour essayer de régler un certain nombre de choses. Par exemple, sur un sujet important pour la communauté française : le statut de nos deux lycées dépendant de l'Aefe (Agence française pour l'enseignement français à l'étranger, ndlr). J'essaye de profiter de cette visite et du climat favorable pour avancer sur certains dossiers très pratiques.
A l'approche de la visite du président de la République mais surtout de 2015, vos interlocuteurs turcs vous pressent-ils de questions sur les intentions de la France concernant une éventuelle nouvelle loi pénalisant la négation du génocide arménien de 1915 ? Que leur répondez-vous ?
C'est certainement un sujet de préoccupation pour nos interlocuteurs turcs. Je leur réponds que 2015 peut aussi être une occasion de tourner la page du passé. Je souligne qu'il y a une attente dans la communauté française d'origine arménienne sur des gestes de la Turquie à l'approche de 2015. Nous essayons aussi d'encourager un travail en profondeur sur la réflexion mémorielle, sur les démarches que la France a connues pour elle-même sur d'autres aspects historiques mais aussi sur tout ce qui peut aider une discussion entre intellectuels arméniens et turcs, ou d'autres nationalités. On parle toutefois d'un travail de très long terme.
Anadolu Kültür, le Mémorial de la Shoah, l’Université Paris 8 et l’Institut français de Turquie organisent justement en 2013-2014 une série de manifestations consacrées à l’expérience française dans le processus mémoriel lié à la Shoah. Quelle est la juste attitude que peut adopter la France sur le sujet ? Comment partager son expérience sans apparaître en donneur de leçons ?
Effectivement, si vous vous arrivez en disant “voilà ce qu'il faut faire, voilà la recette, voilà ce que vous devez dire”, cela ne fonctionne pas, cela peut provoquer une forme de rejet. Pour accompagner le travail de mémoire, nous essayons plutôt de trouver des supports qui permettent de réveiller la réflexion. Quand je discute avec les étudiants sur le génocide arménien, je leur dis toujours que beaucoup de sources sont aujourd'hui accessibles, en turc ou en anglais. Je leur dis : “lisez, faites-vous votre propre opinion, réfléchissez”.
Le ministre turc de l'Education nationale, en visite récemment à Paris, a vivement critiqué les manuels scolaires français, qui abordent dès la fin du collège la question du génocide arménien...
Le sujet a effectivement été soulevé plusieurs fois. Il est difficile pour le gouvernement turc de comprendre que les éditeurs en France ne sont pas sous le contrôle de l'Etat pour le choix des supports pédagogiques qu'ils utilisent pour illustrer un programme, qui lui-même est défini par une commission indépendante. Cette autonomie pédagogique peut être difficile à expliquer.
L'Union européenne a ouvert à l'automne un nouveau chapitre de négociations avec la Turquie. Ankara vient de signer un accord de réadmission des migrants clandestins, qui permet à l'UE de lancer le processus de libéralisation des visas. Observez-vous, comme beaucoup, un “retour” de la Turquie dans l'UE et si oui, comment l'expliquer ?
Ces deux sujets sont assez différents et indépendants l'un de l'autre. L'accord de réadmission aurait dû être signé il y a un certain temps mais la signature a été compliquée par des sujets un peu annexes. Est-ce que l'ouverture du chapitre 22 a facilité la signature de cet accord ? Je n'en suis pas certain. Il faut aussi se souvenir que dans la période précédente, l'Union européenne et la Turquie ont décidé d'avancer dans le cadre d'un “agenda positif”, qui permettait – à défaut d'ouvrir un certain nombre de chapitres – de pouvoir continuer à travailler concrètement sur la préparation de l'ouverture de ces chapitres. Et indépendamment même de l'ouverture des chapitres, à travers les instruments de préparation à l'adhésion à l'Union européenne, plusieurs centaines de millions d'euros sont dépensés chaque année pour la mise aux normes de la Turquie dans des domaines très variés. Nous travaillons par exemple sur la qualité des eaux de baignade, sur les déchets, sur la justice... Ce serait une erreur de considérer que tout était complètement bloqué puis est soudainement reparti. Certes, le blocage d'un certain nombre de chapitres à partir de 2007 par la France et par ailleurs, par l'Union européenne en raison de la non mise en œuvre du protocole d'Ankara a conduit à certaines tensions dans les relations Turquie-UE. Le chapitre 22, ouvert récemment avec l'aide de la France, a permis de décontracter un peu l'atmosphère après trois ans sans ouverture de nouveau chapitre de négociations. Mais je pense surtout que les relations turco-européennes sont importantes pour les deux parties. On a tout intérêt à ce que ce rapprochement se poursuive dans la durée.
Mais d'autres chapitres – portant notamment sur les droits fondamentaux, la justice, la liberté et la sécurité – restent bloqués pour le moment. La France encourage-t-elle la levée du veto sur d'autres chapitres ?
Les chapitres qui restent bloqués ne sont pas bloqués du fait de la France. Ce sont plutôt des chapitres liés à la mise en œuvre du protocole d'Ankara. Le président de la République sera certainement interrogé sur ce point pendant son séjour en Turquie.
Où en est-on des efforts diplomatiques pour mettre fin à la tragédie en Syrie ? Laurent Fabius a signé à l'automne une tribune proposant de suspendre le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de crimes de masse... Cette crise ne symbolise-t-elle pas l'échec de ce Conseil de sécurité, de ce qu'on appelle la “communauté internationale” ?
Nous avons tous une frustration liée au blocage du Conseil de sécurité. Mais les exemples où l'on s'affranchit de la légalité internationale ne sont pas non plus particulièrement satisfaisants. Il y a eu des propositions pour donner de la souplesse, comme celles qui ont été portées par le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, l'essentiel de l'activité diplomatique se porte sur la préparation de Genève II, pour essayer de remettre les parties autour de la table. C'est un exercice assez compliqué, il se passe beaucoup de choses. A Gaziantep, un gouvernement provisoire est en train de se constituer. Beaucoup d'efforts sont faits pour unir l'opposition, la situation est tendue entre certains groupes radicaux dits indépendants d'al-Qaida et de la mouvance djihadiste mais néanmoins en compétition avec l'Armée syrienne libre... Beaucoup de choses se passent, donc, mais la seule option diplomatique aujourd'hui est celle de Genève II.
Il y a aussi le problème des ressortissants européens – français et belges notamment – qui passent par la Turquie pour, disent-ils, “participer au djihad” en Syrie. L'Ambassade de France est-elle mobilisée sur cette question ?
C'est un sujet de préoccupation pour tous les pays européens, sur lequel nous essayons de travailler avec la Turquie.
La position de la Turquie – qui critique comme la France le fonctionnement du Conseil de sécurité, et qui a plaidé comme la France pour une intervention internationale après l'attaque chimique d'août 2013 – semble très proche de la position de la France sur ce dossier. Est-ce le cas ? Y a-t-il des points de divergence ?
Globalement, les positions sont en effet assez proches. Nous avons eu beaucoup de contacts directs avec les Turcs. Notre ministre est en contact régulier avec son homologue turc. Il peut y avoir des nuances mais il n'y a pas vraiment de divergences entre nos deux pays, pas dans les options de principe.
Quels vœux souhaitez-vous adresser aux Français de Turquie pour l'année 2014 ?
J'espère que l'année 2014 commencera très bien pour les relations bilatérales franco-turques, que la visite de notre président de la République ouvrira la voie à une année 2014 particulièrement prospère et chaleureuse pour l'amitié franco-turque. Et que chacun pourra bénéficier de cette atmosphère apaisée.
Propos recueillis par Anne Andlauer et Meriem Draman (http://lepetitjournal.com/istanbul) vendredi 20 décembre 2013