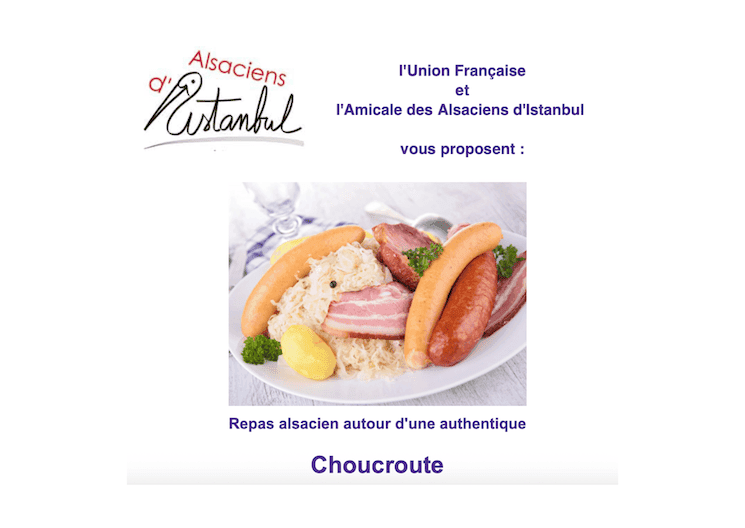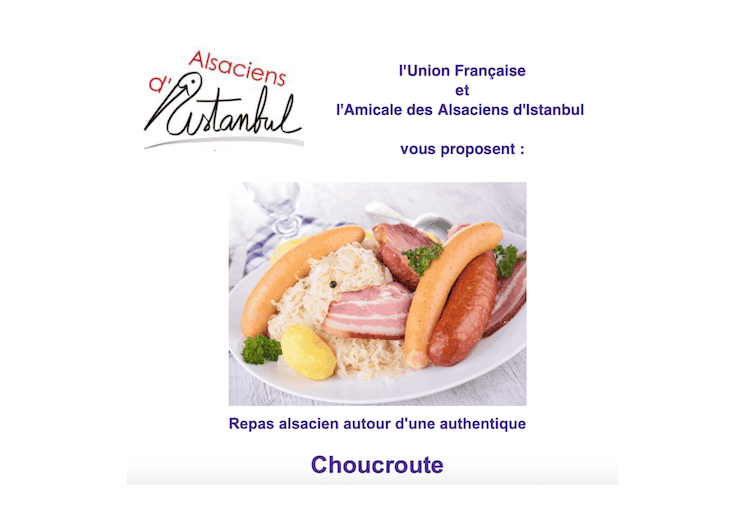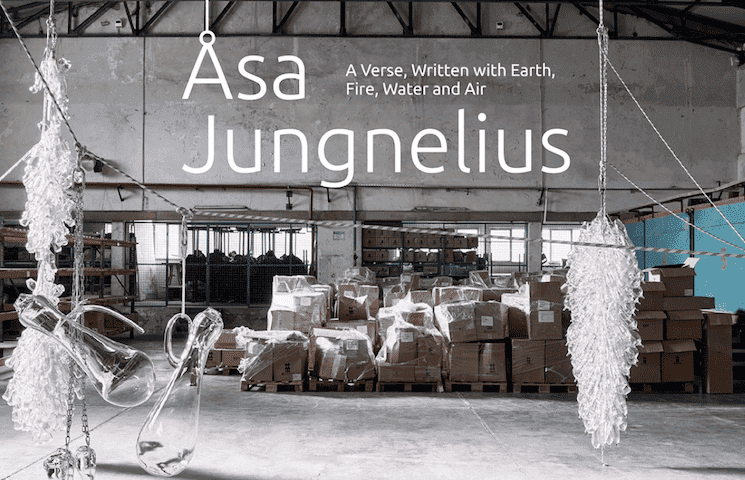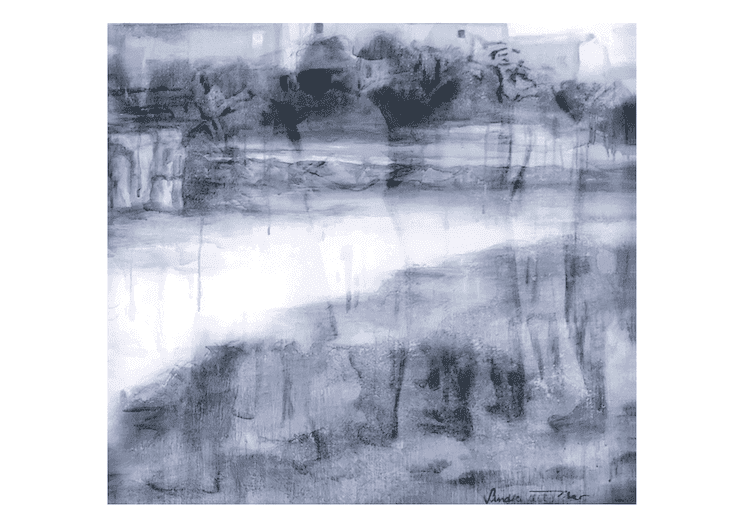Nicolas Cheviron, journaliste en Turquie, et Jean-François Pérouse, directeur de l'Institut français d’études anatoliennes, sont les auteurs de la première biographie du président Recep Tayyip Erdoğan en langue française. Ils y décrivent le parcours d'un homme politique issu d'une famille modeste, parvenu à se hisser à la tête de la Turquie jusqu'à peut-être s'identifier au fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk. "Erdoğan, nouveau père de la Turquie ?" paru aux éditions François Bourin n'est pas encore en vente en Turquie mais les deux auteurs ont accordé un entretien au petitjournal.com d'Istanbul.
Jean-François Pérouse : L'ampleur de la tâche et le fait qu'elle nécessitait des qualités complémentaires. C'est une commande sur laquelle je travaillais depuis déjà 10 ans et que Nicolas a rejoint – et sauvé – durant la dernière phase. Un chercheur n'a pas les mêmes qualités qu'un journaliste, d’autant que nous voulions faire un ouvrage lisible, qui atteigne un public le plus large possible. J'ai une formation de géographe qui se fait sentir dans certains passages de la biographie, sur les quartiers stambouliotes ou sur Rize (province de naissance d'Erdoğan, ndlr). Mais cette formation n'était que le début d'un intérêt plus large pour les sciences sociales et contemporaines, qui m'ont servi pour les sources idéologiques, notamment le mouvement conservateur des années 1950-1960, un sujet qui m'intéresse depuis longtemps.
Nicolas Cheviron : Jean-François est venu avec des éléments que j'aurais été incapable de rechercher moi-même, par exemple sur des aspects de filiation idéologique. Il a fourni un travail sur le long terme et je suis arrivé avec des qualités complémentaires.
Le titre fait référence à Mustafa Kemal "Atatürk" (le "père des Turcs"). Mais on trouve dans l'ouvrage des allusions à la "nouvelle Turquie" que Recep Tayyip Erdoğan entend fonder. Le président turc s'imagine-t-il comme "le nouveau père de la Turquie" ou comme "le père d'une nouvelle Turquie" ?
J-F. P : Les deux sont juste, d'ailleurs nous avions pensé à cette reformulation. Il y a ces deux dimensions dans le parcours d'Erdoğan : la référence au passé et l'inscription dans une tradition étatique, autoritaire, dans le prestige du père fondateur, que l'on ne rejette pas, mais aussi la volonté de s'inscrire comme refondateur d'une nouvelle Turquie. Et quand on parle de "nouvelle Turquie", on pose une certaine distance avec ce qui faisait l'ancienne. Dans les deux cas, on retrouve une volonté de modeler par le haut une société, de forger un citoyen.
N. C : Il y a effectivement une volonté consciente de créer une nouvelle Turquie qui refermerait la parenthèse de l'ancienne - et c'est ce qu'il a prôné dans son projet pendant de nombreuses années. Mais derrière ça, on refait le moule de l'Etat turc kémaliste dans un Etat autoritaire et finalement, c'est bien à Atatürk qu'Erdoğan ne cesse de se confronter, qu'il ne cesse de vouloir dépasser.
Entre la décision d'avril 1998 qui l'envoie en prison, les procès Ergenekon, puis plus tard les affaires contre Fethullah Gülen, le parcours du chef de l'Etat est jalonné par un nombre impressionnant de procédures judiciaires. Comment expliquer une telle obsession pour le système judiciaire ?
N. C : La question, c'est celle de l'indépendance du système judiciaire en Turquie qui n'a, en fait, jamais été réalisée. Déjà sous le régime précédent, ce système judiciaire était très politisé, il était aux ordres d'un certain nombre de personnes, de généraux, et Erdoğan n'a fait que récupérer ce système et essayer de le retourner à son profit. D'abord avec l'aide de Fethullah Gülen, puis – maintenant qu'il essaye de se débarrasser des gülenistes – avec ses propres composants. Sauf qu'entre temps, il y a eu une perte de compétences, c'est-à-dire que le niveau actuel des juges n'est plus celui d'avant. Il y a encore 15 ans de cela, on respectait les formes d'un Etat de droit, plus ou moins, tandis qu'aujourd'hui, on est clairement hors cadre.
Pour quelles raisons ?
N. C : Une nouvelle génération de juges a été jetée dans la bataille contre les gülenistes assez rapidement. On est dans une sorte d'urgence du combat, d'abord contre l'armée puis contre les fidèles gülenistes. Un conflit rapide que devait mener Erdoğan pour conserver et faire prospérer son pouvoir. Il y a une nécessité absolue de contrôler le système judiciaire et la rupture s'est faite en 2010 avec la réforme de la Constitution. Le Conseil supérieur de la magistrature a été réformé, ce qui a permis l'entrée de nouvelles personnalités. C'est ce conseil de la magistrature (ndlr : HSYK) qui nomme ensuite les juges, ce qui a permis de placer des personnalités plutôt favorables au pouvoir. C'est-à-dire d’abord des personnes de la mouvance de Fethullah Gülen, puis d'autres quand celle ci s'est rebellée.
J-F P : Pourtant, rien n'est jamais garanti, il peut y avoir des surprises et l'appareil judiciaire n'est pas homogène. Il y a des moments où les décisions prises ne répondent pas nécessairement aux attentes, comme on l'a vu récemment en ce qui concerne le Conseil constitutionnel (lors de la libération des journalistes du Cumhuriyet, ndlr). Il n'y a pas de domestication absolue et des effets parfois inattendus surgissent à certains moments.
Vous écrivez "Erdoğan s'est fabriqué une vision dichotomique du monde des médias qui oppose une presse jugée "indépendante", c'est à dire favorable à ses vues, à une presse "partisane", celle dont il pense qu'elle lui est hostile". Dans cette lutte, et malgré le fait qu'il soit arrivé au plus haut poste de l'État, Erdoğan continue à utiliser une rhétorique victimaire. Comment expliquer que celle-ci touche encore son électorat ?
J-F P : Cela fait partie de l'habileté du personnage politique : une capacité, alors même qu'il contrôle actuellement le système, à convoquer les blessures du passé qu'il faut réparer, dans une logique de vengeance, mais aussi certaines blessures imaginaires, à l'échelle internationale, pour se protéger en interne. Se présenter comme quelqu'un de menacé par l'étranger, menacé par l'Union européenne – dernièrement avec l'affaire des consuls européens et nord-américains qui ont assisté au procès des journalistes du Cumhuriyet – et brandir le danger d'être un pays victime d'ingérence. Recep Tayyip Erdoğan a une très grande capacité à jouer sur des échelles, des communautés d'adhésion différentes pour continuer à se faire passer auprès de son électorat, pour une victime, en jouant sur les épisodes passés et présents, et en ne procédant pas, peut-être, à l'analyse des rapports de forces présents la plus objective.
N. C : Et il s'aide aussi du système médiatique – le nombre de télévision favorables à ses vues est impressionnant – il ne reste quasiment plus de télévisions qui donnent des informations à peu près indépendantes sur la situation politique dans le pays, sans parler des journaux qui sont aussi largement phagocytés par le pouvoir. Quand on regarde les études qui ont été faites, par exemple, sur le public participant aux manifestations de Gezi, les gens qui étaient dans le parc recevaient leurs informations essentiellement par les médias sociaux. Alors que les opposants à Gezi, pour 80% d’entres eux, recevaient leurs informations de la télévision ou d'autres médias.
A propos des relations internationales de la Turquie, vous mentionnez le rôle d'un homme clé, Ahmet Davutoğlu, qui fut l'acteur d'un passage du pays de "partenaire périphérique du bloc occidental" à "centre d'un nouvel ensemble régional". Le Premier ministre peut-il encore avoir de telles ambitions, après les printemps arabes et l'enlisement dans la crise syrienne?
N. C : Le plan a pris du plomb dans l'aile, et le fait le plus marquant récemment a été l'affaire de avion russe abattu par la Turquie, qui a été une tragédie pour projet néo-ottoman de Davutoğlu. La première réaction de la Turquie face à la vindicte russe a été de demander la protection de l'OTAN, ce qui suppose de rentrer dans un système d'alliance et d'en respecter les règles dans une certaine mesure. D'ailleurs, les jours qui ont suivi ont vu la reprise des négociations avec Israël.
J-F P : On sent la Turquie abandonner cette prétention à vouloir jouer un rôle seul et faire entendre sa voix seule au Proche et au Moyen-Orient pour un retour aux vieilles alliances, en définitive.
N. C : Même si Erdoğan ne se prive pas de fustiger les consuls étrangers, mais on est là dans l'ordre des mots, plus que dans l'ordre des faits.
Vous décrivez l'influence de Necmettin Erbakan, premier acteur de l'islam politique en Turquie et "hoca" (maître) d'Erdoğan pendant de longues années. Pourtant, le chef de l'AKP prononce à la création du parti un discours de rupture que vous citez également: "nous ne voulons plus d’hégémonie du leader […] L’ombre du chef ne s’y fera pas sentir.”. A quel moment Recep Tayyip Erdoğan a-t-il renoncé à cette volonté de rompre avec son penchant autoritaire, si réelle volonté il y a eu ?
J-F P : Lorsque la nécessité de prolonger son "moment au pouvoir" est apparue, des calculs l'ont conduit à imaginer d'autres formules pour asseoir son autorité. Sans parler d'un “agenda caché”, Recep Tayyip Erdoğan a des dispositions pour un pouvoir autoritaire, qui vont se réanimer selon les contextes.
N. C : Très tôt, notamment d'après les comptes rendus des diplomates américains et des Wikileaks, on voit apparaître la figure d'un Premier ministre très autoritaire, très paranoïaque, qui s'entoure de sa garde prétorienne. Mais dans les premières années, il a besoin de cette image d'ouverture, de démocrate, pour servir ses interlocuteurs de l'Union européenne et dans sa lutte contre l'armée. Il en a besoin également à l'intérieur d'un parti dans lequel il n'est pas tout à fait installé, et où certaines personnalités veulent lui faire de l'ombre. Il conserve donc cette image dans les premières années, même si on voit bien qu'il a déjà une mentalité de chef autoritaire, que l'on verra apparaître au grand jour à l'approche des années 2010.
J-F P: Plusieurs facteurs on joué. Le premier est un facteur interne, au moment des élections de juin 2015 et des oppositions rencontrées face au projet du régime présidentiel. Le second est le facteur externe de la situation en Syrie. Sur le terrain, l'évolution des forces syriennes armées, et les craintes que suscitaient en Turquie l'avancées des forces kurdes en Syrie, ont poussé le pouvoir à revoir son agenda.
N. C : On peut voir ici le parfait exemple du pragmatisme d'Erdoğan. A un moment donné, la configuration de l'échiquier politique était telle que pour gagner l'électorat kurde, il fallait passer par la paix et il était prêt à la faire. Mais dès lors que le HDP (Parti démocratique des peuples) menaçait son pouvoir après les élections du 7 juin, il a joué la carte qu'il devait jouer pour conserver le pouvoir, et ce quelles que soit les conséquences. Il y a ici un aspect plus tacticien que stratège, où Erdoğan recherche sa survie à court terme et se soucie moins de l'image qu'il aura dans 20 ans.
J-F P : Ce qui n'empêche pas que l'AKP continue de pouvoir s'adresser à une classe moyenne supérieure kurde, qui se fond très bien dans la République turque actuelle et qui est d'une certaine façon complice de ce nouvel ordre qui fait partie de la "nouvelle Turquie". La population kurde de Turquie est très différenciée socialement et les discours politiques ne permettent souvent pas de la saisir dans sa globalité.
Alors que Recep Tayyip Erdoğan est assuré de rester président jusqu'en 2019, quelles pourraient être ses visées pour l'avenir ? Pourrait-il persister dans sa volonté d'établir un régime présidentiel malgré les obstacles législatifs ?
N. C : A priori le projet est de convoquer de nouvelles élections législatives, en restant toujours sur une ligne très nationaliste, de tolérance zéro contre le PKK et avec le résultat attendu de faire passer le HDP sous la barre des 10%. Mais aussi, peut-être, de faire tomber le MHP sous cette barre des 10%, ce qui ne laisserait plus que deux partis au parlement, le CHP et l'AKP, et assurerait une majorité qualifiée pour procéder à un référendum. A priori le calcul est simple et pourrait fonctionner. C'est peut-être aussi ce qui explique que de petites fissures sont en train de se créer comme l'arrestation de l’homme d’affaires Reza Zarrab (ndlr : impliqué dans un scandale de corruption qui avait ébranlé le pouvoir fin 2013) aux Etats-Unis, l'article d'un journaliste américain sur la possibilité d'un coup d'Etat en Turquie… Visiblement, il y a des gens qui agitent des signaux vers le gouvernement turc : "attention, n'allez pas trop loin".
Noémie Peycelon (www.lepetitjournal.com/istanbul) mercredi 30 mars 2016