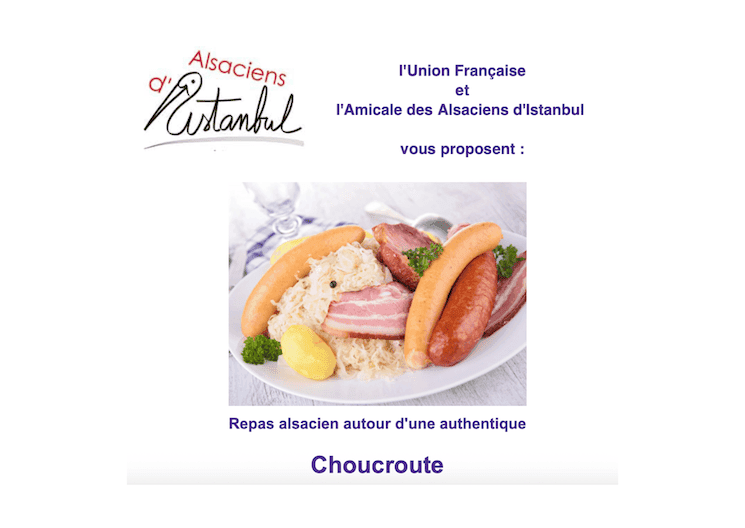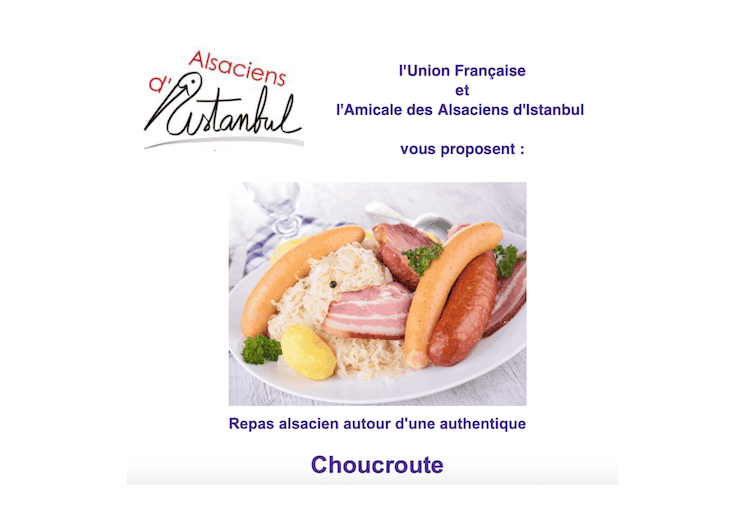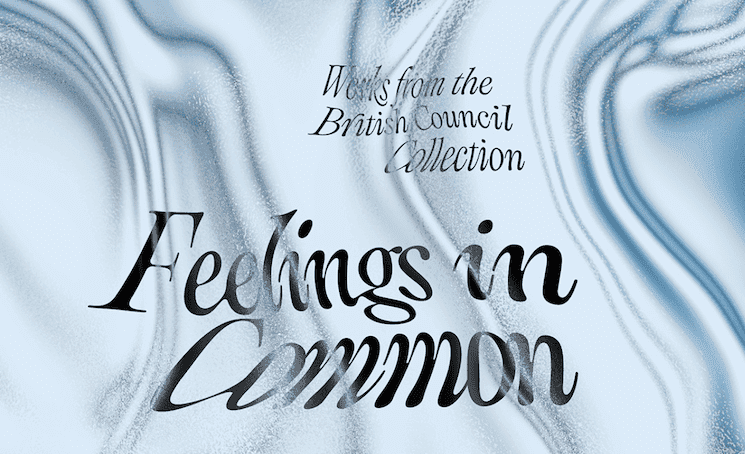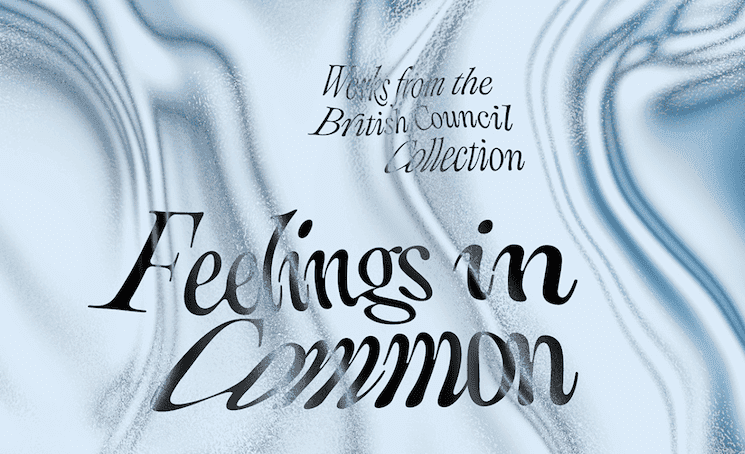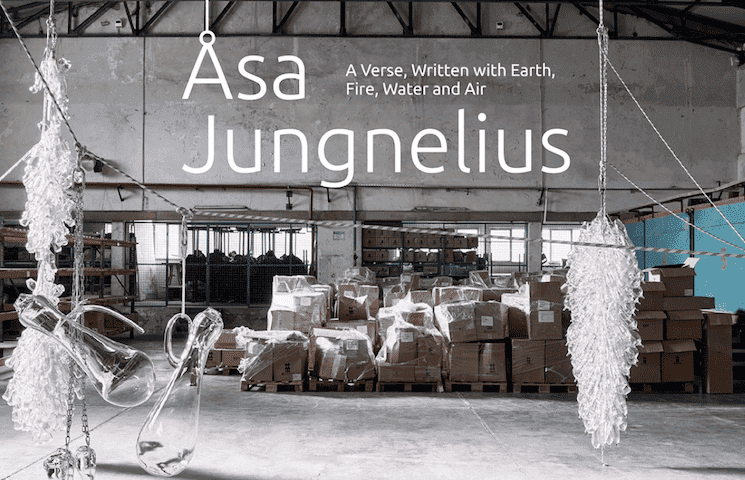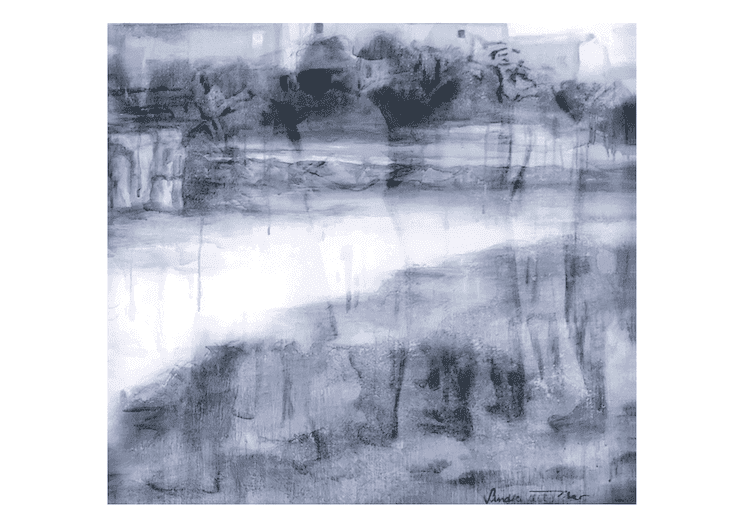Nous sommes sur la côte ouest de la Lycie, plus exactement à Fethiye, l’antique Telmessos. Au Sud de la ville, se trouve, à 8 kilomètres, la ville-morte de Kayaköy ("le village de roche"), abandonnée par sa population grecque en 1923 lors des échanges de populations faisant suite à la guerre d’indépendance de la Turquie...
Il faut voir le village de Kayaköy « le village de roche », en Lycie, pour s’en rendre pleinement compte : véritable Pompéi des temps modernes où la bêtise humaine a remplacé le volcan. La mère Fatma vous y accueille chaleureusement. Elle est la petite-fille de Turcs qui ont été expulsés de la Thrace grecque (région de Thessalonique, où est né Atatürk !) en 1923. Ses aïeux sont donc venus s’installer là, d’où la population grecque avait elle-même était expulsée. Je me suis promené dans ce village fantôme à deux reprises. J’étais transis, non par le vent glacial mais de constater ce que les identités nationales peuvent engendrer comme dégâts. Il faut le dire : une purification ethnique a bien eu lieu officiellement, avec accord de la Société des Nations, en Turquie comme en Grèce en 1923.
De la même manière, Chypre est à la même enseigne aujourd’hui comme l’ont récemment bien montré Étienne et Claire Copeaux dans leur livre Taksim, et avant eux Pierre-Yves Péchoux dans de nombreux articles. Kayaköy, cette bourgade tuée, avec ses murs, chapelles et églises en rouge et bleu. Aucune trace de tuile, si ce n’est ci et là dans les murs et pour les lieux de culte. Les toits des maisons étaient plats, faits dans un mélange de bois et d’adobe (mélange de terre et de paille), comme dans l’Antiquité et comme c’est toujours le cas dans bien des villages de Turquie où l’on fait sécher raisins, dattes, pistaches, cacahuètes ou autres abricots, ainsi que les tapis et kilims fraichement lavés par les femmes, sur les toits.

Le village de Kayaköy est désormais un site archéologique (stricto sensu) et la République de Turquie veille honorablement à respecter la mémoire de ceux qu’on a bêtement chassés voire aussi déterrés pour placer leurs restes dans un ossuaire. Et voilà la mère Fatma qui avec son sourire, parmi ses coqs, poules, chiens et chats, vous prépare dans un four à bois les meilleurs gözleme (sorte de crêpes farcies et fermées au fromage de brebis ou de chèvre) que je n’ai jamais mangés. À cet instant, on se rappelle les mots de Jacques Prévert, « Barbara… quelle connerie la guerre ! » et on a hâte de lire Louis de Bernières, Des oiseaux sans ailes, et on boit ce qu’on peut, par lâcheté, comme pour tâcher d’oublier.
J’ai pu me rendre à Kayaköy, lors d’un voyage d’agrément et surtout d’amour avec Annie Cahu, ma compagne, en février 2012, à l’aube du printemps, les cimes des montagnes lyciennes encore enneigées. Nous avons pu constater qu’il n’y avait pas de remplois antiques, alors que l’agglomération, après s’être nommée Lévissi à l’époque de son peuplement grec, est considérée comme l’ancienne Karmylessos. Des prospections (inscriptions, céramique) et des tombeaux lyciens trouvés dans les environs attestent clairement que Kayaköy/Levissi est bien l’antique Karmylessos. Il est un détail qui a échappé à bon nombre d’archéologues, historiens, visiteurs et autres : la description que fait Strabon de Karmylessos (Géographie XIV.3.5-6).
Il écrit en substance qu’après Daédala, un mont lycien, on arrive à la cité de Telmessos et à un promontoire qui a un port. Puis, on arrive à l’Antikragos, une montagne escarpée au pied de laquelle est sise Karmylessos, un endroit habité et un autre du même nom situé dans un « ravin » qui serait le repère de Chimère. Le texte en grec de Strabon est éclairant et démontre que l’historien-géographe d’Amasya a pu se confondre. En effet, Karmylessos, au pied de l’Antikragos, est sise à quelques kilomètres à pied de la mer, et domine une petite plaine alluviale. Strabon précise que Karmylessos est un chôrion (en grec), c’est-à-dire un lieu-dit, un chef-lieu de district, situé « dans un gouffre, un précipice, une vallée, une vallée profonde » (pharagx en grec). Et la Chimère serait également dans un pharagx, entre Antikragos et Kragos, ce dernier mieux connu car il domine Xanthos et son port, Patara, plus au Sud.
Le visiteur attentif pourra constater à Kayaköy, en contrebas de l’église du haut de cette ville-morte, un petit gouffre, en fait une doline où l’on perçoit des résurgences, quatre d’après observation sur le terrain, attestant clairement l’existence d’une ou plusieurs rivière(s) souterraine(s) ancienne(s) ayant créé la doline en question. Serions-nous là devant le « gouffre » que mentionne Strabon ? C’est fort probable. Somme toute, chose banale : nous sommes en relief karstique ! L’absence de constructions et la végétation dans cette doline attestent du caractère humide voire marécageux que pouvait revêtir l’endroit : présence de roseaux, autres plantes ligneuses, figuiers et platanes, autant de végétation qui a besoin d’eau.
On observe par ailleurs que Kayaköy, l’antique Karmylessos, se tourne en gradins formant théâtre vers cette doline, avec une continuation vers l’étroite plaine alluviale où d’ailleurs fut érigée une autre église orthodoxe grecque. Strabon se serait-il trompé en confondant et donc distinguant la doline et la basse-ville dans la plaine ? C’est plausible quand on constate le manque de connaissances géopolitiques de Strabon dès qu’il était hors du Pont et Cappadoce. Il me paraît probable que les deux Karmelyssos, la bourgade et l’antre de Chimère, soient à situer dans l’ensemble que compose actuellement Kayaköy: en haut, un gouffre, la doline ; en bas, une agglomération sise près de la vallée exploitée ; le tout dans un infime espace entre Antikragos et Kragos.
À quoi cette antique bourgade qu’était Karmylessos, puis Levissi, enfin Kayaköy, doit son existence ? Les résurgences, autant de grottes et de gouffres, ont toujours marqué les gens qui y voyaient – et parfois y voient toujours – l’antre d’un monstre, ou même de la Vierge Marie !, qui relierait le sous-sol au monde terrestre, voire céleste. On le voit en Cilicie avec les gouffres de l’Enfer et du Paradis, près de Kızkalesi (ancienne Korykos) qui marquent encore les esprits : c’est là que Zeus aurait vaincu Typhon, ce monstre à la fois maritime et souterrain ; aujourd’hui encore les gens, à majorité de confession musulmane, viennent faire un vœu en accrochant un chiffon ou un morceau de plastique sur les buissons surplombant les deux gouffres. Dans tout le Taurus karstique, combien de tombes antiques ne sont-elles pas présentes près de l’embouchure d’une résurgence où l’eau s’écoule ! Ce n’est plus le cas à Kayaköy, la rivière souterraine ayant semblablement décidé de changer d’itinéraire, phénomène qui, chronologiquement, pourrait avoir coïncidé avec le départ de la population grecque au début du 20e siècle. Nonobstant, à Kayaköy, l’église du haut surplombant le « ravin » de Strabon n’est pas là pour rien. Peut-être fallait-il protéger la population d’une créature dangereuse, issue des entrailles de la terre, Chimère ! On connaît bien aujourd’hui la récupération chrétienne du paganisme antique, si bien rappelée par Peter Brown dans son culte des saints (Paris, 2007).
Je me suis rendu à deux reprises à Kayaköy. Un jour sous la pluie ; un autre sous le soleil mais avec un vent glacial. Je n’ai pas été surpris de constater que, le long de la route longeant les versants de l’Antikragos et du Kragos, les grumes attendaient leur enlèvement. Le bois, pour pouvoir être bien travaillé et utilisé, doit être coupé avant que la sève ne monte dans l’arbre, c’est-à-dire avant le printemps. Nous étions à la charnière. Aujourd’hui les grumes sont transportées par camions. Mais dans l’Antiquité, comment et par où ?
On ignore souvent l’importance de l’agropastoralisme et de l’exploitation forestière. L’ancienne richesse de Kayaköy/Levissi/Karmylessos, visible au regard de ses églises et habitations, toutes peintes en rouge et bleu, vient certainement de là, au point que Strabon, géopolitologue au service du pouvoir impérial romain, mentionne l’endroit comme habité. Serions-nous donc, outre sur un lieu de culte dédié à Chimère, dans un centre-relais comme si bien défini par le géographe Pierre George? C’est plausible. De Kayaköy, on se rend aujourd’hui encore par un sentier pédestre d’une dizaine de kilomètres, qui fut jadis peut-être carrossable, à la mer, là où se trouve la trop touristique baie d’Ölüdeniz, « la mer morte » en turc. Or, c’est à cet endroit que l’on situe l’échelle de Kissidai mentionnée dans le Stadiasme de la grande mer qui indique ports et mouillages maritimes antiques. On notera l’existence en surplomb de Kayaköy d’une tour de datation incertaine ayant servi de douane à l’époque ottomane pour les marchandises échangées dans la baie d’Ölüdeniz, comme me l’a indiqué un fort sympathique gardien des lieux.
L’antre de Chimère de Karmylessos devait faire venir des gens, autant de pèlerins inquiets mais une source de richesse pour la bourgade. Pierre Debord a bien rappelé les profits que pouvaient tirer des pèlerinages les lieux de culte dans l’Antiquité. Somme toute, c’est toujours le cas – songeons à Lourdes en France –, et il existera toujours des marchands du temple. L’autre source de richesse de Karmylessos, certainement la principale, pourrait bien avoir été le commerce du bois coupé sur les flancs de l’Antikragos. Les arbres, préparés en grumes, devaient être exportés de l’échelle de Kissidai.
Revenons à Chimère, ce monstre composé, chez les Grecs, d’une tête et d’un corps de lion duquel émerge une tête de caprin, la queue de l’animal étant un serpent. Les plus anciennes attestations, sous cette forme, remontent au 8e siècle avant J.-C. L’une d’entre elles a été retrouvée sur un sceau au musée archéologique d’Adana. Son style et la pierre utilisée pour le sceau (serpentine rouge sombre) permet de l’intégrer aux sceaux appartenant au groupe chypro-cilicien dit du "Joueur de lyre" et une datation de la fin du 8e siècle est ainsi rendue possible. Ceci a son importance. En effet, à cette époque la Cilicie (région d’Adana) reste fortement marquée par l’influence hourrite qui s’y exerça pleinement au second millénaire. Or, c’est dans le monde louvito-hourrite de Syrie du Nord, à Karkémish, que l’on retrouve la plus ancienne Chimère connue, datée du 9e siècle avant J.-C. : corps et tête de lion, queue en serpent, la tête émergeant de l’encolure léonine y est alors humaine, coiffée d’une tiare.
Fille de Typhon et d’Échidna (e.g. Hésiode, Théogonie 319sqq. ; Pseudo-Apollodore, Bibliothèque 2, 31-32), Chimère, monstre chthonien crachant son feu, hantait le monde lycien, à Karmylessos comme en Lycie orientale, en Phasélide, au lieu-dit « Chimères », où elle sera vaincue par Bellérophon chevauchant Pégase. Pégase n’est autre que la forme hellénisée de l’épiclèse du dieu louvite de l’Orage, Tarhunt, si honoré en Kizzuwatna et en Tarhuntassa (Cilicie, Pisidie, Pamphylie) à l’époque hittite : Tarhunt Pihassassi y est « le victorieux à la foudre/foudroyant ». Si Bellérophon est bien représenté en Lycie dès le 6e siècle avant J.-C., on le retrouve en Cilicie à l’époque achéménide sur les monnaies de Tarse dont il passe pour être l’un des fondateurs. Sylvie Lalagüe-Dulac pense que si le caprin participe du monstre chimérique c’est parce que, pour les anciens Grecs, sa salive rendait stérile l’olivier.
Salive ou pas, je crois plutôt que le caractère prédateur des caprins, qui n’hésitent pas à monter aux arbres de faible hauteur pour ravager leur feuillage, suffit à expliquer sa présence dans la représentation du monstre. Il n’y a rien de surprenant à ce que, chez les Grecs, la tête caprine vienne remplacer l’anthropomorphisme facial hourrito-louvite de Karkémish, l’Homme étant lui-même le premier prédateur terrestre qui justement domestiqua les caprins. Il est alors intéressant de noter que de la région de Karkémish, et datée également du 9e siècle avant J.-C., provient également une boîte de fard où l’on trouve deux chimères léo-androcéphales (non coiffées d’une tiare) dont l’une précède un caprin ; par ailleurs, dans un rituel de naissance hittite (Corpus des textes hittites n° 430), on demande à Immarni (phase divinisée de développement d’une plante) « de fournir une chèvre qui servira de substitut à un humain » d’après Michel Mazoyer. C’est ainsi que, tout en signalant ma vénération pour Jean-Pierre Vernant, je préfère évoquer, à propos de la chèvre, la prédation plutôt que la sauvagerie.
Pour en finir avec Chimère, en rappelant le caractère royal que lui confère son aspect principal léonin, arrêtons-nous un instant sur son troisième aspect, serpentiforme celui-ci : la queue. Le serpent est également un prédateur, et donc un concurrent, pour l’Homme, c’est bien connu, mais pas où on l’entend généralement, à savoir directement. Si la piqûre du serpent est dangereuse pour l’Homme, elle l’est surtout pour le bétail d’où l’écobuage pratiqué par les bergers, notamment montagnards : les végétaux (notamment les fougères) incinérés sont un engrais et permettent l’accès du bétail à l’herbe nouvelle au printemps ; de plus, si le feu détruit ou chasse la vermine, en particulier les vipères qui, la belle saison venue, ne peuvent plus se dissimuler et ainsi constituer une menace pour le cheptel, il représente également un danger quant aux cultures, les forêts de résineux entres autres mais aussi les champs. Ainsi, Chimère, par l’association du caprin, du serpent et du feu, est l’incarnation du mal absolu pour les sociétés agropastorales : elle s’attaque tant aux cultures qu’aux bêtes. Kayaköy est tristement bien la chimère d’un génocide…

Bellérophon combattant, avec Pégase, la Chimère (intérieur d’une coupe du 6e siècle avant J.-C.)
Olivier Casabonne (www.lepetitjournal.com/istanbul) mardi 20 octobre 2015
Pour Annie Cahu et Martin Stern

Olivier Casabonne : ancien chercheur à l’Institut français d’études anatoliennes et au Research Centre for Anatolian Civilizations (Koç University) à Istanbul, ancien chargé de cours de français à l’Université de Çanakkale, et co-fondateur de la Societas Anatolica (www.societasanatolica.org). Il enseigne l’histoire, la géographie et les sciences politiques à Coutances (département de la Manche, en France). Outre des articles et éditions de colloques sur l’Asie Mineure, il a écrit La Cilicie à l’époque achéménide (Collège de France, Paris, 2004) ; à paraître en 2016 aux éditions Mergoil (Autun) : Asies Mineures et Anatolies des Hittites aux Pères de l’Église (19e siècle avant J.-C. – fin 4e siècle après J.-C.). Essai d’histoire et de géographie politiques et sociales (www.academia.edu > Olivier Casabonne).
Bibliographie :
- P. Arnaud, « La Lycie et la Carie du Stadiasme », Anatolia Antiqua XIX (2011), pp. 411-432.
- O. Casabonne, « Notes ciliciennes 13 : Typhonies et chimères : fragments de mythologie cilicienne », Anatolia Antiqua XI (2003), pp. 131-133 (en ligne).
- O. Casabonne, La Cilicie à l’époque achéménide, Collège de France, Paris, 2004.
- O. Casabonne, Asies Mineures et Anatolies des Hittites aux Pères de l’Église (19e siècle avant J.-C. – fin 4e siècle après J.-C.), Essai d’histoire et de de géographie politiques et sociales, éditions Mergoil (à paraître en 2016).
- J.-J. Cazaurang, « Bergers à l’hivernage », Revue régionaliste des Pyrénées 159-160 (1963), pp. 183-205.
- P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l’Anatolie gréco-romaine, Paris, 1982.
- S. Lalagüe-Dulac, « Typhon, doublet cilicien d’Héphaïstos ? », dans M. Mazoyer et O. Casabonne (éd.), Studia Anatolica et Varia, Mélanges offerts au Professeur René Lebrun, Paris, 2004, pp. 13-28.
- S. Lalaguë-Dulac, « La Chimère, un lieu de culte original pour le dieu Héphaistos », dans R. Lebrun (éd.), Hethitica 15, Louvain, 2002, pp. 129-161.
- D. Lenfant, « Le feu immortel de Phasélis et le prétendu volcan Chimère : les textes, le mythe et le terrain », dans J. Wiesehöfer et alii (éd.), Ktesias’ Welt/Ctesias’ World, Wiesbaden, 2011, pp. 225-246.
- M. Mazoyer, La vie cultuelle du dieu hittite Télipinu, Paris, 2011, p. 103.
- J.-P. Vernant, La mort dans les yeux, Paris, 2002.