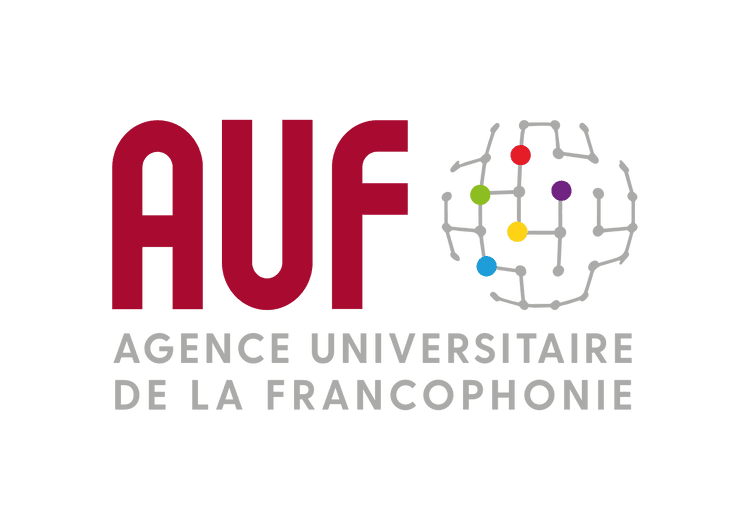Trente ans après la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing, la mémoire de cet événement fondateur refait surface à l’occasion de la 46ᵉ Conférence ministérielle de la Francophonie, tenue à Kigali. Aujourd’hui Présidente du CADO, Danièle Toulemont y était en 1995, comme responsable de la communication de l’ACCT. Elle raconte, de l’intérieur, l’un des plus puissants moments fondateurs de l’histoire contemporaine des droits des femmes — entre diplomatie feutrée et effervescence citoyenne.


C’était à la fois festif et studieux. Une véritable confrontation d’idées dans une atmosphère de kermesse.
Vous étiez à Beijing en 1995. Dans quel cadre exactement ?
J’y étais en tant que responsable de la communication de l’ACCT, l’Agence de coopération culturelle et technique, qui est devenue depuis l’Organisation internationale de la Francophonie. Cela m’a permis de suivre à la fois la conférence institutionnelle officielle et le Forum des ONG. Très vite, j’ai ressenti un contraste saisissant entre ces deux mondes.
Quel contraste précisément ?
D’un côté, il y avait la conférence officielle à Beijing, dans une atmosphère très guindée, éminemment diplomatique. Les discours s’y succédaient, souvent en langue de bois, rythmés par des promesses solennelles, très codifiées. Tout était extrêmement protocolaire.
Et puis, à cinquante kilomètres de là, à Huairou, c’était un tout autre univers. Une ambiance électrique, joyeuse, foisonnante. Des conférences improvisées, des rencontres organisées ou totalement spontanées. Une effervescence continue. C’était à la fois festif et studieux. Une véritable confrontation d’idées dans une atmosphère de kermesse.
Beijing 1995 : le jour où les femmes ont imposé leur voix au monde
Comment décririez-vous ce Forum des ONG de Huairou ?
Le Forum occupait un vaste complexe d’exposition, entouré de tentes temporaires, de salles de conférence, d’amphithéâtres, avec de grands espaces extérieurs pour les stands, les débats, les concerts, les expositions. Pendant deux semaines, cela s’est transformé en un véritable « village mondial des femmes ». Toutes les langues du monde s’y parlaient.
Plus de 30 000 participantes issues d’associations et de mouvements féministes s’y sont retrouvées, avec plus de 500 ateliers, tables rondes, réunions stratégiques, actions culturelles. L’objectif était très clair : échanger, formuler des propositions, exercer une pression politique.
Cette séparation physique entre gouvernements et ONG a souvent été critiquée. Avec le recul, quel est votre regard ?
Elle a été critiquée, oui. Mais sur le moment, elle a aussi permis une liberté d’expression totale pour la société civile. À Huairou, les idées jaillissaient sans filtre. Certaines pouvaient paraître utopistes, mais beaucoup étaient profondément constructives. Cette distance a favorisé une créativité politique exceptionnelle et la naissance de réseaux durables entre des femmes venues de tous les continents.
L’influence des ONG sur les décisions finales a-t-elle été réelle ?
Elle a été décisive. Les ONG ont transmis leurs revendications aux délégations gouvernementales de manière continue. Certaines de leurs représentantes ont même été intégrées dans des équipes officielles. Les médias et les réseaux féministes ont amplifié cette dynamique. Et surtout, les gouvernements ont repris plusieurs propositions issues directement du Forum, notamment sur les droits sexuels, la lutte contre les violences et l’éducation des filles.
La Plateforme de Beijing est véritablement née de cette interaction permanente entre la diplomatie et cette pression citoyenne.
Que représentait Beijing sur le plan politique mondial ?
La Déclaration et le Programme d’action adoptés en 1995 constituent encore aujourd’hui le cadre le plus complet jamais élaboré pour parvenir à l’égalité des droits pour toutes les femmes et toutes les filles. Cent quatre-vingt-neuf gouvernements l’ont approuvé. Le programme s’organisait autour de douze grands domaines : l’économie, l’emploi, la participation politique, la paix, l’environnement, la lutte contre les violences, l’éducation. C’était une architecture globale, extrêmement ambitieuse.
Quel a été le rôle spécifique de la Francophonie à Beijing ?
L’ACCT a joué un rôle important pour faciliter la présence des pays francophones du Sud, mais aussi celle des associations. Elle a coordonné cette participation aussi bien dans les espaces officiels que sur le Forum. Sous l’impulsion de pays comme le Canada, la France et le Sénégal, la Francophonie a défendu une approche inclusive, attentive aux dimensions culturelles et linguistiques des politiques d’égalité. Elle a aussi soutenu la formation des déléguées, apporté un appui logistique et favorisé la création de réseaux de femmes francophones.
Trente ans plus tard, la Francophonie s’est réunie à Kigali sur le thème de Beijing. Que vous inspire ce retour mémoriel ?
La 46ᵉ Conférence ministérielle de la Francophonie, tenue les 19 et 20 novembre à Kigali, avait pour thème : « Trente ans après Beijing : la contribution des femmes dans l’espace francophone ». C’est un choix très fort. Il marque à la fois l’héritage assumé de 1995 et une inquiétude latente face aux reculs observés aujourd’hui. Dans un monde traversé par les crises, les conflits, les pressions économiques et démocratiques, la vigilance reste essentielle.
Avec le recul, que représente aujourd’hui Beijing dans votre parcours personnel ?
Beijing a été un moment fondateur. J’y ai vu ce que pouvait produire la rencontre — parfois tendue, mais féconde — entre la diplomatie et la société civile. J’y ai vu naître une force collective mondiale. Cet héritage irrigue encore aujourd’hui mon engagement. Les principes posés en 1995 structurent toujours les combats actuels. Rien n’est jamais définitivement acquis.
Trente ans après, quel message souhaitez-vous transmettre ?
Beijing nous rappelle que les grandes avancées ne viennent jamais uniquement des sommets diplomatiques. Elles naissent aussi de l’énergie citoyenne, de la confrontation des idées, de cette effervescence collective parfois joyeuse, parfois désordonnée, mais toujours vitale. C’est cette articulation entre institutions et société civile qu’il nous faut préserver aujourd’hui.
Sur le même sujet