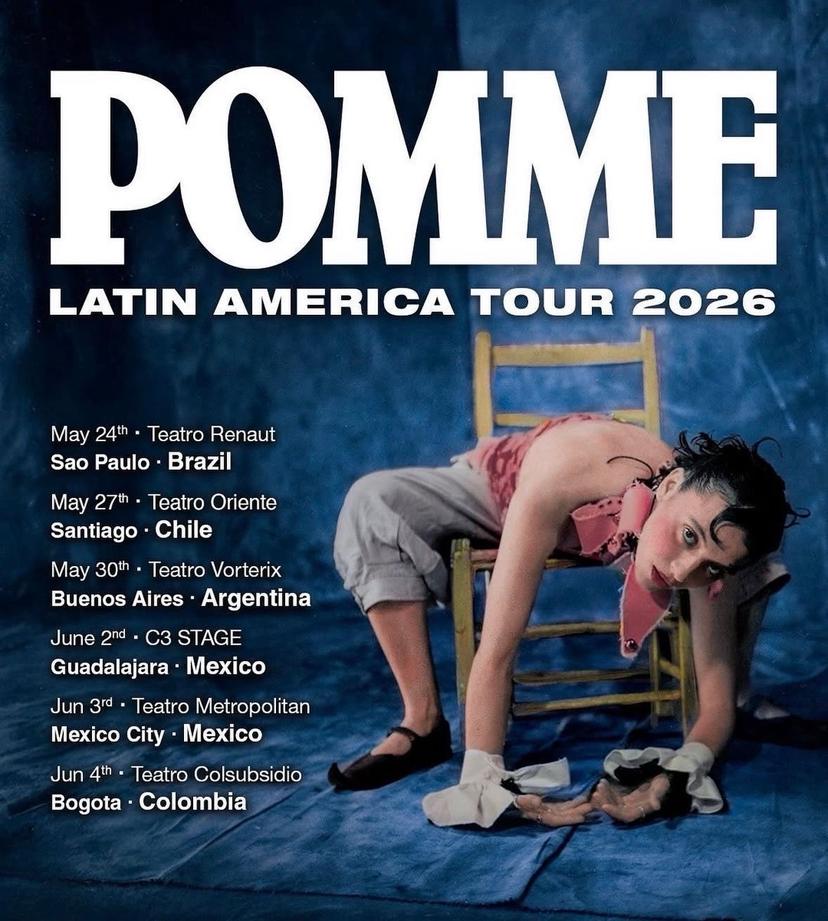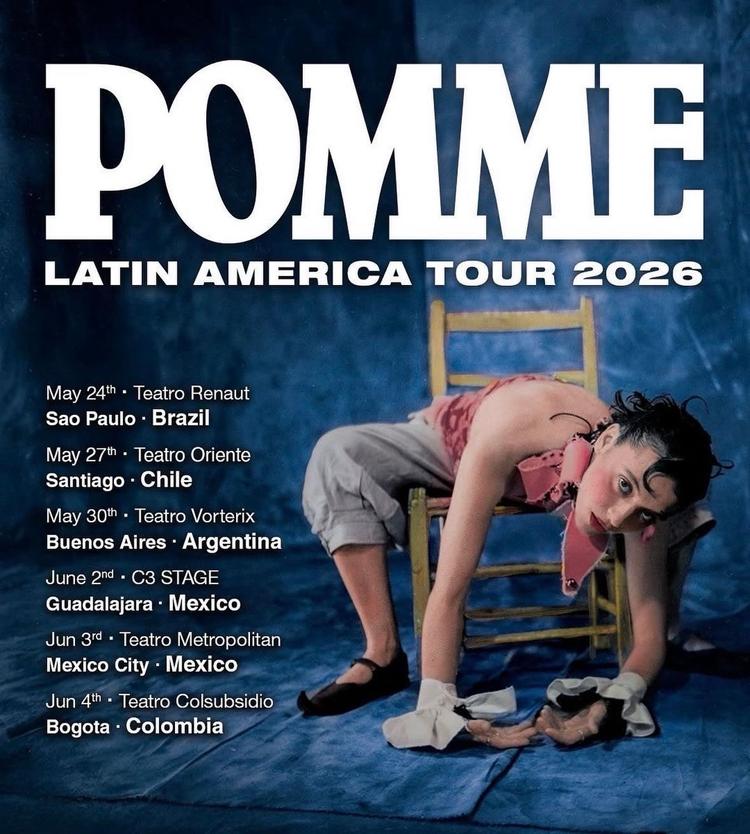La danse comme arme politique, c'est un peu l'orientation qu'ont choisi élèves et professeure de ce cours de Tango Queer. Un tango qui refuse les traditions et se danse sans distinctions de genre ou de sexe.


Sur la musique La Uva du groupe La Chicana, Marta et Zoé, deux femmes, dansent le tango. Marta guide. Au milieu de la musique, les rôles s’inversent. Zoé prend le relai et mène la danse. Autour d’elles, des posters, des drapeaux et des affiches LGBTQIA+ décorent les murs. On peut lire “Orgullo” ; “Life Gets Better Together” ou bien “Love” aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ici, au Batacazo Cultural, on apprend à danser le Tango mais pas n’importe lequel : le Tango Queer. Dans cette classe, on retrouve surtout des femmes. Retraitées, trentenaires ou encore jeunes étudiantes, toutes se donnent rendez-vous dans ce centre culturel pour apprendre à danser. Guidé·e ou être guidé·e, se prendre dans les bras ou se tenir les mains, partenaire masculin, féminin ou non binaire, chacun·e danse comme iel en a envie. Le Tango Queer bouscule les codes hétéronormés.
Première milonga de Tango Queer en 2006 à Buenos Aires
Lucia - appelée “Lu” par ses élèves - est prof de Tango depuis 12 ans. Elle donne des cours de Tango Queer les mardis soir de 19h à 21h. Dans ses classes, elle propose une autre manière d’occuper l’espace et de s’accompagner. “C’est un entraînement corporel mais aussi social et culturel” me confie t-elle. En enseignant cette alternative, elle souhaite “transmettre le tango sans reproduire les stéréotypes de genre”. Une relation plus juste, plus égale où “l’intention du corps est la priorité”. La prof de danse a découvert le Tango Queer en 2006 avec la milonga de Mariana Docampo à Buenos Aires dans le quartier de San Telmo. Il s’agit du tout premier événement de Tango Queer d’Argentine. Elle a ensuite participé au festival “Tango Queer” organisé l’année d’après par 3 danseur·e·s argentin·e·s dont Mariana Docampo, Roxana Gargano et Augusto Balizano. Lu s’est directement sentie plus représentée dans cette catégorie. Elle-même LGBTQIA+, le tango Queer lui permet de ne pas reproduire un schéma hétéropatriarcal. Ainsi, elle peut danser à sa manière sans devoir correspondre à des rôles binaires et suivre des dynamiques de genre. Après avoir fait “un travail de remise en question sur sa manière de danser et un processus de déconstruction”, elle se sent apte à apprendre ce tango alternatif. Elle souhaite que ses classes soient une safe place : un espace inclusif ou chacun·e se sente à sa place.
Au XIXème siècle le tango se danse entre hommes
À l’origine, cette danse de couple se pratique entre personnes du même genre et plus précisément, entre hommes ! À la fin du XIXème siècle, faute de trouver des partenaires féminins, les hommes dansent entre eux le tango dans les quartiers populaires de Buenos Aires et Montevideo. Ce n’est qu’au XXème siecle, avec son exportation en Europe et son appropriation dans les milieux bourgeois argentins, que le tango devient hétéronormé : l’homme guide et la femme suit. Le tango Queer fait donc intrinsequement parti de l’histoire du tango ! Cependant, le terme “tango queer” tel qu’on le connait fait son apparition à partir des années 2000 avec la réappropriation de la pratique par la communauté gay et lesbienne. Ce n’est qu’en 2001 qu’est organisé le tout premier festival de Tango Queer : le Internationales Queer Tango Festival Hamburg en Allemagne. Depuis, le mot Queer (bizarre en anglais) est resté. À la base, il est utilisé pour désigner les personnes se considérant LGBTQIA+. Dans le cas du tango, il sonne comme synonyme de “non binaire”. Pour autant, pas besoin de se revendiquer “queer” pour danser le tango queer. Il s’agit avant tout d’un espace militant, inclusif et artistique. Lu le confirme, dans ses classes, peu importe le genre et l’orientation sexuelle de ses élèves : tous et toutes sont les bienvenu·e·s.
Sur le même sujet