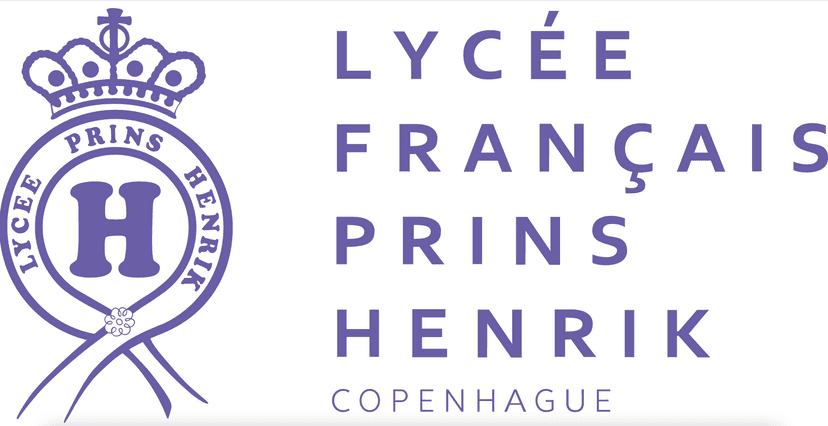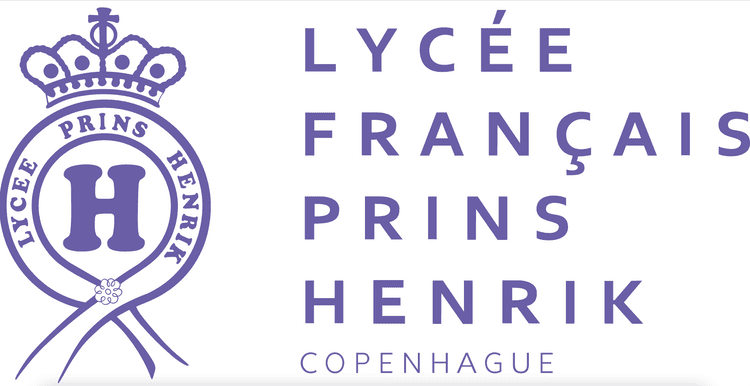Retour après avoir revu dans le cadre de La Cinemateket Un amour de jeunesse, séance en présence de la réalisatrice encore toute jeune (dont les 7 longs-métrages constituent déjà un corpus cohérent et singulier) mais qui n’a pas dit son dernier mot.

Il y a dans ce cinéma un désir d’absolu, quitte à se perdre (la drogue par exemple ou plus simplement le chagrin). Le héros d’Un amour de jeunesse est un pataud ; il est déboussolé face à l’exigence exclusive de celle qu’il aime, il finit par décamper loin d’elle, non tant pour la fuir cependant que pour se réaliser. Tiraillé entre celle qui se donne sans compter (on ne joue pas et on ne minaude pas dans cet univers) et son envie de se découvrir en allant à l’étranger, il ressemble décidément beaucoup au Gaspard de Conte d’été (1996) de Rohmer, mais comme une pâle copie. Un fantôme hante en effet ce cinéma, celui d’un être et d’un univers perdu.
Mais si l’amour ne repasse pas, il ne passe pas non plus. En revanche la vie n’y est pas avare en rencontres, qui offrent une seconde chance, différente. Les héros ne sont pas prédestinés au malheur, ils sont en voie d’incessante recomposition. Tout est possible dans ce cinéma, même après une disparition brutale (mort ou départ). Mais la peine n’est pas occultée. La douceur le dispute à la cruauté dans des films où les larmes adviennent au détour d’une phrase, d’une décision imposée et donc subie par d’autres. La consolation – impossible – n’est pas une promesse de ce cinéma. Mais la beauté du monde, la sensualité des paysages, le rayonnement de la lumière sont autant d’alliés dans cet apprentissage d’un art de vivre qui permet de soulager la douleur, de féconder la créativité. Pourtant il arrive que le passé revienne sans crier gare et rattrape intimement celui qui tentait de s’en accommoder. Mais alors un chapeau est emporté par le courant comme dans Les Amours d’Astrée et de Céladon (2007), l’ultime film de Rohmer. La préciosité n’entache pas les films de la jeune cinéaste, clairs comme de l’eau de roche, bien qu’elle s’attelle souvent à l’opacité des sentiments. Elle sait élargir l’horizon qu’elle filme pour nous emporter dans son sillage intime loin de toute complaisance narcissique malgré la teneur ouvertement autobiographique de son cinéma. Son prochain film Un beau matin (2022) compte dans sa distribution rien de moins que Pascal Gregory et Melvil Poupaud (le Gaspard de Conte d’été). Il n’y a guère qu’Ozon pour avoir fait de l’œil aussi ouvertement à Rohmer dans Le Refuge (2010). A l’heure où Audiard confie (on se pince un peu pour y croire) que Ma nuit chez Maud (1969) est son film préféré à l’occasion de la sortie de son dernier film Les Olympiades, on se dit que décidément Rohmer continue d’être un passeur et a intimement formé toute une génération. Mia Hansen-Løve, elle, revendique Le Rayon vert (1986) comme source d’inspiration marquante (et comment ne pas l’approuver ?). Dans Un amour de jeunesse, le père bienveillant qui apparaît furtivement est joué par Serge Renko, l’acteur rohmérien de Triple agent (2004). En revanche Valérie Bonneton en mère désolée et exaspérée par les états d’âme de sa fille apporte le bon sens et le prosaïsme qui font la saveur de sa persona d’actrice qui triomphe dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Mais à quoi bon donner des conseils en amour, comme si ça servait à quelque chose ! La réalisatrice s’en garde bien, laissant ses héros pourtant inspirés par sa propre vie, se dépatouiller de leurs contradictions. La légèreté permet de souffler, de desserrer l’étau. Ne minimisons pas ces chassés-croisés de l’amour et du hasard qui nous livrent une actrice à fleur de peau, Lola Créton. Mais toutes les héroïnes de son œuvre sont incarnées par des actrices plus rayonnantes les unes que les autres, qu’elles aient le premier rôle ou un rôle secondaire (Alice de Lencquesaing, Pauline Etienne etc.).
L’ombre de la mort plane, particulièrement celle d’autant plus inquiétante du suicide ….au cœur des films, ici comme ailleurs. La réalisatrice ne cache pas l’origine de cette mélancolie dont elle a hérité, son grand-père danois, ayant mis fin à ses jours et surtout elle ne délègue pas lâchement le mal de vivre à ses seuls personnages, assumant cette pesanteur qu’elle dit retourner en son contraire par la création cinématographique... Cela éclaire entre autres mobiles l’impérieuse nécessité de rendre hommage dans Le père de mes enfants (2011) à Humbert Balsan, producteur disparu trop tôt, dépassé par ses difficultés professionnelles et financières (mais probablement en butte à une pulsion destructrice remontant à plus loin), dont la rencontre fut décisive pour ses débuts de cinéma.
Lors de la séance à la Cinemateket après la projection du 13 novembre, les questions n’ont pas manqué. Elle balaie d’un revers de main l’interrogation sur son expérience de critique de cinéma aux Cahiers du cinéma et n’en fait pas grand cas, laissant à d’autres le mérite de s’enorgueillir de leur plume. Elle va jusqu’à parler de cauchemar pour évoquer son rapport à l’écriture critique. Comme mise à la torture quand il s’agit d’analyser les autres, elle s’affermit et s’épanouit en revanche dans son rôle de réalisatrice. Pourtant sa douceur, sa fragilité apparente ne payent pas de mine, c’est aussi ce qui fait tout son charme.


C’est un casting dans son lycée qui permet au cinéma de faire irruption dans sa vie et de la bouleverser. Elle reconnaît volontiers sa dette cinématographique à l’égard de son mentor Olivier Assayas qui fut longtemps son compagnon. Elle évoque les conversations passionnées sur le cinéma qui ont alimenté leurs rapports conjugaux. Elle était habituée aux débats antagonistes de ses parents, professeurs de philosophie, qui lui ont cependant transmis le goût de penser par soi-même, dit-elle (quel meilleur héritage ?). Entre Rousseau, auteur de prédilection de sa mère et Kant, Nietzsche, Kierkegaard qu’aimait son père, elle ne tranchera pas. Mais sa gratitude est palpable, même si elle ne reprend pas le flambeau philosophique. Ou plutôt, à travers son cinéma, elle ne cesse de questionner le sens de la vie par des plans, par sa façon de s’attarder sur un visage qui s’illumine, d’y lire un regret, l’esquisse d’un sourire.
Lors de cette rencontre débat avec le public de Copenhague, elle est discrètement accompagnée de sa fille. Les enfants comptent en effet dans cette œuvre et ne sont pas quantité négligeable. Ils brillent au firmament du titre de son film Le père de mes enfants (film de 2009 qui reste notre préféré) mais ils viennent surtout remplir de leur gaieté et de leur tendresse le monde des plus grands comme dans Tout est pardonné (2007).
Son cinéma fait la part belle au langage mais elle ne se paye pas de mots. Il lui arrive de faire entendre les paroles de poèmes qui sont dépositaires d’un sens et d’un mystère (sans qu’ils ne résolvent un mystère quelconque)…Elle refuse les sacralisations abusives de tout ordre. Bergman n’est pas mythifié dans le film Bergman island qu’elle lui consacre sans idolâtrie, sachant se moquer tendrement du culte rendu à l’Auteur. Une virée touristique en autocar constitue le sommet humoristique de cet hommage non dépourvu d’irrévérence.
Tout en se livrant sans garder jalousement ses secrets, la cinéaste ne tombe pas dans le piège d’une confession qui déflorerait l’œuvre. Et pour cause, fiction et réel valsent ensemble et sont parfois bien difficiles à démêler. Surtout si les spectateurs y ajoutent leurs propres incertitudes ou joies, ce à quoi invitent ses films. Mais elle n’hésite pas à rassurer l’une d’entre elles ce samedi de novembre danois sur le sort final d’une de ses héroïnes, avenir ouvert. Ouf !
Une vieille dame, que croise dans les escaliers d’Eden (2015) le héros ramené mal en point chez lui par ses fidèles compagnons de fêtes sans lendemains, s’exclame avec sarcasmes : « C’est beau la jeunesse ! ». Il sort alors de sa léthargie pour s’époumoner et lui clouer le bec : « j’ai 34 ans ! ». C’est en effet tout le problème d’une jeunesse qui s’éternise ! Mais Mia Hansen-Løve pose cependant un regard tendre sur ses personnages tout à la fois perdus et obstinés en réalisatrice éprise de ces années d’élan (parfois brisé).
Les héros de Mia Hansen-Løve n’ont pas toujours prise sur le monde : il arrive que tout leur échappe (les filles, le talent, l’argent, l’enfant avorté etc.). Dans Eden inspiré de la vie de son frère Sven, DJ garage au moment du succès de la French Touch, on retrouve à un moment le personnage principal nommé Paul en position de fœtus sur le tapis à pleurer sur le gâchis de ses chances, comme en escargot….Mais rien n’est irrémédiablement perdu, on se replie sur soi pour renaître à mesure que le temps passe, qu’enregistre aussi ce cinéma. Le cheminement attend chacun au-delà des épreuves qui, si elles ne les renforcent pas, rendent ses personnages bel et bien émouvants par leur fragilité et leurs certitudes à quoi ils s’accrochent.
Dans Un Amour de jeunesse, vous découvrirez des scènes tournées à Copenhague : à Louisiana et au snail d’Amager strand baigné d’une magnifique lumière. Curieux effet de reconnaissance qui parasite pour les familiers de ces lieux l’échappée dans l’ailleurs. Mais c’est en effet à un retour à soi qu’invite délicatement ces films.

La cinéaste reconnaît que l’éloge critique dont elle bénéficie dans le monde entier l’aide à faire exister ses films. Mais elle dit cependant que son public d’aficionados est restreint. C’est donc le moment de venir grossir les rangs de ceux qui, déjà, et ils sont nombreux, quoi qu’elle en dise modestement, aiment son cinéma. Ceux qui n’ont pu découvrir son dernier opus en salles en France ou en avant-première dans la capitale danoise devront attendre le printemps. Mais il reste deux projections à la Cinemateket, de films antérieurs dans le cadre de la rétrospective qui lui est consacrée et touche à sa fin.
Je me réjouis donc quant à moi d’y découvrir Maya prochainement, occasion aussi de retrouver le fils de Marie Trintignant à la beauté grave (je parle autant de l’une que de l’autre), Roman Kolinka (qui jouait déjà dans les précédents films Eden et dans L’Avenir avec Isabelle Huppert).
Si l’appellation de « mère au foyer » n’est pas insultant à nos yeux contrairement au point de vue de l’héroïne de Bergman island interprétée par Vicky Krieps, habitée de doutes quant à la valeur de sa création artistique et lançant alors cette alternative de vie comme une hypothèse non envisageable, la pire des malédictions, nous interdisons cependant formellement à Mia Hanse-Love de le devenir ! Longue vie à la cinéaste !
A (re)voir donc à la Cinemateket :
Goodbye first Love le samedi 20 novembre à 16h30.
Maya (2018) le mercredi 24 novembre à 19h.
Sur le même sujet