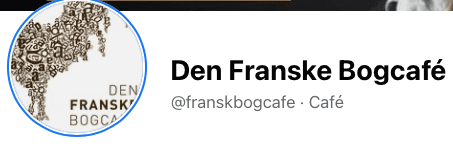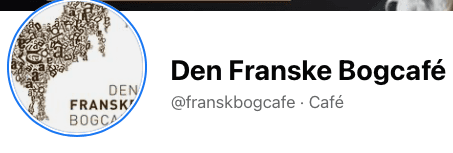Violaine Camina de Schuytter, agrégée de lettres modernes et docteure en études cinématographiques, nous invite à prendre du recul face à la situation que nous vivons actuellement et à nous retenir en mettant en résonance des grandes oeuvres de la littérature, du cinéma, des auteurs et une comédienne.
Je me souviens d’un voisin qui venait d’être à la retraite. Chaque jour il lavait sa voiture à grandes eaux, avec une application de plus en plus suspecte. On finissait par repousser le moment de sortir pour ne pas le croiser et être témoin de son désarroi face au vide de cette relégation à la maison. Est-il si déraisonnable pourtant d’astiquer tout ce que l’on a sous la main dans pareil cas ? Ce voisin aurait pu en effet être hypocondriaque à la place et harceler son médecin, donnant raison à l’écrivain Céline (emprisonné soit dit en passant à Copenhague) : « Tu les crois malades ,...Ca gémit...ça rote....ça titube....ça pustule...Tu veux vider ta salle d’attente ? Instantanément ? même de ceux qui s’en étranglent à se ramoner les glaviots ? ... Propose un coup de cinéma !...un apéro gratuit en face !...tu vas voir combien qu’il t’en reste....S’ils viennent te relancer c’est d’abord parce qu’ils s’emmerdent. T’en vois pas un la veille des fêtes...Aux malheureux, retiens mon avis, c’est l’occupation qui manque, c’est pas la santé.... » Ces propos provocateurs de Mort à crédit (1936)1 ne sont pas que le fruit d’une expérience de médecin, mais aussi et surtout une variation grotesque sur le thème pascalien de l’ennui.
Me préparant à m’expatrier au Danemark et laissant ma bibliothèque à Paris, il m’a fallu choisir quelques livres seulement. Pas de Giono (Le Hussard sur le toit) dans mes bagages, encore moins le Camus scolaire. La peste et le choléra étaient donc résolument restés en France au profit de livres plus exaltants à mon goût : pour en rester à Camus, sa passionnante correspondance avec Maria Casarès ; en cas de coup dur, rien de tel, pour se revigorer, que de se réchauffer à la flamme de ces deux-là, me disais-je. Illusion cependant de croire pour autant être à l’abri de toute épidémie, y compris littéraire. Car comme il est dit des habitants d’Alphaville (1965), ils « ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés ». Ce film du plus moderne de nos cinéastes, Godard, cite ici, l’air de rien, et littéralement, un de nos moralistes les plus classiques : « Les Animaux malades de la Peste » de La Fontaine (Pascal n’est, il est vrai pas en reste dans ce film de science-fiction ni Céline). La Fontaine se servait de la peste pour conter une fable politique avec son insolence coutumière, filtrée par l’ironie car chaque époque appelle ses types de masques, la ruse étant parfois nécessaire pour ne pas s’exposer aux représailles de ceux qui sont éclaboussés par la critique. Qui ne connaît pas cette fable et le sort réservé à l’âne, bouc-émissaire désigné ?
La littérature est en effet un curieux virus qui se propage d’oeuvre en oeuvre, de siècle en siècle, à une condition cependant et non des moindres : qu’elle soit transmise et comment le faire sinon en en vivant soi-même intensément ? C’est le cas de Maria Casarès, qui n’a cessé d’incarner avec ferveur ses rôles au théâtre. Elle raconte avec humour à son amant, qui est aussi l’auteur de la pièce qu’elle interprète, les inconvénients auxquels l’expose parfois sa vocation : « J’ai failli quitter la scène pour offrir à un monsieur de premier rang des pastilles Valda, un mouchoir pour étouffer sa toux ou bien deux places pour revenir une autre fois, quand il irait mieux. Je me suis retenue. » 2 Elle s’est « retenue ». On toussait donc déjà en 1950. Mais on y toussait sans conséquence notable sinon l’exaspération de l’actrice sous les feux de la rampe. Les toux, sources de dérangement, sont rarement bienvenues mais pas toujours susceptibles de déclencher suspicion ou pire, hostilité. On comprend donc ici qu’on est en temps de paix, où l’on se « retient », où l’on reste civilisé même face à l’impolitesse d’un spectateur qui eût pu rester par courtoisie chez lui. Mais qu’un temps de guerre survienne et la brèche est ouverte dans laquelle peuvent s’engouffrer tous les maux.
Camus raconte qu’il a dû passer la soirée, lui qui déteste les mondanités ( « tu sais que la société au-dessus de quatre personnes m’épuise », dit-il en parfait candidat au confinement...) avec une personne dont la mère venait de mourir. Or il n’a cessé, voulant parler de « n’importe quoi », être futile, alléger l’atmosphère, de ressasser des anecdotes toutes plus macabres les unes que les autres (qui n’a jamais fait sans le vouloir preuve d’une telle indélicatesse ? Nul besoin d’être un incorrigible gaffeur pour s’être trouvé pris dans un tel engrenage dont on ne peut pourtant que se blâmer soi-même). Il termine la soirée par cette histoire de Chamfort où un médecin parlant de son malade trépassé dit : « il est mort , sans doute, mais il est mort guéri » ; ce qui change tout ! Et Camus conclut à l’intention de sa correspondante : « Je me suis couché désespéré, à demi mort de confusion et de fatigue »3. « A demi » nuance avec honnêteté un repentir sûrement sincère mais néanmoins superficiel. Nos expressions courantes exagèrent trop souvent ce que l’on dit.
Pourtant, au détour d’une autre lettre (le volume fait 1300 pages mais O combien vivantes), cette confession qui n’est pas de la fausse modestie reflète la difficulté du métier d’écrivain qui cherche les mots justes : « Le doute, voilà tout, et un découragement général. Je me dis que j’ai eu la même crise en terminant La Peste, que je ne voulais pas publier. »4 Le sort de ce roman écrit pendant la deuxième guerre mondiale a donc tenu à peu, comme souvent la vie, à un fil, qu’une toux peut balayer. Eu égard à tous ceux qui seraient démoralisés face à l’ampleur ou au caractère éprouvant de leur tâche, il serait donc indécent de « mourir » d’ennui.
Place à la vie ! A vos livres, à vos écrans, à votre ménage...! Et si ce n’est pas, plus, pas encore, le moment de « traînasser » au soleil, activité de prédilection de Camus, récréation sensuelle et bénie qu’il s’accorde en pur méditerranéen, lui, le tuberculeux contraint à composer avec sa maladie, retirez-vous chez vous et en vous pour y faire soleil : restons sagement confinés, mais des confinés heureux !
1 Céline, Mort à crédit, Folio, 2018, p. 23.
2 Albert Camus-Maria Casarès, Correspondance, Gallimard, 2017, p. 201.
3Albert Camus-Maria Casarès, Ibid., p. 352.
4 Albert Camus-Maria Casarès, Op. cit., p. 734.
Sur le même sujet