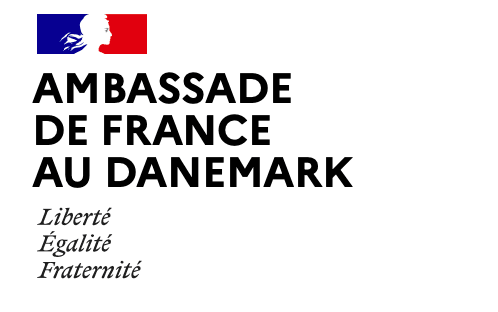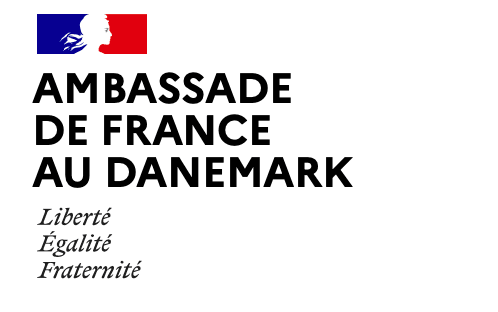L’attrait pour l’infrarouge est né chez moi pendant les premiers cours de physique-chimie du collège. Me demandant à quoi pouvaient bien ressembler les couleurs que l’on ne peut pas percevoir, je gardais en tête la lubie d’un jour les voir.
En été les réflexions infrarouges apportent une brillance particulière aux feuillages, mais à Copenhague ceux-ci se font toujours attendre passé fin mars. L’expérimentation de cette plage d’ondes commence sur le toit, soleil direct.

Premier élément à remarquer dans la photographie infrarouge est le hotspot :

Comme on le voit sur ces clichés et comme on le verra sur les clichés suivants, une « bonne » optique pour la photo de portrait ou de paysage ne le sera pas forcément en infrarouge, pour cause de cette anomalie laissant apparaître un épais vignettage s’épaississant à mesure que se ferme le diaphragme. Mais les défauts en art n’en sont jamais totalement.

Second élément à prendre en compte est la couleur. Cela ne vous aura pas échappé : l’infrarouge est la partie non-visible des rayonnements lumineux, de plus faible fréquence que les ultraviolets aux antipodes du spectre. Si quelques rayons de lumière visible peuvent dans l’absolu parvenir dans le capteur, le filtre Hoya R72 que j’utilise bloque ceux de fréquence inférieure à 720 nanomètres (d’où son nom). Il n’y a techniquement pas grand-chose de plus à savoir : la balance des blancs doit être ajustée, et hop ça roule.

Ca roule et passe au rouge. Aïe. Exit les tons naturels : ceux-ci ne passent pas. D’où la nécessité d’un équilibrage, passant soit par un le monochrome, soit par une atténuation du rouge en teintes de jaunes et bleus – en fonction de la chaleur souhaitée - , soit par une exploitation surréaliste des teintes qui ne sauraient en aucun cas être vraiment celles que je vous donne à voir.

Ici nous voyons un lever de soleil à Amager Strand lorsque les glaces régnaient encore sur les eaux. Je vous invite à lire mon article précédent pour en voir mes clichés traditionnels.

Le troisième et dernier point à prendre en compte est la durée d’exposition. Le capteur est fait pour avaler de la lumière visible et l’infrarouge en est exclu : les vieux boîtiers non-traités offrent une tolérance bien plus grande ; cependant, avec un filtre si opaque -tenu en face du soleil on ne voit presque rien au travers- il ne faut pas espérer capturer la netteté à main levée.
Ma première sortie au coucher de soleil pour prendre les néons de Dronning Louises Bro se reflétant sur les lacs fut couronnée d’insuccès : malgré les trois minutes d’exposition et l’ouverture au maximum, trop peu de lumière dans le full frame. Quelques traits et encore, il suffit de tenter l’équilibrage des couleurs pour qu’ils fondent dans les réglages de la chaleur.
Si après cet article vous êtes tentés par la photographie infrarouge, courrez vers un aperçu surexposé : la lumière n’est pas ce qu’on croit quand on ne peut pas la voir. Elle demande également une focalisation un brin plus proche, le coup de main venant avec l’expérimentation et les ratés.

Pour procéder nous avons donc besoin soit de super pouvoirs, soit d’un trépied. J’ai opté pour le Manfrotto fautes d’araignées nucléaires, quoiqu’on ait des virus dignes de SF dans les parages. Un problème de taille apparaît vite dans certaines conditions, notamment celles du cliché TurboKaneda 336-B ci-dessus : à environ 300mm de focale, le moindre mouvement cause un grand décalage sur le résultat final. Avec le vent incessant balayant les pieds de l’Opéra sur lesquels s’appuyaient ceux de mon trépied, j’ai dû hausser l’iso, causant un certain bruit toujours préférable au flou : ici la quête des structures est de mise, et se rapprocher de celle qu’on voit nous offrira une plus grande ouverture à l’abri du souffle du large.

Tous ces éléments pris ensemble, le vignettage, les couleurs, je les ai combinés pour créer ce dernier cliché. Superposant deux expositions j’en ai gardé la différence d’alignement comme cadre : le hotspot y met en valeur l’église, que j’ai placé au centre.
Le long temps d’exposition donne lieu au phénomène de ghosting et le fantôme d’une voiture sur la gauche est un intérêt de plus donné à une photo de bâtiment qui y gagne en vivacité ; on voit qu’il s’y passe quelque chose et même on voit au travers de ces choses qui y passent.
L’infrarouge bien géré apporte une réflexion particulière dont s’habillent sans qu’on les voit les choses usuelles, et j’ai choisi de finir cet article sur ce cliché étant à mes yeux le plus abouti que j’ai pu faire de la superbe Marmorkirke.

L’été viendra en d’autres radiances
Sur le même sujet